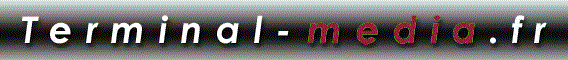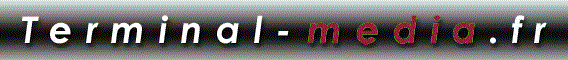L'option
"Télésurveillance"
roman
PREFACE
En pleine crise de spleen, Lionel Gautier se remmémore sa plus tendre enfance à Versailles la ville qui l'a vu grandir. A l'âge de 20 ans, grisé par les sports extrêmes, les substances illicites et la fringale de la réussite sur internet, il tombe de haut à cause d'une maladie psychique. Mais soigné et plutôt malin, après quelques rebondissements, il finira par parvenir à son but
Chapitre 1) Flashback
Le lendemain matin de bonne heure, alors que je suis à mon bureau, derrière mon écran, j'en profite pour consulter mon compte Switech, dans lequel, je découvre dans un Swit du quotidien « Parenthèse » l'organe officiel des Rigoristes, l'annonce que l'on peut y trouver une interview sur l'affaire de la « datazone » du président de la république, François Poitevin. Ils ont dût du l'obtenir au cœur de la nuit, ce qui prouve que le président sait travailler tard comme une sentinelle dans son mirador qui veille sur son pays, la france. J'ai suivi le lien puis, je lu brièvement les questions et consciencieusement, je me mis à lire tout l'article.
Je m'arrête songeur dans ma lecture, le temps d'aller me chercher un café puis je remontais dans mon gourbi, posa les deux pieds sur le bureau, l'index sous le nez.
Chapitre 2) Prémices
Je rejoins le chemin du signe, du caractère, du récit, car du haut de mes cinquante ans, je ressens qu’il est maintenant temps. Ma vue s’est dégradée et ma santé mentale est en déclin, comme par un miracle inexplicable, j’ai auparavant, échappé au pire, mais pourtant mes facultés intellectuels sont en cours d’altération, aussi, j’escompte laisser une trace, avant l’irrattrapable fin. Pour cela, je souhaite que seule la narration m’accompagne, pour relater ce qui m’a semblé être essentiel de me rappeler. Pour avoir entretenu, tout au long de ces années, les souvenirs que je vais exprimer, je n’avais pas négligé une mémoire que je voulais tenace sur des évènements qui devaient me faire rentrer définitivement, à cette époque, dans ma vie d’adulte responsable. Tout autant, cette histoire propulsant l’être humain de plein pied dans le XXIe siècle est à mes yeux essentiels. Au crépuscule de ma présence sur terre, quand je regarde les étoiles, je ne peux m’empêcher de penser à l’humanité qui est peut être réunie ici, parmi cette myriade de planète dans cette immensité alors que sur terre, les forces de l’esprit repoussent les limites du savoir de l’homme, de sa vie, comme de sa mort. Infime étoile dans l’univers qui représente peut-être ici dans ce ciel de septembre deux mille quarante-neuf, ceux qui sont partis, je leur laisse ce témoignage, poussière de l’infini.
Le déterminisme et la naissance
Le déterminisme m'avait donné la chance d'être né tout près de Paris, je m’en rendrais compte plus tard, c'était un luxe et plus luxueux encore, mes dix premières années sur cette terre, furent vécues à Versailles à trois cent mètres des grilles du château du même nom.
Se souvenir de l’école maternelle est difficile, pourtant, je peux encore me rappeler de la petite rue du peintre Lebrun où se trouvait le bâtiment qui accueille, toujours actuellement les plus jeunes enfants.
L’école Marcel Ferdinand
L'école Marcel Ferdinand, sur le boulevard de la Reine, avait été mon second contact avec l'éducation nationale et ce fut un échec. A ma première rentrée des classes, le contact avec l’institution fut déchirant et la séparation avec la sphère familiale très mal vécu. Malgré tout, je devais passer l'année plutôt de façon tranquille bien que je m'y ennuyais sérieusement, l'instituteur était plutôt gentil, je n'avais pas eu à m'en plaindre. La seconde année dans l'école fut capitale, marqué par un incident que je ne serais pas prêt d'oublier et qui marqua un tournant décisif dans ma jeune scolarité. Alors que l'institutrice me fit intervenir au tableau pour me poser des questions sur une leçon de français dont je ne connaissais pas les réponses, cette femme eut l'idée déplorable de me donner des coups sur la cuisse avec une longue baguette, espérant me faire retrouver la mémoire sur la conjugaison du verbe « jouer » au singulier. Elle devait avoir prévue son coup car ce supplice qui dura longtemps ne fut abrégé qu'à la sonnerie de onze heures trente qui indiquait le départ pour aller déjeuner. La journée passa, mais ce n'était qu'une fois à la maison alors que je me déshabillais pour mettre mon pyjama, que ma mère remarqua les hématomes bleus, verts qui avaient tendance avec une métamorphose inquiétante à tourner marrons et présent sur le haut de ma jambe. Je n'avais fait part à personne de ce qui s'était passé le matin, même. Le lendemain, c'est ma mère qui s’est déplacé pour vociférer devant la jeune femme outrageusement brutale et elle l’a menaça de porter plainte en lui expliquant qu’elle avait pris des photos. A partir de cette date, l’institutrice revêche me laissa tranquille en m'excluant du rythme de la classe, sans plus me faire intervenir. De cette situation grotesque, certains jours, je manquais l'école avec l'approbation de ma mère et nous partions tous les deux à la campagne ou nous restions dans l'appartement. Il m’arrivait de rester seul dans ma chambre alors que s’étant réveillée très tôt le matin, elle récupérait son sommeil après le déjeuner. L’isolement, pendant ces périodes était omniprésent, pourtant, je ne manifestais pas ma rancœur à son égard et à cet âge, la conscience est relative. A mon retour à l’école, le lendemain, je pouvais percevoir l’animosité des autres enfants qui semblaient me reprocher de ne pas être venu la veille, comme si j’en avais profité pour pratiquer un loisir merveilleux, alors qu’ils étaient astreints, eux, à travailler. Evidemment, je prenais du retard par rapport au niveau de la classe et la plupart du temps, j’étais seul dans la cour de récréation. Dans ma chambre avec mes jouets d’enfants, je passais la journée à construire et détruire des villes en briques Légo ou établir des batailles avec des playmobiles. Là, c’était le début du rebelle. Des modèles réduits de tank et des véhicules de toutes sortes donnaient un réalisme saisissant à ces combats. Pour la génération de mes parents, la guerre « froide » était encore présente dans les mémoires pour leur rappeler une autre guerre qui devint d'actualité, celle dite "terroriste".
Comme un crin-crin
Ma mère m'avait offert un petit poste de télévision en noir et blanc, alors que la Télévision Numérique Terrestre n'existait pas encore. Les chaînes visibles étaient les six chaînes historiques celles que l’on retrouve dans les premières numérotations et j'avais pour habitude d'écouter ce petit crachin propre au son caractéristique des téléviseurs à tube cathodique de cette époque et il m'accompagnait dans mes jeux, une bonne partie du temps. Dans ce monde à la fois de l’information, du divertissement, entrecoupé de jingle et de série, dans l’univers fantastique et poétique de la télévision. Je découvrais que j’étais aussi immortelle que le constructeur d’avion avec des branchages Mike Grydder ou l’inspecteur de police autrichien Friedrick et qu’un monde semblait vibrer à l’extérieur de ces murs.
Le retard scolaire s’accumulant, j’ai eu plusieurs entretiens avec une psycho thérapeute de l’école car on avait décelé chez moi une dyslexie. Plusieurs fois dans l’année, je devais me retrouver dans son bureau et la plupart du temps, elle me prêtait des livres de l’éditeur Quikoiou. Je dévorais bien que peu rapide ces livres qui me hantait à l’époque.
Un peu plus tard dans ma scolarité, bien que je fusse un piètre élève, il arrivait que l’on me donne des directives pour présenter un exposé. Des recherches iconographiques s’imposaient et j’aimais cet exercice où il fallait également préparer un texte et trouver l’argumentaire pour soutenir son travail. Bien que je ne me rappelle pas avoir eu de bonnes notes, un autre de mes fers de lance devait être la récitation, je mettais du cœur à réciter comme un acteur sur les planches « Mignonne, allons voir si la rose » ou « Le corbeau et le renard » et je provoquais la stupéfaction chez mes petits camarades plus habitués au chant morne et monotone de la litanie dont il venait de se débarrasser une fois, qu’ils avaient ânonné au créneau sur l’estrade dans la classe.
Détection d’un fumiste
De Versailles nous devions nous installer en mille neuf cent quatre-vingt-seize à Levallois-Perret. Lors d’une confrontation entre moi et l’ensemble des élèves de la classe, l’institutrice, une femme fine et intelligente, me dit devant tout le monde : « Lionel vous êtes un fumiste, vous savez ce que veut dire le mot fumiste, n’est-ce pas ? » Et je répondais d’un air entendu que oui, je connaissais cette signification. Elle me demanda également ce que voulait dire le mot fumiste et j’étais dans l’incapacité de répondre. Ce fut une bonne leçon et peut être que bien des années après cette parenthèse j’ai essayé avec tous mes moyens de lui prouver qu’elle avait tort et c’est pour cela que parfois dans ma vie, j’ai essayé d’offrir le meilleur de moi-même et tout donner se révéla comme un exutoire sain et gratifiant bien que souvent, je n’atteignais pas tous mes objectifs. A cet instant, je devais être persuadé qu’il fallait ici se donner les moyens de ses ambitions et que la fatalité ne pouvait avoir de prise sur l’individu hormis et c’est peut être son seul obstacle, face à la nature. Il m’arrivait de me demander si cette sacro-sainte mère nature, nous ne pouvions la détourner, la rendre docile. Qu’elle appartienne à un pan de votre personnalité ou que ce soit par l’existence de moustiques propageant de terribles maladies en Afrique mais aussi dans le reste du monde. Etait-ce bien nécessaire au bon fonctionnement de l’être humain ? Ne pouvions-nous, pour les moustiques, puisque que leur ADN avait été isolé par les scientifiques, ne pas éradiquer leur existence de nuisible de nos nuits. Avec quels risques ? Que les moineaux se délectent plus des fourmis ?
Le chahuteur
A L’âge de douze, treize ans, l’émancipation étant, et quasiment dans les derniers de la classe, soulignant un caractère épris de liberté et sensible aux chants des sirènes qui se promenaient dans la cour de récréation mixte du collège. Je fus piqué par une mouche qui devait me rendre imperméable à toute autorité selon les matières étudiées. C’est alors que j’entamais une carrière de chahuteur qui loin de faire l’unanimité auprès des élèves de la classe qui eux se passionnait pour l’anatomie des organes de la souris ou du calamar, me permettait de rire de moi-même et de ma disposition à provoquer une réaction furieuse du professeur de science naturelle. La joie fut de courte durée car lors du conseil de classe, je devais redoubler une nouvelle fois.
L’âge venant, je n’étais passionné par rien de ce qui sortait de la bouche du professeur, en dehors de l’histoire, de la géographie et aussi peut être un peu des mathématiques. Bien que j’essayais, lors de mes rédactions d’avoir le mot juste et l’idée bonne, ce qui reviens à dire qu’après de nombreuses ratures, je rendais à la fin de l’heure, un pitoyable texte qui n’excédait pas une demi page au maximum. Ejecté du collège en fin de cinquième, j’avais le choix soit d’entreprendre un CAP de menuisier ou dans le domaine de la coiffure, les seules voies qui ne porteraient pas atteinte à la sérénité et le sérieux des cours. Ainsi, je fini par intégrer l’école privée. Moins perturbateur, je n’en étais pas plus motivé et en troisième je quittai l’école ou plus exactement, c’est l’école qui s’éloignait de moi. J’avais l’âge légal : seize ans. Aucune notion de mes faiblesses et toutefois avec la certitude et la ferme intention que la vie s’offrait à moi, elle était lointaine, formidable et certainement pleine de plaisir que je supposais encore plus que je ne l’imaginais. J’étais optimiste dans l’action et pessimiste dans la pensée avec une sorte de foi positive qui me donnait des ailes. La fatalité ne devait pas faire loi devant les obstacles qui avait surgit tout au long de ma scolarité. Les diplômes avaient-il une raison d’être ? J’étais loin des tableaux d’honneurs, des A, des dix-huit sur vingt et des encouragements, un monde s’offrait à moi, mais, je n’en connaissais ni les codes, ni les modes de fonctionnement, ni ses nuances dissimulées.
Images d’Epinal des sports extrêmes
Surgis alors, une période qui n’était pas la pire. Subjuguer par les images d’Epinal des magazines de sport d’action américain de la côte ouest, à la fin de l’année 2004, je fus fasciné par le style et le mode de vie des jeunes champions de BMX et de skateboard de la Californie, j’y plongeais de tout mon corps, panoplie, et matériel et bientôt avec des heures d’entraînements, je fus sponsorisé et intégré dans une équipe de BMX, les « Radical Rats ». Je vivais chez mes parents avec une certaine autonomie, puisque j’habitais dans un petit studio du septième étage de l’immeuble et en plus de la liberté de circuler, j’avais aussi des moyens financiers grâce à mes parents.
Vivre vite et bien
Vivre vite et bien, cela pouvait être ma devise. Ma vie n’était qu’une succession de bouffées d’adrénalines, des secondes d’éternités prisent entre ciel et terre. Que ce fut à travers la drogue ou l’alcool, j’aimais les sensations intenses, restez en suspension, jouer avec les lois de l’apesanteur de la gravité, détacher mon corps de mon esprit. C’était mon sacerdoce, mon Graal, mon but ultime, la seule chose qui me maintenait en vie. Je devais être un taré, un malade des pentes verticales. L’acceptation du danger, la peur du risque était peut être un sentiment qui venait avec l’âge, je ne le savais pas car je ne m’étais jamais posé la question et je ne me la poserais probablement jamais. Tout ce que je savais c’est que je n’avais qu’une vie et qu’à quarante ans, je serai vieux et fatigué, je ne pourrai pas me permettre de vivre comme aujourd’hui. A cet instant, il n’y avait pas d’alternative et aucune envie de me calmer. Puis, j’aurai une femme, des enfants et probablement un bon travail. Vivre à deux cent à l’heure, c’était un style de vie qui me convenait parfaitement. Griller mes neurones par tous les moyens, j’aimais ça. Pas de conscience du danger ? Pire, je n’avais conscience de rien. Je ne calculais rien, je me lançais et pour la plupart du temps ça passait comme un chat ou un tigre en pleine nature.
Une petite personne
Devenir fébrile, incontrôlable, en symbiose avec les éléments, sur la terre comme pour le ciel. Pousser ses limites, était un jeu, un défi, vis à vis de soi-même et un peu des autres. Je ne le faisais pas pour la frime, enfin si, peut-être et sans doute par orgueil mais surtout pour ce que je ressentais dans ce moment-là, c’est indescriptible, une sensation que seuls les adeptes des sports intenses ou les gens ivres peuvent comprendre, c’est la raison principale pour laquelle, j’appréciais les situations limites. J’avais un sale petit caractère de teigneux que je canalisais en flirtant avec le danger. Toujours en parfaite santé, j’étais au summum de la condition physique, même après une nuit de beuverie, je récupérais complètement après quelques heures de sommeil. J’étais immature, juste un sale gosse avec une bière à la main et de la musique construite en bruit organisé. A vingt ans, j’étais border line sous tous les angles, je fumais des substances illicites et j’avais un penchant pour le whisky et la bière très alcoolisée. Vous pouvez toujours penser que je fais dans l’égocentrisme à parler ainsi de moi, en fait, rien ne m’intéressait plus que ma petite personne. Je n’étais qu’un gamin dégénéré trash et rebelle, une petite molécule de poussière qui jouait avec le risque pour se donner des sensations limites. De toute façon, ma génération est celle que l’on a laissé tomber ou plutôt qu’il fallait exploiter comme une vache à lait dans un près et on l’a trait la vache, on l’a trait, jour après jour pour qu’elle rapporte toujours un peu plus au risque, soit de la rendre folle ou qu’elle meure de fatigue.
Mes parents
J’étais peu recommandable mais je le devinais à peine. Je devais être double car je présentais plutôt bien avec les amis de ma mère et de mon beau père, j’étais poli, bien élevé, irréprochable, alors qu’en fait, s’ils avaient soupçonné réellement qui j’étais, ils auraient étés terrifiés. Si vous l’aviez su, vous n’auriez pas voulu m’avoir comme fils et vous auriez eu parfaitement raison. Ensemble, ils ne parlaient que de politique et d’économie, cela ne m’intéressait pas. Leurs conversations m’apparaissent stériles et sans grand intérêt, mais néanmoins, j’écoutais attentivement, mais pas question d’intervenir lors de l’apéritif ou du dîner et en plus, pour dire quoi ? Ils étaient à des années lumières de moi et cela valait mieux pour eux. Mon monde, ils ne le devineront jamais, je n’étais pas comme eux, je ne parlais pas moi, je ne refaisais pas le monde entre le plat et le dessert, j’étais dans mon univers avec son vocabulaire, ses rites, ses symboles et ses héros. Je n’avais pas besoin du monde des adultes, des gens normaux, je n’y trouvais rien qui m’attirait. Ils m’ennuyaient. Mon manque d’entrain à participer à leurs discussions devait être mal perçu, ils me prenaient peut être pour un autiste, un grand timide ou un idiot. De toute façon, je m’en moque, ils pouvaient penser ce qu’ils voulaient. J’étais présent, c’était l’occasion de boire un whisky pur malt et dégusté du bon vin, le reste était accessoire. J’étais l’éternel adolescent en décalage avec le monde qui l’entourait, le chiffre infini, le numéro zéro, je refusais de grandir et cela ne regardais que moi, après tout.
Bonze Chinois
Ma mère m’adorait, mon beau père me supportait tant bien que mal. Du moment que m’a mère lui faisait tout ce qu’il avait envie, je ne risquais rien et il n’avait rien à dire. La plupart du temps, ils étaient en voyage, ou dans la maison de campagne et je profitais pleinement de l‘appartement de cent-vingt mètres carrés situé en plein Levallois-Perret, le tout consistait à le rendre aussi propre qu’avant leur départ. Pour ça, j’embauchais la femme de ménage Albanaise pour un extra, j’achetais son savoir-faire et son silence et le tour était joué. Elle ne me coûtait presque rien et tout le monde y trouvait son affaire. Que demander de plus ? Ma mère, je pouvais tout lui faire croire, je lui mentais en permanence, c’était une façon d’avoir la paix, moins elle en savait, mieux je me portais. Je redoutais le jour où elle pourrait ne plus me faire confiance, alors je la ménageais, si elle avait su à quel point, j’étais déjanté, elle en serait devenu malade, je l’aimais ma mère plus que tout au monde. C’était normal, c’était ma mère. J’avais peur de la décevoir, alors je mentais, sur mes fréquentations, sur mon emploi du temps, pour un oui pour un non, je mentais pour rien parfois, par habitude, par omission ou pour la forme. De cette manière, je passais pour un garçon sage et conciliant. J’étais son seul enfant, né d’un premier mariage, mon père était un artiste sans un sou, un ancien champion de ski, qui a perdu les pédales quand ma mère l’a laissé tomber. Ils se sont séparés alors que j’avais 2 ans. Elle était désirable, elle portait ses quarante-six ans comme personne, coquette, moderne, un air un peu scandinave, cette normande avait toujours été séduisante et conquérante. Son charme, elle n’a pas dû en user beaucoup pour séduire mon beau-père, trois mois après l’avoir rencontré, il l’épousait. Je faisais partie de la transaction, du lot, du paquet cadeau. Il m’avait accepté avec tout ce que ça impliquait, notamment mes études chaotiques. Je le considérais comme un tiroir-caisse, une carte American trader gold, un bonze chinois antique en bronze qui porterait chance. Je noircis le tableau en ce qui le concerne, je l’aimais bien finalement mais c’est son argent que je préfèrerais chez lui. De toute les façons, il me prenait pour un demeuré, néanmoins, il a réussi à me convaincre de rentrer dans une école d’informatique privée pour devenir informaticien en tant qu’auditeur libre, ma mère et lui m’ont menacés de me couper les vivres, si je ne suivais aucune étude.
3) La data timing
L’école Omnitech
J’avais intégré l’école Omnitech en deux mille six et finalement, je ne m’en portais pas plus mal car j’avais beaucoup de liberté que je consacrais, bien sûr à aux sports mais la plupart du temps, c’était l’informatique qui occupait mes journées. C’était un cursus d’informaticien mais sans le bac, j’étais présent en tant qu’auditeur libre. A l’école, les professeurs étaient décontractés et les horaires plutôt élastiques, pas de cours avant dix heures du matin et dans l’après-midi de quatorze à seize heures. Dans ces conditions, la perspective de devenir un jour développeur ou multimillionnaire commençait à devenir de moins en moins utopique. Les images que nous avions en tête étaient la réussite à l’américaine et les contes pour s’endormir avaient pour nom Bill et la fenêtre magique ou Les milles outils de Steve.
Mythes de l’informatique
Dans le secteur de l’informatique, des hommes comme Steve Blobs ou Bill Frates représentait le succès et les archétypes de la réussite à respecter pour ce faire un jour un nom dans le milieu et devenir, selon toujours le modèle de réussite des histoires à l’américaine, un homme riche ou une icône. Un peu comme un film de Walt Bikney ou les vieux films de Steven Spielwere avec ses légendes ou ses héros, les mythes qui étaient habillement entretenu avec Blobs et Frates étaient les suivants : Pour l’un des créateurs de Seatle, l’histoire était celle d’un anticonformiste. Un rebelle des années soixante-dix qui avait fait l’expérience du lsd, un opportuniste indélicat mais malin, un aigrefin de génie qui avait adapté un marketing rigoureux à une gamme de produit électronique. Sa fulgurance reposait sur la philosophie et l’âme qu’il avait su donner et insuffler, à un engin inerte, certes, mais révolutionnaire. Ça commençait par vous dire bonjour dans votre langue maternelle et ça ouvrait de manière étendu, le champ des possibles avec ce qui allait vous permettre d’imprimer un journal, faire de la musique de studio, ou encore dessiner en 3D, un bonnet de père noël sur une photo de vacances aux sports d’hiver. Bill Frates, lui était un peu plus gauche avec une apparence d’éternel adolescent, mais une image de petit génie qui avait tout compris bien avant les autres. Ce qu’il avait surtout conceptualisé avec Mumsoft, c’est que le parc des divers micro-ordinateurs qui avait été construit au début des années quatre-vingt donnerait naissance au final au pc, le personal computer. Pour qu’il fonctionne, il fallait un système d’exploitation, un logiciel. Une fois qu’il avait le système R-BIOS, il vendit des licences auprès des constructeurs de micro. Renforcé par la démocratisation d’une machine ouverte à l’inventivité des constructeurs, il avait compris qu’une hydre à deux têtes qui rassemblait Swingdoors plus Sysantel, le fabricant américain de microprocesseur donnerait naissance à un monstre imaginaire Swing/Sys. L’équation était simple, en informatique, la loi de Moore déterminait que tous les dix-huit mois un produit électronique supplante le précédent et Sysantel tous les dix-huit mois sortait un microprocesseur toujours plus puissant, le fondeur de puce allié à Mumsoft influençait l’offre avec des machines toujours plus performante, ainsi le marché était mené par les deux leaders, le couple Swingdoors/Sysantel. Mumsoft avec ses versions de Swingdoors toujours plus adaptées aux besoins des utilisateurs et Sysantel, avec toujours, des microprocesseurs plus puissants. Autant Steve Blobs avait réussi avec du matériel cher, simple d’utilisation, le « Hardware » qu’il fallait sans cesse renouveler pour être à la page, autant Frates avait beaucoup misé sur le monde de l’entreprise et du « software » pour devenir pendant longtemps l’homme le plus riche du monde. En tout cas, les mythes de ces réussites industrielles avaient tous un dénominateur commun, c’est qu’un jour dans son garage ou dans sa cuisine on avait eu l’idée du siècle, que l’on était parti de rien et qu’à force de travail et de ténacité, on avait fini par bâtir un empire ou vendre à quelques trust pour des sommes mirobolantes, le fruit de ses efforts. Le nouvel eldorado s’appelait Internet comme au temps des chercheurs d’or du far-west et soit, on était très bien équipé pour faire face à l’hostilité du terrain des contrées lointaines, soit on finissait, isolé, dévoré par les ours. Quant à moi, j’étais d’humeur à aller danser avec les grizzlis.
Un vendredi matin avec la came
Je m’étais levé vers huit heures, plutôt en forme pour un vendredi matin, ma première démarche fut de mettre une sélection de MP3 des Wisigoth’s Sword dans le lecteur Swingdoors Média pour XB de mon pc. Un groupe Métal Californien, c’était parfait pour le matin, lourd, accrocheur, ironique, de quoi vous mettre en train, dès le début de la journée. Habillé d’une robe de chambre, j’avais enfilé mes baskets et j’étais sorti de mon antre. Cette pièce, c’était mon fief, mon espace de liberté personnel, mon baisodrome aussi, personne ne venait jamais me déranger car j’étais le seul à l’étage, ma mère ne montait jamais ici et le propriétaire, c’est mon beau-père, donc aucun souci de loyer.
Je dévalais l’escalier de service en béton gris de ce bel immeuble des années trente pour rejoindre, un étage plus bas, au sixième, l’appartement familial. Dans la cuisine, sans bruit, je m’étais infiltré comme un voleur, j’avais fait réchauffer une grande tasse de café dans le four micro-ondes. Une fois mon forfait exécuté, je remontais dans ma tanière. J’avais descendu de mon lit en hauteur la couette encore chaude de ma présence, puis, j’avais rapproché la table basse, fait le vide parmi les canettes de bière neuf six de la veille qui traînaient un peu partout, bu une gorgé de café et je m’étais jeté sur un petit coffret en bois. Dans la boite, on y trouvait, pèle mêle du papier à rouler abc, des tickets de métro, une petite paire de ciseaux et surtout le plus important qu’il soit, une enveloppe en papier remplie de skunk. De l’herbe. Un plan sérieux et sûr, je la payais chère, mais la qualité était là et je n’en demandais pas plus. Une belle enveloppe kraft, rien que pour mon petit cerveau de parfait junkie. En bruit de fond, on pouvait entendre un morceau des Guts qui s’appelait “ a gun for Christmas ”. Après avoir émietté une des têtes de la plante psychotrope et mélangé le tout avec du tabac, j’ai approché la pipe à eau translucide qui trônait également sur la table. Après avoir tassé le mélange dans le foyer, j’ai évacué l’air de mes poumons et j’ai allumé le tout avec mon briquet. Alors que j’aspirais lentement, la pipe se remplie de fumé et dans une grande inspiration finale, la cendre incandescente est tombé dans l’eau, j’ai rejeté la fumé par vague successives par la bouche et par le nez. Après un long soupir de détente, une sensation de confusion passagère m’envahit. Les volutes de fumés planaient dans la pièce en nappe bleutées, l’odeur d’herbe était forte presque acide, j’étais sous l’effet de la drogue un peu haletant, tout de même, fatigué par l’effort mais satisfait. Mes neurones instantanément, commençaient à s’engourdir, je sentais ma tête comme envahit par de la buée sur une vitre, mon corps lentement s’engourdissait. J’avais l’impression d’être dans du coton, ouaté de la tête au pied, sous l’effet total de la défonce. Venant des enceintes, on pouvait entendre “ happy birthday to me ” des Guts. Je me suis mis à rire, un rire nerveux incontrôlable, puis j’ai repris les paroles de la chanson, en singeant un invraisemblable chanteur, le poing devant la bouche comme si j’avais un microphone entre les mains, et pendant un instant, je braillais frénétiquement dans la pièce vide. L’herbe ça me donnait la pèche, enfin dans la première heure, après la prise, puis c’est le contre coup et venait l’envie de dormir. Dans cette semi léthargie on se sent bien, engourdi, un peu gauche, perdant facilement l’équilibre, la meilleure des positions c’est couché. Je me suis affalé sur le canapé, un rare soleil d’octobre transperçait la pièce à travers les lattes du store. J’ai allumé une cigarette pour faire remonter l’effet de la drogue et terminé ma tasse de café. Déjà huit heures cinquante affiché sur le radio réveil de la table de nuit, il fallait sortir de ma torpeur matinal, assurer la journée qui commençait. Je suis passé dans la douche vitesse grand V, l’eau tiède ruisselante dégoulinait sur mon corps, j’avais l’impression d’être une toile cirée sur laquelle rien n’avait prise. J’y serais bien resté des heures, hébété, assommé par les effets de la marijuana qui perduraient. Je ne devais, toutefois pas, être en retard pour mon cours concernant les bases de données relationnelles pour le dernier jour de cours de la semaine.
Laurent vendredi soir
Laurent était arrivé vers neuf heures du soir, j’avais entendu le son significatif de sa grosse cylindrée qui arrivait dans la rue. Il ne venait pas les mains vides. Il jeta sur la table un morceau de shit très noir, et s’exclama triomphalement “ et voici le clou de la soirée : douze grammes d’Afghan et un dvd porno américain. ” Après avoir examiné le H, aussitôt, je préparais le mélange de tabac et de ce précieux et rare produit stupéfiant. C’était le rite immuable des débuts de soirées chez moi. Je finançais ce que nous fumions et il se chargeait de trouver ma dose hebdomadaire. J’ai sortis un billet de cent euros de ma poche et lui tendit. Sans sourciller, on s’envoya chacun une magistrale bouffée de haschich avec le bang. Puis vint le temps des palabres rudimentaires. Avachit sur le canapé, il feuilletait le magazine américain des « geeks » urbains « Wild bits» d’un œil distrait et nonchalant.
- Il est bon ce shit !
Me dit-t-il après avoir tourné la dernière page du magazine. Visiblement, il n’écoutait qu’à moitié ce que je lui racontais. La seule passion de ce mec, c’était de changer de deux roues tous les six mois, à dix-neuf ans, c’est déjà sa septième moto et ses parents finançaient ses acquisitions. Son père avait une entreprise de peinture en bâtiment, composé de huit salariés, pour la plupart des roumains et des hongrois dont la famille était restée au pays, sa mère était comptable dans la boite familiale, ils travaillaient dur, c’était des gens simples et honnêtes mais leur réussite ne devaient pas passer inaperçue. Ça marchait plutôt bien pour eux et heureusement pour Laurent car sinon, il aurait roulé à vélo et moi aussi par la même occasion. Ce type vivait pour la frime, c’est ce l’on ressentait chez lui, dès le premier contact, il habitait dans les HLM de la ville de Paris. Dans son immeuble, c’était le roi des Français parmi des gens plus à l’étroit en matière de ressources, cela crée probablement des jalousies, néanmoins, il y a une sorte de fraternité dans ces tours d’une quinzaine d’étages construites dans les années soixante-dix. Il y avait passé toute son enfance et il connaissait tout le monde. On y trouvait à peu près de tout, l’important était de s’adresser à la bonne personne et en matière de petit business tombé du camion ou clandestin, Laurent était la personne irremplaçable pour un usager quotidien de drogue, comme moi. Nous étions très différends l’un et l’autre, et malgré tout, il restait à mes yeux, un parvenu qui habitait une barre HLM le long du périphérique. Je ne lui reprochais pas sa condition sociale, mais il y avait un monde qui nous séparait, son seul objectif dans la vie, c’était de ne pas se prendre la tête et il y réussissait plutôt bien. Dans une discussion un peu sérieuse, il sauvait les apparences constamment, mais il faut reconnaître que c’était aussi une oreille attentive qui répétait ce qu’il avait pu entendre çà et là. Je n’avais pas l’impression qu’il comprenait le monde qui l’entourait, c’était un électron libre et je supposais qu’il voulait être au même diapason que moi, sur la même longueur d’onde parfois. Par exemple, dans une discussion, il s’opposait vainement à ce que j’affirmais, dans une forme de négation stérile, juste histoire de ne pas avoir l’air trop stupide, mais c’est un gros dilettante et moi en comparaison, je suis un hyper actif, un curieux de la vie. Il m’en fallait toujours plus, malgré la dope et mon côté extrême. Nous nous sommes connus, il y a quatre ans, nous étions dans la même école en troisième, j’avais fumé mes premiers sticks avec lui, depuis, une certaine complicité était née de cette relation. Après avoir fumé, un rien me faisait rire, c’est le produit qui veut ça, à ce moment-là, j’étais désespérément heureux. D’une manière ou d’une autre, s’il pouvait profiter de toi, c’est sans se poser de question qu’il aurait agis pour pouvoir t’escroquer. Je n’étais pas dupe une seule seconde et moi, c’est moi et lui c’est du divertissement à l’état pur. C’était un parasite professionnel, comme j’avais de l’argent, il fumait gratuitement et je me déplaçais en tant que passager sur ses bécanes rutilantes, c’était agréable de contempler une ville comme Paris, la nuit, les sens affûtés par la came.
Chez Léa, rue Lebon
On devait passer chez Léa, porte des Ternes. Elle était une ex de Laurent, après l’avoir plaqué, ils étaient restés copain. Elle partageait les mêmes goûts que nous en matière de fumette, elle n’était pas jolie, bien foutue tout au plus. En tout cas, elle ne m’attirait pas, enfin peut être un soir, j’aurais pu coucher avec elle après quelques bières, histoire de faire connaissance en profondeur, mais quand j’imaginais la retrouver un matin dans mon lit ou le sien, à cet instant, cette perspective avec elle, d’une union, s’évaporait vite. En matière de sexe, tout était assez simple chez moi, je ne couchais qu’avec des filles peu attirantes, elles n’attendaient aucun romantisme, aucun lendemain et si par hasard l’une d’entre elle, espérait autre chose qu’une relation axée vers le sexe, je la décevais de la plus cruelle des façons possible, pour qu’elle se fasse une raison et qu’elle me déteste au plus haut point. Elles finissaient par se lasser d’être utilisées comme des objets sexuels. Je n’étais, ni patient, ni tendre, charitable tout au plus. Pendant ses rapports, l’amour m’était complètement étranger, bien sûr, un jour, je vais me marier, j’aurai des enfants mais ce n’est pas pour tout de suite et je ne vais pas gâcher mon temps à essayer de trouver une liaison durable. Et puis, il y avait les princesses, les intouchables, celles avec lesquelles, je ne coucherais jamais car à travers quelques blocages, je ne passais pas à l’acte. Elles étaient en général séduisantes, intelligentes et elles le savaient. Elles m’attiraient terriblement, mais je remettais toujours au lendemain le moment où il fallait que je les embrasse. S’engager m’était difficile, j’avais peur du refus que cela pouvait engendrer et puis invariablement, je pensais au final, qu’elles ne m’aimaient pas. Si je ne les sentais pas prêtes à succomber au premier baisé, je me sentais comme paralysé, tétanisé par l’effet que je pouvais provoquer puis c’était à leur tour de penser que, finalement, je ne les aimais pas. Comment aimer lorsque l’on ne s’aimait pas soi-même.
Véritables chiennes
A dix-neuf ans, j’affichais un score de sept coïts avec des filles différentes, ce qui est peu à en entendre Laurent car son tableau de chasse était impressionnant par rapport à moi. En ce qui me concerne, ce sont des liaisons pour la plupart d’un soir, voire d’une semaine au grand maximum, rétrospectivement, je m’en moque, elles n’étaient pas terribles. Ma libido se déchaînait le plus souvent, lorsque, j’étais seul, j’arrivais à me masturber jusqu'à deux voire trois fois dans la journée. Une fois le matin, quand je me réveillais le sexe en érection, dans l’après-midi comme ça pour faire passer le temps et penser à autre chose et puis avant de m’endormir pour trouver le sommeil. L’amour propre est une chose que j’ignorais et le fait de fumer du H, exacerbait les sensations et on n’échappait pas à la règle du plaisir facile et parfois, il m’arrivait de me retenir pendant trois quarts d’heures avant l’instant attendu de l’orgasme. Dans ces moments, la plupart du temps, je visionnais des séquences pornographiques récupérées sur Internet ou des dvd que Laurent apportait. Ces filles étaient de véritables chiennes qui provoquait en moi une excitation hors limites, mais une fois que le plaisir était venu, je maudissais ces damnés créatures, qui ne représentaient qu’au final que quelques salopes de plus dans l’univers. Ces bombes sexuelles s’exhibaient devant la caméra pour quelques centaines d’euros et en plus avec le sourire. La terre entière pouvait profiter de leurs prestations dans les ordinateurs et on les retrouvait pratiquant partout avec la même vénalité pour quelques euros, avec plus qu’un spectacle intime. C’était ainsi que depuis l’âge de treize ans, un copain m’avait donné une revue pornographique et depuis j’avais mon auto sexualité, c’était mon jardin secret et je savais que mon cerveau était le seul espace de liberté qui existait sur terre. Pourquoi se priver de plaisir quand c’est gratuit et que cela ne porte, a priori, qu’à peu de conséquence vis-à-vis du monde extérieure ?
Aussitôt arrivé dans la petite chambre de bonne de Léa, j’avais roulé un joint d’Afghan de deux feuilles. Les cloisons étaient minces dans cet immeuble un peu vétuste de la rue Lebon. La majorité de ces petits appartements, ou de ces chambres étaient occupés par des Albanais ou des Roumains qui travaillaient pour la plupart chez les bourgeois du quartier. Je les imaginais à mille lieues de mes préoccupations actuelles. En fille de femme de ménage, l’intérieur de la chambre de bonne était impeccable. Léa est femme de chambre dans un petit hôtel de Clichy, elle n’avait pas l’air de se plaindre de sa condition en nous parlant des dernières anecdotes et autres plaisanteries de couloir qui avaient jalonnés sa semaine de travail. Une fois mon joint préparé, je proposais de faire une indienne, cela consistait que l’un après l’autre nous fumions une latte du pétard et nous retenions notre respiration en passant le joint à son voisin, nous ne recrachions la fumé que lorsque notre tour était à nouveau arrivé. A ce rythme, on était très vite cassé par le cannabis et aucun d’entre nous ne fumait plus que les autres, nous étions tous unis dans ce rite et les barrières, sociales et culturelles, étaient abolies. Une copine de Léa venait nous rejoindre: Suchana, une autre Albanaise. Pour l’accueillir, je roulais un autre pétard, je tirais trois bouffés et lui tendait le bedeau. C’était le troisième de la soirée, sans compter le bang chez moi et lentement, je partais dans un mutisme quasiment complet. J’étais ailleurs, leur discussion tournait autour du nouveau téléphone portable de Laurent, j’en avais rien à battre une seule seconde. Finalement, las de les entendre s’extasier, je sortais mon Nokia et commençais à surfer sur le wap. Nous avons regardé le résultat d’un questionnaire en mode texte, ça amusait la galerie, avec quelques rires incontrôlés. Je me lassais vite, j’avais envie de sortir prendre l’air, rien ne me retenait ici dans cet espace confiné ou s’entremêlait les effluves suaves de cannabis et les odeurs de produit récurant.
Le week-end à la campagne
Ce week-end, c’est la fête et vendredi, j’avais invité à la campagne, une petite demi-douzaine de personne avec Laurent et Pierre et leurs copines. Mes parents étaient ailleurs, la maison était donc à nous et à moi en l’occurrence qui va mener les opérations de a à z. Parmi les filles, il y en a une qui sort du lot, c’est une ex-copine de Laurent. Jane, elle était différente et prête à rire à chacune de mes réflexions stupides, dont j’avais le secret. Le dimanche matin, je m’isole dans le jardin car j’ai besoin d’être seul. Elle vient me retrouver près des balançoires et nous discutons, chose dont nous n’avions pas eu encore l’occasion de faire, je suis profondément troublé par cette rencontre. Qu’est-ce qu’elle me trouve de particulier. Elle faisait ses études en France depuis un an, elle parlait un excellent français, elle était vive, intelligente et elle ne manquait pas d’humour. Elle venait de m’expliquer avec un flegme tout Britannique qu’elle n’était pas jeune fille au pair pour s’occuper d’enfants dans des familles françaises, mais selon son terme très précis, plutôt jeune fille aux putes ce qui ressemblait en beaucoup de point à cette activité bilingue d’aide aux enfants. Elle plaisantait évidement.
Je reverrais Jane pendant toute l’année et nous étions très proche, lié par un côté sombre qui nous unissait tous les deux. Car les mêmes choses nous faisait rire et nous n’étions pas gentils ni l’un ni l’autre. Pourtant, je n’osais franchir le pas et la prendre dans mes bras, la serrer contre moi. On s’entendait très bien, trop bien et j’avais la trouille. Je n’étais de toute façon pas mûre sur tous les plans et mes blocages étaient immenses. D’ailleurs, elle fera tout pour me mettre à l’aise. Un soir, ivre mort, je me retrouve dans un lit avec elle, je m’endors. Abasourdie par mon inertie, elle me disait un jour, « parles Lionel, parles » mais rien à faire, j’ai peur de montrer mes sentiments qui étaient pourtant bien présent et passer à l’acte me tétanisait. Elle croyait que je ne l’aimais pas, c’était faux, mais j’étais bloqué, figé, englué dans mon présent et je ne pensais qu’au lendemain pour me refaire en mieux. Alors que je parlais mariage à ma grand-mère, la perspective de l’effectuer avec une anglaise représentait une idée séduisante, la vieille gauloise m’en dissuadait, j’ai eu la faiblesse de l’écouter, ça allait me coûter cher. Ma relation avec Jane va se distendre à la suite de ça. Par ma faute, nous nous retrouverons comme deux crétins.
Chapitre 4) Le malade
Le début de la schizophrénie
C’est en avril deux mille huit, que le sommeil était devenu plus difficile et je commençais à devenir irascible voir colérique lorsque l’on n’allait pas dans le même sens que moi, vers les mêmes réflexions, conclusions ou jugements. Ma mère s’était inquiétée, elle ne me comprenait plus, elle disait que j’avais eu des propos incohérents selon elle, alors que je l’avais surprise au téléphone dans une conversation avec mon beau père. En juin, je ne dormais que deux heures par nuit pendant plusieurs jours d’affilés. A la fois, abattu, nerveux et fébrile, je devais voir un psychiatre. Je vais rencontrer le docteur Geneviève Cousin, je lui expliquais mon manque de sommeil et avec les médicaments qu’elle me prescrit, je recommençais à dormir mieux. Avec elle, une fois par semaine en consultation, venait une période où j’avais libre antenne et je lui racontais tout ce qui me passais par la tête parfois, des choses complètement saugrenue, comme parfois plus sérieuse, mais tout autant irréel, elle notait tout de façon mécanique sans relever quoique ce soit. Je croyais qu’un jour quand ça irait tout à fait bien, je pouvais arrêter les médicaments, comme si l’on devait finir par être guéris. Pris en défaut d’argument, d’imagination inconsciente et face au silence, je finissais par vouloir me séparer d’elle. Avant cela, sous sa directive, j’effectuerais le test psychologique de Rorschach, avec des formes dessinées, chez un autre médecin qu’elle m’indique mais que je ne connais pas. Pour faire le malin, heureux de l’intérêt que je suscitais, je vais m’ingénier à ne rien voir dans les formes qui m’étaient présentés, je n’évoquais uniquement qu’une feuille pliée en deux, avec de la peinture maculée, je ne m’attardais que sur la caractéristique technique du dessin pas son évocation subjective imaginative. Le rapport écrit du médecin était très difficile et peu élogieux sur ma personnalité. Comme j’avais l’impression que ma relation avec le docteur Cousin n’évoluait pas, je souhaitais ne pas aller plus loin avec elle. On m’indiquait un autre médecin, le docteur Cassanier qui lui était neuropsychiatre, c’était un homme d’un certain âge au ton adulte et bon, nous discutions de beaucoup de choses, les espérances professionnelles, la famille, les excès du cannabis, il me m’était en garde de ne pas trop en abuser, nous allions même jusqu’à évoquer le parricide, il m’écoutait attentivement, puis à chaque fois à la fin de la séance, il avait une phrase rassurante. C’est pourquoi, elle était revisitée sous tous ses aspects dans un contexte où il n’y avait pas de tensions mais je pensais que c’était inefficace. Concrètement, qu’est-ce que c’était ce type de dialogue, est-ce que c’était un chiffre qui permettait d’espérer et où on s’observait beaucoup, peut-être qu’il se disait simplement que ça se passe ailleurs mais pourtant, c’est un ensemble et ça veut dire qu’il fallait passer à un système, il allait me permettre de devenir ce que je voulais être. Les psychiatres, la conversation, ils l’a font si bien que sur la question des qualificatifs, si on vous juge comme vif, vous commencez à devenir nerveux et je recommençais tous les quinze jours. Je pensais que les médecins pouvait lire dans mon esprit mais aller à l’hôpital, ce n’était pas le bout du périple, d’ailleurs, on va parler de ce lieu avec un peu d’amertume mais malgré les rumeurs, ils n’en étaient pas encore là et ce n’était pas si mal d’avoir des grilles de lecture sur ce sujet dans le cadre de l’hospitalisation et il n’y avait que ça qui m’intéressait quand j’étais là-bas. L’imaginaire du patient est plus fort que l’image qui en est faite car c’est très rare quand un psychiatre m’a passionné, d’être impressionné par sa conclusion et ça me permettait de m’amuser doucement. C’était pourtant orchestré dans un cadre rigide où la plaisanterie n’avait pas sa raison d’être et je le déplore. Ce serait à la Une, ça deviendrait officiel et l’espoir serait de retour mais si tu baisses les bras, docteur, tu me faisais honte même dans un scénario et une interprétation impeccable. Car pour retracer ce combat obsédant quand c’était à la fois, une période tragique, bien évidemment, mais aussi joyeuse car sans soins, on pouvait en mourir du jour au lendemain et je propose quelque chose à partir d’une réalité, comme une arme d’émancipation, qui inventerait l’art de l’assemblage entre la psychologie, la thérapie et l’humour, ce qui aurait comme résultat de dédramatiser la folie.
A Dreudan
En deux mille quatorze, à l’âge de vingt-huit ans ans, j’obtenais l’allocation adulte handicapé et je passais du RSA à la MDPH, comme un ascenseur social qui serait au combien, fabuleux, en changeant de statut et de montant. En attendant, c’est mon beau-père qui prend sa retraite et je devais quitter Paris pour suivre mes parents à soixante kilomètres de Paris à Dreudan dans les Yvelines, où ils avaient une résidence secondaire. Sans avoir le choix, d’ailleurs, car ma mère ne voulait pas se séparer de moi. De toute évidence, je n’étais pas heureux car je ne supportais pas la vie de province, tout en étant isolé. Commence ici le sentiment de frustration et d’impuissance face aux évènements. Mon problème va se reporter vers mes parents que je jugeais responsable de ma situation, puisque la première des réactions était de trouver un ou des responsables. Dans le cheminement mentale ont fait des hypothèses qui reste parfois, sans réponses, on les abandonne ou on trouve parfois des réponses pour soi mais lorsque qu’on les confronte avec le réel on est déçu et c’est un nouveau bénéfice final négatif, un de plus, me direz-vous. Je vivais un quasi-désert affectif et professionnel, la vie parisienne et ses activités palpitantes qui ne se résumaient toutefois pas seulement à la drogue me manquaient. Officiellement, j’étais soigné pour mon sommeil, je croyais selon un mythe urbain de junkie que j’avais fait un « bad trip » sous LSD, drogue que j’avais eu l’occasion de prendre aussi et que depuis, je n’étais jamais redescendu. Il était hors de question que j’aille jusqu’à Paris pour trouver ma dose de h, je devins ainsi contraint à un sevrage total de drogue. Mes occupations restait la télévision et je travaillais sur mes applications web, je ne jouais plus à aucun jeu vidéo, la plupart du temps, j’étais sur Internet à lire, ici et là et je travaillais sur des projets qui représentait des nébuleuses logiciels. Néanmoins, j’avais besoin de médicaments et si j’arrêtais mon traitement mes nuits blanches étaient longues et après n’avoir dormis que deux heures, j’avais tout oublié. Donc, sous l’influence familiale et la contrainte thérapeutique, je voyais un psychiatre à l’hôpital de Dreudan pour l’ordonnance, le docteur Poupard. J’avais eu l’occasion de faire aussi une batterie de test psychologique, cette fois-ci sur des séquences d’expression sur l’imagination, je redoublais d’effort pour trouver dans ce qui m’était présenté avec des idées. Je m’étais dit que cette fois, j’allais en donner de la signification plus que pour les premiers tests, car j’avais le sentiment que c’est ceci ce que l’on attendait de moi. Dans le souci d’être utile aussi, car j’avais en tête que grâce à mes réponses, je faisais progresser la médecine, un peu comme un cas fabuleux qui aurait fait découvrir à quelques professeurs une anomalie qu’il serait bon de cataloguer. Un malade merveilleux. Dès lors, commence le sentiment d’impuissance face à ce qui imperceptiblement se mettait en place, personne ne m’a dit, personnellement ni à mes parents ce que j’avais, jusqu’à présent. La camisole chimique était lourde jusqu’au plus profond de mon intimité et sur ce détail, on devait faire le deuil du plaisir totale et ce n’étais pas très drôle. Je rêvais de jours meilleurs tout en n’ayant pas de solution valable, la famille s’adaptait le mieux qu’elle le pouvait sans non plus avoir de réponse, l’institution n’en a pas non plus, le docteur Poupard gère la situation, comme un gestionnaire, se calfeutrant derrière le principe de précaution. Principe qui consiste à gaver de médicament le patient pour l’assommer et éviter tout problème entre ce dernier et la vie civile. La responsabilité du médecin est ainsi protégée.
Un jour, scrutant les chaînes de la télévision numérique terrestre, je tombe par hasard sur une émission télévisuelle qui était consacré à la schizophrénie : « Le journal de la santé ». Michel Rymhesse et Marine Sarrière ont interviewé des psychiatres et des patients. J’apprendrais par la suite que cette émission avait soulevée des polémiques car Michel Rymehesse craignait la réaction violente que pouvaient avoir un malade schizophrène, quand on le mettait en face de ses réalités. Ils avaient l’un et l’autre hésités à la produire. C’est nouveau, les témoignages sont nombreux et les explications assez claire. Je m’identifiais à eux. C’était mon parcours, c’était aussi mon histoire. Un psychiatre expliquait qu’au dix-neuvième siècle, les médecins, constataient que des jeunes personnes entre seize et vingt-cinq ans avait des propos incohérents, ils étaient délirants on les enfermait et sans soins à l’époque, ils finissaient par mourir très jeunes. Je vais m’intéresser de près à cette maladie mentale avec ce que je trouve sur Internet. C’est un problème de dopamine, une molécule secrétée par le cerveau dans les neuro transmetteurs qui entraîne une surexcitation cérébrale, des délires, des croyances erronées, parfois des hallucinations visuelles ou sonores. Les médicaments soignant ce type d’affection étaient cités, ils correspondaient pour certain à ce que m’avait prescrit le docteur Poupard. Je ne prends pas cette nouvelle comme un choc mais comme une libération, en effet, j’étais dans l’ignorance avec la désagréable sensation que l’on sait ce qui est bon ou mauvais pour vous en vous laissant dans le doute. En apprenant par moi-même ce qui me rongeait, la cause véritable de mes nuits blanches, je finissais par être rassuré en me disant et bien finalement, ce n’est que ça. Dans les documents que je consulterais sur le net, j’apprendrais que l’élément déclencheur de la maladie a été sans doute provoqué par l’usage de cannabis. Il existait un terrain propice à la maladie et la drogue, l’élément déclencheur ne m’avait pas loupé. Forcément, j’en parlerais au docteur Poupard, il m’expliquera, plus tard qu’il n’avait pas, me concernant fait une analyse précise. Qui croire ? Est-ce possible une ordonnance sans diagnostic ? Des médicaments sans maladie ? Suis-je oui ou non schizophrène ? Autant de questions qui seront posées et dont les explications du docteur Poupard deviennent incompréhensibles car trop technique, il se refusait à être définitif et il est évident que je n’étais pas un spécialiste aguerrie. Autre raison, j’avais le sentiment que j’étais un cas parmi d’autres et qu’il ne voulait pas « s’embêter » avec moi. Sans doute, estime-t-il que je n’étais pas apte à comprendre avec des schémas plus simples ou des explications. Une sorte de cognitif limité qui était propre à la maladie. Sans doute, cette conversation, il aurait préféré la partager avec des collègues plutôt qu’avec le problème. Toutefois, je ne pouvais pas croire que ce n’était pas chez lui, une intention délibérée et comme on disait dans le langage populaire avec l’idée de « noyé le poisson ». Ce qui avait pour effet et c’était simple à comprendre à vouloir renforcer sa position de sachant, plus dominant encore. Puis, un hôpital, c’est grand, il y a de nombreux malade et autant de cas de figure qui représentait des statistiques rationalisables. Autre raison, c’est l’infantilisation que le statut de malade entraîne, il était orchestré par toute l’institution médicale qui allait de la gestion d’un lit par l’aide-soignante tout comme le professeur qui vous annonce la déclaration d’un cancer incurable, alors imaginons un malade mentale à tendance schizophrène dans son parcours du combattant sur un terrain des opérations qui s’affiche au fur et à mesure qu’il progresse. Pourtant avec Internet et les nombreux documents multimédias qui y étaient stockés et qui concerne la santé mentale, on pouvait penser qu’une certaine transparence était opérationnelle, ma curiosité fut nourrie, certes, mais ce qui était prépondérant c’était la volonté de vulgarisation qui avait été mis en place dans les médias. La télévision vous indiquait, là où il fallait chercher, Internet précisait les maux dont vous souffriez, il ne manquait plus que les médecins pour vous indiquer à quelle heure le traitement était adéquat. Il y avait la volonté de savoir pour le patient et pour mieux faire avaler la pilule, on responsabilisait, en allant plus loin que le seuil de la maladie qui une fois qu’elle est acceptée, rendait plus docile le patient. La seule alternative face à mon désespoir professionnel, sociale et affectif, c’est ce que me proposait le docteur Poupard : l’hôpital de jour et j’accepterais de m’y rendre, une fois par semaine.
L’hôpital de jour
Je devais rejoindre l’hôpital de jour de Dreudan en juin deux mille quatorze Depuis de nombreuses années, j’avais développé un sentiment d’infériorité, dans la structure familiale d’abord, puis scolaire, puis professionnelle, à cela s’ajoutait une désocialisation dû à l’isolement de mes années à rester avec mes parents. J’ai vécu les premières années à l’hôpital de jour, très bien. J’avais enfin l’occasion de me confronter à une population diversifiée avec des pathologies et des niveaux de connaissance différents, présente forcément, une équipe soignante avec un « turn-over » important. Je vais réaliser un journal de façon autonome, « Gravity Zero », comme un clin d’œil à la maladie, entretenir des relations humaines, me comparer, me jauger, me mesurer. Je comprenais très vite, d’une part, que mon niveau de culture n’était pas ridicule, que j’avais un vrai savoir-faire et par ailleurs, je réaliserais un site Internet et de nombreux visuels. Dans ce climat, évidemment, je m’épanouissais, je travaillais sur mes sites et applications chez moi. Mon psychiatre va mettre en place des modules d’informations audiovisuels fournit évidement par les laboratoires. Une fois de plus, c’est la gestion du malade schizophrène se faisant à travers son acceptation qu’il est malade et qu’il mérite des soins. C’est très caricatural, il y a, à la fois des acteurs et des vrais patients, je n’apprends pas grand-chose, pourtant les débats qui accompagnent ses séances sont intéressants et me font progresser. J’obtiens la reconnaissance travailleur handicapé, je vais m’inscrire à Handi Emploi, je rechercherais un emploi dans mon secteur de l’Internet sans succès. Je finirais par abandonner mes recherches, le schizophrène dyslexique doit avoir très mauvaise réputation chez Handi Emploi et les entreprises du domaine en nombre réduit sur Dreudan.
Mon beau-père
Dans le quotidien de mon beau- père qui ne voyait qu’en moi qu’une sorte de malade dont la santé mentale devait se situer entre l’autisme et certains aspects de la démence. Il me savait être un passionné d’informatique, lunaire, sans conversation et imprévisible dans ce que je laissais entrevoir de mes relations avec lui. Néanmoins, sans affect, ni sensibilité, il semblait s’être toujours comporté comme un tiroir-caisse avec l’intérêt bien compris que s’il me maintenait dans un confort matériel qui se voulait cajolant, il asseyait le caractère attentif et bienveillant à son bonheur que lui portait ma mère. Dans la vie courante, il m’ignorait aisément mais je représentais l’élément qui devait véhiculer de bonne relation entre lui et ma mère, le vecteur indiscutable. Pour ça et pour rien au monde, il n’aurait enfreint cette loi qui voulait que dans son autorité de femme indépendante, ma mère ne veille plus sur lui. Comme un roi magnifié, conscient du devenir de son royaume, il s’acquittait pécuniairement et moralement du minimum avec moi.
Mon cadre de vie
Avec les ressources dont je disposais, mon beau père se réservant le droit de ne m’offrir que le gîte et le couvert, mon allocation représentait un argent de poche somme toute considérable et que dans cette situation, je devais d’une part survivre assez bien tout en faisant vivre par ma condition au sein de l’hôpital, le système qui s’entretenait. C’est qu’il en fallait des emplois dans une société dont les rouages devaient être huilés comme une montre Helvétique. Et fort d’un zèle exacerbé, cette même société faisait fructifier cet appétit public dans l’une des plus maigres des allocations.
Pour celui qui ne doit que se vêtir et se distraire c’était largement suffisant mais des distractions j’en avais peu, tout mon argent passait dans l’achat de matériels informatiques et bien que j’aie gardé peu de relations avec mes anciennes connaissances, je possédais un Dphone 6X. Depuis mon adolescence, j’avais pris pour habitude de m’habiller avec des vêtements très solides que je pouvais garder plusieurs années. J’étais conservateur jusque dans mes choix vestimentaires et je disposais de différentes paires de DockTeens, ces chaussures, à l’origine orthopédiques ou de sécurité, elles étaient devenus des références pour tous les marginaux du monde entier, de type skinhead, ou punk, ou appréciant la musique ska puis ce fut une véritable marque de fabrique pour toutes les jeunes générations qui ne voyaient pas tourner le monde de la même façon que ses aînés, ensuite avec le temps et la notoriété, elles étaient devenus les incontournables dont il fallait avoir au moins une paire. C’était certes un peu fastidieux à chausser, en raison de la hauteur qui prenait la cheville comme des bottines mais l’une en marron et l’autre noire, j’étais paré pour plusieurs saisons. Pour les vêtements, c’était tout aussi simple, j’avais dans ma penderie deux tenues, chemise et pantalon en jean noir, deux en gris, deux en bleu et ça s’arrêtait là. Mon accoutrement se contentait de l’uniformité propre à ceux que le fait de s’habiller ennuie prodigieusement mais qui malgré tout tentent avec une approche originale voire marginale de se démarquer, face à celui qu’il est susceptible de croiser au coin d’une rue.
Ma musique
Je n’avais pas de distraction pourtant il y a une passion qui m’occupais une partie du temps de mon cerveau disponibles dans la journée. Elle ne m’avait pas quitté depuis mes années à Paris et c’est avec plaisir qu’un nombre maximum de fois dans la journée, j’écoutais de la musique. Elle était présente à travers le fantasme qu’elle avait suggéré pendant mon adolescence et mes goûts n’avaient pas beaucoup évolué depuis. J’étais toujours dans la mythologie, comme dans une forme ancienne de croyance qui n’aurait pas ou qui n’avait pas beaucoup évolué. J’étais fan de rock et plus particulièrement de punk rock et de métal. Cette appellation de musique Métal, exprime peut-être les hauts fourneaux ou la mine, le marteau ou l’enclume, le métal ou sa fusion. Mais pour ce matériau qui conçu à partir de matière première résiste aux éléments mais pas toujours à la corrosion, j’imaginais une tout autre définition. Si on partageait le courant d’expression de ce type de musique en ayant même un faible bagage de musicien, il fallait mieux faire du rock métal par choix car sinon pour la plupart de ces artistes au talent relatif l’autre alternative consistait à devoir se rendre à l’usine et celle-ci n’était pas toujours sidérurgique. Ils avaient l’espérance de devenir un jour adulé comme le groupe planétaire Galactica et avoir la possibilité de vendre des millions d’albums. Si l’occasion ne se présentait pas, ils leurs restaient l’opportunité de penser qu’une consommation régulière de bière dans des sombres et confidentiels festivals d’Europe de l’Est, étaient une façon comme une autre d’oublier leur succès qui s’échappait vers le lointain, comme les gaz de leurs éructations qu’ils rejetaient bruyamment après avoir bu.
Je fréquentais les forums spécialisés sur le net qui m’informaient sur les groupes et artistes alternatifs qui existaient dans le monde. Les groupes, très nombreux en profitaient pour faire leur promotion et il n’était pas rare d’en trouver certain qui proposait avec un zèle dévoué à leur art, des sites web qui leur étaient consacrés. Cette gestion des modes de production de la musique que les membres ou que leur proche entourage avait favorisés, était une conséquence de l’arrivée d’Internet depuis plus de vingt ans comme support de diffusion. Grâce à cet état de fait, l’offre bien qu’inégale était importante et permettait de trouver à peu de frais des nouveautés et des morceaux gratuits. Ceux qui avaient du succès étaient faciles ensuite à trouver sur les plateformes de téléchargement des grosses sociétés du secteur.
Le groupe qui avait, à l’instant, la faveur de mes oreilles, était un groupe norvégien intitulé: Motor Grease, en français : Graisse Moteur. Ils avaient la particularité de faire jouer sur scène une « motocross » et de l’utiliser lors de concert, les paroles explicites sur les sports mécaniques ne laissaient planer aucun doute sur la catégorie des fans à qui leur album s’adressait. Parmi Les vidéo-clips qui étaient diffusée sur leur site, l’un d’entre eux avait attiré mon attention, il s’agissait de séquence tournée dans la lande que l’on pouvait supposer norvégienne. Les titres disponibles en écouté libre, soulignaient, des traits caricaturaux propres à cette population qui n’avaient pas pour habitude de se prendre trop au sérieux. « Mon ami le guidon », « Entre quatre planches » « Dos d’âne » étaient mes morceaux favoris.
Je ne portais pas les cheveux longs et j’avais un sens de l’humour plutôt sarcastique qui n’était jamais loin d’une forme de cynisme. Je ne me prenais pas suffisamment au sérieux pour me considérer comme métalleux et d’après ce que je savais sur le mouvement punk des années soixante-dix en Angleterre, je préférais ce look si caractéristique des mouvements de la jeunesse, plutôt que la longue tradition institutionnalisé des groupe de rock aux solos de guitare interminables et à la virtuosité de la post adolescence de quelques boutonneux, le buste courbé sur une Fender d’occasion et le doigt meurtri par des cordes en acier. Je préférais de très loin, le caractère bref, le choc brutal d’un morceau qu’on achève, le pas de danse sautillant, le verbe ironique du Punk Rock. Le metal et le punk-rock représentait une musique bruyante mais deux courants qui n’étaient pas du même acabit. Alors que le Métal n’était pas un phénomène culturel majeur comme le punk l’était. Pour le punk rock, même la récupération du mouvement à des fins mercantiles par des groupes comme Green Play, Stink-182 ou les Offweather dans les années mille neuf cent quatre vingt dix, ne fit l’ombre d’un doute et donna lieu à un dénigrement légitime. Il y avait deux façons de voir le rock soit vous étiez déjà un dinosaure qui se reproduisait de génération en génération dans les festivals de rock, tout en mangeant des algues, soit vous étiez un tyrannosaure, un animal prédateur prêt à tuer ses semblables pour les manger en cas de nécessité.
HDJ et vie dans l’hôpital
Depuis deux ans maintenant, je fréquentais à l’hôpital de jour, avec entre autre, des gens très simples et des plus évolués, le monde pour certains était tentaculaire, disproportionné et ils se débattaient en silence ou avec leur mots du quotidien, souvent avec les phrases de la misère et ces gens, on ne les voyait pas assez, on ne les soupçonnait même pas. On ne voulait pas les entendre, parce que la société aimait s’écouter dire des choses intelligentes. Il m’était arrivé d’entendre le message de la rancœur comme les plaintes des personnages qui maudissaient leur l’existence en vivant dans leur tête un supplice. Un supplice qu’ils ne savaient décrire. On pouvait penser souvent aux sans dents, avec des réflexions qui leur appartenait et qui pour certaines étaient complètement sidérante et qui ferait bondir des bourgeois bon teint. J’aurais voulu emmener une journaliste à l’hôpital de jour pour qu’elle vive une expérience de petite souris parmi les patients, avec cette misère qui était par exemple décrite quand elle est exotique dans les pays du tiers monde comme c’est le cas dans certaines émissions de télévision. Elle était moins agressive la pauvreté quand c’était à l’autre bout du monde et on finit par ne plus la voir quand elle se trouve à votre porte. J’aurais souhaité qu’elle la vive en immersion un mois pour constater ce qu’elle en pensait, je crois très sincèrement que nous aurions eu au bout d’un moment le même ressenti, la même impression et ça c’est en bas de chez vous dans la rue et vous les croisez dans la rue sans les regarder, de peur qu’ils ne vous adressent une parole. Parmi les patients, il y avait le chétif petit bonhomme qui vous posait systématiquement la même question quand il vous rencontrait, on lui répondait avec la même constance car lui faire sentir un agacement ou une hostilité quelconque serait stupide. Il vivait avec des revenus dont il n’avait pas conscience, sous le seuil de la pauvreté. Son allocation lui permettait d’acheter du tabac, c’est son seul loisir. Puis sans argent à la fin du mois, il était à la recherche de mégots dans la rue, puis, il les fumait. Les services sociaux lui avaient trouvé un appartement où il vivait seul, c’est mieux que de dormir dehors. Dans son studio, il écoute toute la journée la radio Passion FM et ces ritournelles nauséeuses l’avaient accompagné presque depuis toujours. Il traînait dans la rue et était ravi de vous saluer, c’était un divertissement qui brisait la monotonie. Il marmonnait des sortes de soliloques incompréhensibles, la tête baissée recouverte par une capuche de jogging délavée, les mains toujours dans les poches. Du côté des femmes de l’établissement, il y avait la fille mère. Elle a trente et un ans, sa fille était dans une famille d’accueil et ça valait mieux pour elle mais elle l’aimait quand même, elle n’avait pas eu d’autre choix que de l’abandonner. Elle vivait dans l’appartement où vivait sa mère qui est décédée, il y a quatre ans, elle restait avec son souvenir toujours présent qui l’a rassure. Comment maman aurait réagi à ma place ? Comment faisait maman ? C’est ce qu’elle se pose comme question, c’est ce qui transparaît dans une conversation. On la sentait inquiète, acculé, en insécurité avec ce qu’elle racontait sur son quotidien, c’est symptomatique de son caractère anxieux, toujours sur la défense. Elle vous aimait bien parce que vous êtes gentil avec elle, vous aviez un petit mot qui l’a réconfortait et ça ne portait pas à conséquence. On partageait un café puis un fait en entraînant un autre chacun s’isolait et il faut sortir de l’hôpital pour fumer. C’est le café puis après la cigarette, c’est l’occasion d’échanger un moment. Moi, je me suis arrêté de consommer tout ça, il y a un an.
Pandora
Parmi le personnel féminin, il y avait Pandora, une infirmière, elle était mignonne, certes. Elle le sait et si elle m’avait choisi sur le papier, il aurait fallu qu’elle se batte pour m’avoir. Mais elle ne se battra pas car elle était à des lumières de vous et elle joue à un jeu de dupe. Son rôle était trouble avec ses qualités plastiques, parmi la valse des patients où règne plus qu’ailleurs la pauvreté sexuelle. Etait-elle la chèvre qui invariablement faisait tourner la tête des célibataires aux testicules tombants. C’est ce rôle qu’elle endossait car sur ce plan aussi, elle avait besoin de vous sondez pour des raisons professionnelles. Ils étaient énormes dans leurs prises de paroles, c’est gros, c’est gras, dès qu’ils ouvraient la bouche pour vous ausculter verbalement. Mes attentes de conquêtes n’en étaient pas là, au même titre que mes espoirs de refaire ma vie, n’étaient pas ici, en tout cas, pas dans ces murs avec ses gens. Ce qui était plutôt drôle c’est qu’ils avaient tendance à me prendre pour un petit snob, ils se trompaient mais puisqu’ils le pensaient, je ne vais surtout pas leur laisser entrevoir autre chose, ils risqueraient une fois de plus d’interpréter. Si elle tombait dans mes bras, Pandora tant mieux, j’applaudirais à son arrivée, mais je n’y croyais pas une seule seconde, c’est une poupée de porcelaine au teins blafard et je ne faisais pas un geste pour provoquer quoique ce soit car je m’entendais très bien avec moi-même au cas où j’aurai eu besoin de me soulager. L’espérance dans la boite était rance comme une vieille orange, l’espérance était un vieux mouchoir dans ce dédale de pièces à l’air vicié par la chaleur des radiateurs électriques qui fonctionnaient à plein régime tout en ayant les fenêtres ouvertes. Mes réticences vis-à-vis de Pandora étaient nombreuses, alors s’engager un minimum était une prise de risque que je ne voulais pas envisager surtout dans un établissement hospitalier. A quoi bon s’investir, a quoi bon vouloir se distinguer, vous étiez jugé et traité à la même enseigne que le dernier des malades qu’il fut schizophrène, maniaco-dépressif ou qu’il s’appelait Marcel. On parle souvent du formatage de l’individu à travers la société de consommation, quel était le sujet de la santé qui était le plus parlant, encore plus que cette uniformisation de la société en strates où il fallait être ceci ou cela pour être un bon citoyen. Le modèle dans la santé passait par la performance sportive à travers l’effort dans les différentes infrastructures que l’on trouvait sur le territoire pour occuper les français de province. Parce que du sport dans les chaumières françaises et de Navarre, on en faisait pendant un moment et ensuite le sport, on le regardait à la télévision. Le stade de foot, la patinoire, le cours de tennis où l’on se tordait les chevilles ou les ligaments, ça aussi, ça faisait partie de la politique de gestion d’une société tout entière et c’était aussi un business comme les autres, régit par les lois de l’offre et de la demande. A quoi bon en faire des tonnes pour une société qui était un naufrage social programmé. On te voulait la mine réjouie, l’œil vif, le désir conquis, alors à chacun sa dose, à condition d’adopter la pose. Aucun doute à avoir, dans la santé, le modèle pour l’étudiant en médecine était le suivant : avoir une mémoire conséquente pour pouvoir apprendre et surtout retenir par cœur, il n’y avait pas de métier plus simple car il suffisait d’apprendre par cœur, mais je ne dis pas que c’était facile. Pour le sport, c’est l’entraînement qui détermine sa capacité physique. Que cela soit pour le médecin ou pour le sportif, c’est du travail entre dix-sept et trente ans. Dans ces deux cas de figure où se trouvaient l’intelligence, le discernement, l’éveil de la conscience, l’étincelle qui fait que vous sortez du lot plus que sur un simple déterminisme d’aptitude physique ou de capacité à mémoriser. Le sport, cette fille qui avait l’âge d’une jeune fille dans sa version moderne et qui en dehors d’un physique agréable ne m’avait pas subjugué par sa personnalité ordinaire, qu’est-ce que l’on peut en attendre pour la société idéale en dehors de se faire une ligne de conduite unique celle de n’avoir jamais à avoir à mettre les pieds dans un stade ou dans ces institutions de santé quelques soit la raison ou le motif. D’ailleurs, ma haine de l’institution était plus importante que mon investissement pour cette fille qui est supposée plaire et qui pouvait vite se retourner contre vous et je n’avais qu’un seul conseil à donner à tous les patients qui risquait de succombé à son charme vénéneux c’était « recul camarade que l’histoire te digère ». Je ne retenais qu’une chose dans ces lieux hantés par le souvenir de pauvres hères, c’est que mon temps était volé, mon précieux temps que personne ne me rendrait, alors que la chèvre était un animal charmant et le chèvre n’était juste qu’un bon fromage à déguster à la fin du repas.
Injonction médicamenteuse
Je reprenais le chemin du code, pour mettre à profit les derniers jours qui me séparait d’une transformation chimique de mon cerveau. Je ne savais pas comment je serais dans quinze jours, dans quel état j’allais être et avec qu’elle pensées mais physiquement à la même place les pieds sur le bureau et le clavier sur les genoux, me donnant toute entier à l’expérience de l’écriture du code informatique et à la sacro-sainte « thérapie » par le médicament, l’Ostie du malade, selon les épîtres de Finosa seigneur tout puissant du marché de la pastille, du bromure et du produit antivirus. Je ne pouvais y échapper et la médecine mentale et la religion ont ça en commun, la même ambition vertueuse et suffocante qui établissait que c’était pour votre bien qu’elle était prescrite, en psaume ou en comprimé. Pour autant, le motif était soupçonneux et dans la cours de récréation, j’avais eu l’audace de dire une fois « pan, t’es mort » en plaisantant à mon toubib. Dans sa paranoïa extrême de psychiatre, il expliqua dans un rapport que de nombreuses fois, je l’avais menacé de mort. Ça ne me dérangeait pas que l’on me prenne pour un crétin mais il y avait des limites et du statut de provocateur plaisantin au singulier, j’étais devenu sous sa plume d’expert en reconnaissance des âmes, un dangereux serial killer multi récidiviste. Je ne pouvais penser une seule seconde qu’il m’avait prit au sérieux, c’était débile mais considéré au pied de la lettre. Comme je n’étais pas convaincu par sa déontologie qui, pour l’avoir à mainte reprise constaté, restait à géométrie variable, comme l’homme d’église avec l’au-delà, on pouvait supposer que sa démarche récriminatoire avait un caractère de provocation étendu, ce qu’il devait pouvoir me renvoyer à la figure et au-delà dans mon cerveau avec moult substance étrangère au nom aseptisé de Bepanote et Foxapak.
Je me considérais comme stabilisé par une injection en intramusculaire mensuelle de tranxelion 150 et de deux comprimés de Foxapak 25 quotidien, ce régime je le tolérais bien depuis huit mois. Désormais, avec la nouvelle ordonnance, je devrais passer à six Foxapak 25 et deux Bepanote 500 par jour plus le tranxelion mensuel, donc plus que de tripler la dose avec ce qui devient pour l’occasion une posologie pour une baleine. Génial, si je puis dire, mais je n’ai pas trop compris ce qu’ils voulaient démontrer, peut être que le légume bouilli était plus onctueux et plus tendre que le légume cru. Je ne voyais que cette hypothèse car uniquement ce que je pouvais remarquer c’est que cette injonction thérapeutique, arbitraire et autoritaire allait nuire à mes douces habitudes d’indépendant. Soyons clair et tachons d’être précis, les deux comprimés de Foxapak je les prenais actuellement au coucher, ils avaient un effet soporifique qui m’aidaient à trouver le sommeil et de deux, j’étais censé passer à 6, avec des prises de deux le matin le midi et le soir donc je risquais de passer de mon lit au canapé et du canapé à mon lit pendant toute la journée. J’allais quand même entre les deux essayer d’écrire un peu de code, si j’y arrivais. Avec le Bepanote 500 pour en avoir déjà pris de façon occasionnelle, j’avais toujours ressentie un vague à l’âme récurent au bout d’un jour de prise et puis après l’avoir arrêté, j’avais partagé une émotion nouvelle comme un sursaut d’une humeur enthousiaste au bout de trois semaines. Curieux comme sensation. D’ici le mois d’avril, avec ce traitement, je devais avoir un autre permis de conduire car il n’était valable que pendant deux ans car j’étais soumis, accrochez-vous bien à la « protection » administrative, c’est-à-dire une hospitalisation d’office ou H.O. Par conséquent, je devais passer sous le regard avertis d’un toubib pour qu’il valide ma capacité mentale et physique au fait de pouvoir conduire un véhicule. Compte tenu de mon nouveau traitement, aucun médecin sérieux appliquant le principe de précaution, remboursé à cent pour cent par la sécurité sociale, selon l’affection listé, ne prendrait la responsabilité de me laisser conduire une voiture. Avec ce traitement de cheval, j’aurais eu d’énormes difficultés à conduire d’ici avril et ensuite plus de permis, génial, ils étaient forts ces toubibs, ils pensaient vraiment à tout. Comme je n’aurai plus de véhicule, je devrais me rendre à l’hôpital de jour qui se trouvait à une dizaine de kilomètre en voiture ambulance et ce au minimum une fois par semaine, génial la sécurité sociale allait pouvoir donner du boulot à un chauffeur, au lieu de me rembourser le prix de mon essence, ils sont fort dans l’administration, ils pensent vraiment à tout, un altruisme écolo sociale sans doute. Et bien merci l’état ou bien merci pour lui parce que si on devait commencer au départ le moindre crétin vous expliquera que c’est de ma faute, si j’en étais là.
En résumé, comme il fallait s’y attendre, le traitement était pour une bête fauve de six cent kilos. Je l’ai testé pendant un jour et comme il était trop imposant, j’ai dû négocier avec mon psychiatre. Il avait été très pédagogue en m’expliquant que j’étais un schizo affectif, ce que j’admettais volontiers, ce qui n’est pas plus rassurant. Il avait précisé son propos avec un discours médical audible et compréhensible. J’avais des hausses et des baisses de sentiments et nous sommes revenus sur une base de relation plus « acceptables ». Il avait fait des compromis, moi aussi, tout ça autour de la table des négociations et j’étais un grand garçon responsable, merci docteur pour votre mansuétude et votre indulgence de ne pas m’avoir pris pour un cas social irrécupérable, un cassos comme il était dit dans le langage populaire ou un débile profond, maintenant pour lui, c’était plus clair et je pouvais comprendre mais si on m’expliquait seulement. C’est vrai que maître de son image, on pouvait vite en devenir victime et je jouais la carte de la transparence mais aussi parce qu’il fallait bien se confronter au monde et il n’attendait personne lui. Mon psychiatre le docteur Ziberski, était un professionnel, on pouvait s’entendre, ce qui n’avait pas été encore le cas car il n’était en fonction que depuis septembre. J’étais stabilisé et je le serais encore avec un tout petit peu plus de traitement, un petit cachet de Bepanote en plus avec deux Foxapax et l’injection mensuel de tranxelion mais là, je ne le vivais plus comme la punition du piquet et les douze litres d’huile de foie de morue à prendre impérativement. C’est en tout cas, la manière dont il m’avait fait avaler la pilule. Terminé la dose excessive, prescrite il y a quinze jours, maintenant elle me permettait de vivre à peu près normalement, enfin, je le croyais. Pour l’hospitalisation d’office, il n’était pas exclus qu’il la lève et son objectif m’avait-il dit, c’était le retour du patient dans une vie sociale quasi normal et professionnel, il était temps car j’avais des compétences et autant qu’elles servent. Je risquais de faire le bénévole dans une association car le tissu des entreprises était trop frileux pour donner du travail à tout le monde. Ce qu’il y avait de terrible et c’était là que c’était agaçant c’était qu’en octobre deux mille quatorze quand j’arrivais à l’hôpital de jour et pour obtenir la reconnaissance travailleur handicapé, j’écrivais un « projet de vie » de a à z et les thèmes qui y étaient abordés étaient quasiment tous les mêmes que j’exposais à mon psychiatre, depuis peu et d’ailleurs, un infirmier m’avait dit à propos de ce texte à l’époque qu’il était exceptionnel et il aurait fallu que j’attende deux ans pour finalement que l’on puisse envisager que je fasse profiter mes compétences et au-delà sortir enfin de l’hôpital. D’accord, on pouvait se dire qu’il y avait deux ans, je n’étais pas prêt sur le plan du travail, le suis-je d’ailleurs ?
Chapitre 4) La vie professionnelle
Bachier
J’avais passé une partie de mon enfance à faire la guerre avec Bachier dans des jeux vidéo. Désormais, il travaillait pour Dataxim une société américaine filiale de Computersoft. A force de mourir pour du faux, cela avait fini par créer des liens qui n’avaient pas d’équivalent dans la sphère professionnel que nous partagions. Vers quinze ans nous nous étions perdus de vue et la vie avait séparé notre rude amitié, faite de pixel et de sons midi. Je n’avais aucune affinité politique avec lui, il me faisait penser à un petit soldat, un guerrier tenace mais bas du front. Epais, fier et obséquieux, vis-à-vis de la hiérarchie qu’il vénérait plus que tout. Il était plus âgé que moi d’un an et trois mois et parent très tôt, il avait ce côté paternaliste propre au gens qui marchent au pas car il m’appelait en présence de tiers « mon petit pote ». Les amis qu’il fréquentait étaient marqués par les histoires de terrorisme informatique des « anonymes » de l’armée électronique Syrienne, ou encore par l’action de Julian Brassage et de ses démêlés avec la NSA, à travers Speaknet, l’organisation non gouvernementale lanceuse d’alerte. Vers dix heures, j’avais terminé mon café et j’envoyais un mail à Bachier pour savoir s’il était libre pour le déjeuner. Il me promit que nous partagerions un moment sur Skoopy, l’application de partage vidéo. Un océan nous séparait entre Charlotte la localité de Caroline du Nord où il se trouvait et la maison parentale des Yvelines. En fin d’après-midi le son de la webcam retentit, c’était lui. Il me parlait tout d’abord de son voyage prochain dans le désert pour assister à la réunion de toute la « geek culture » du monde dans le cadre annuel du « Destroy man ». Puis, je lui ai expliqué les dernières modifications de mon site sur l’Internet, la version gratuite sur le web qui rassemblait des conseils et des programmes écrit en langage Javascript. Sympathique, il fit semblant de s’y intéresser. La routine algorithmique d’un programme à partir de calculs fractals suscitait, chez lui, quelques questions qui après coup, devaient m’interpeller. Le langage utilisé était une couche plus simple à utiliser que le javascript, de l’angular qui demandait toute de même une certaine compréhension de la complexité du code. Bien que j’aie abordé ces langages à la lecture de différents ouvrages, les questions de Bachier me troublaient un peu et je répondais à côté, surtout, il y avait ce que l’on apprenait sur les bancs des écoles ou de la faculté et ce qui faisait votre vie professionnelle en entreprise et là c’était une autre musique. Techniquement parlant, je n’étais pas à son niveau. Lui, était spécialisé dans les problèmes de sécurité des réseaux et je n’étais pas toujours sur la même longueur d’ondes et je ne comprenais pas toujours sa façon de résonner, j’en concluais que ce devait être à cause de mes médicaments. Il n’y avait qu’une chose qui comptait, le site web était en place et j’attendais les internautes. Par la même occasion, j’entamais une autre bière en lui expliquant mon approche commerciale de Mixos, mon application pour mobile de micro-blogging par image graphique retravaillé. Le principe était simple. Il s’agissait de fédérer les utilisateurs autour d’une idée centrale et de créer d’autres idées en intégrant une image que l’on pouvait dessiner ou une photo que l’on pouvait retoucher. Les internautes disposaient ainsi d’une galerie d’idée qui rebondissait à la dernière création finale de l’image retravaillée. J’ai besoin de ses services, il suffisait qu’il me fasse un peu connaître à travers les moteurs de recherche et il connaissait bien cette technologie qui consistait à créer des liens en piratant le moteur de recherche Getworld. Bachier n’a pas d’avis sur mon projet, il écoutait en posant de sporadiques questions à intervalles réguliers qui n’avaient pas un caractère déterminant. Il fallait que j’obtienne les lumières de Bachier, il le fallait absolument comme un cas de force majeure, une rage de dent ou un bubon sur le front. Pour que ça démarre enfin ou sinon, considérons un peu mieux, puisque, mon site vient d’être terminé et que je devais être présent sur les moteurs de recherche les plus populaires dans le monde. C’était indispensable pour mon avenir. Deuxième bouteille de bière, la négociation continuait. Je lui cède vingt pour cent de mon hypothétique future entreprise, si je suis présent avec trente mots clés sur les robots Getworldbot, Mumbot, TchangSpid et kwuwant le moteur de recherche français. En terminant sa salade de fruits en barquette plastique translucide, il a fini par me dire qu’il acceptait, la bouche encore pleine. J’étais heureux qu’il fût positif à la transaction, je savais qu’il était occupé avec un projet sur lequel, il ne s’était que très peu étendu. C’était un adepte de « la perruque » comme on le disait dans le milieu, c’est-à-dire qu’il profitait du matériel, du savoir, des locaux de l’entreprise où il travaillait pour mener à bien des projets personnels, ça faisait partie de l’univers libertaire des informaticiens défricheurs de frontière des années soixante et soixante-dix. C’était dans la culture de l’entreprise comme ce qu’avait fait Getworld avec ses vingt pour cent d’activité libre .Tout ça était établit et courant. Dans la culture de l’entreprise, on était droit avec le client mais capable de toutes les fourberies avec l’utilisateur lambda ou l’élément étranger à la société qui ne devait pas s’apercevoir de la duperie. Il y avait aussi une sorte de défis vis-à-vis de la communauté des développeurs, de son rejet comme de son acceptation, c’est pourquoi, il fallait se dépasser et travailler toujours plus, quitte à se concentrer sur des projets extra- entreprise. La « company » fermait les yeux car on avait décelé une stimulation chez ce type de salarié qui pouvait à terme faire progresser aussi la boite. La multiplication des échanges avec Skoopy pendant la pause repas en était déjà un exemple, largement encouragé. Selon des principes appris à la faculté, la communication devait être complète et plus le répertoire de visioconférence était important plus on avait la possibilité de progresser par l’échange, car quand on butait sur un problème technique, les idées extérieurs de la communauté des développeurs, pour le résoudre étaient souvent les bienvenues.
Gratuit sur Internet
Sur Internet, tout ce qui était gratuit devenait louche car même quand ce fut gratuit, on pouvait faire de l’argent avec votre seul présence, non seulement Internet était un gruyère qui rapportait à de grandes sociétés internationale beaucoup d’argent mais l’argument, il vous le mettait bien profond dans un coin de votre crâne, c’était gratuit. Gratuit mais, si je sais, qui tu es et que tu vas sur le site a, b, et c, il y a des chances pour que tu achètes ça, ça, et ça d’ailleurs cette information, tu vois, petit bonhomme, je la revendais. De la même manière que si tu aimais regarder les blondes, tu avais toutes les chances pour les aimer encore plus avec de gros seins, le pubis rasé et dans des positions soumises. Si on voulait aller plus loin mais c’était encore dans le domaine du possible dans notre bel société consumériste, il y avait de fortes chances pour qu’un jour débarquait ce genre de colis chez toi, il devait connaître tes goûts, tes humeurs, ton carnet de santé et le jour où la machine ne sert plus à rien, elle ne se laisserait pas faire pour rentrer dans le vide ordure. Ainsi allait le monde sur Internet, les fournisseurs d’accès pouvait savoir tout de toi, mais aussi l’épicier d’en face, parce que ce n’est pas la caméra qui t’espionne quand tu ouvres ta télévision, c’est toi qui était espionné quand tu allais sur « porno habitude point super bandante » jusqu’à ce que tu trouvais dans ta boite mail un message de « total chèvre point super bandantes » et jusqu’à ce que des « amis » te présentait dans la vie réelle «chèvre un peu timide mais qui aime les membres viriles point plus mariage si papa est riche », alors tu ne devais pas te tromper de cible, va au plus précis. Car tu croyais être anonyme ? Tout le monde te regarde. Parce que le monde de mille neuf cent quatre-vingt-quatre et de Kafka, c’est un conte de noël par rapport à ton histoire sur Internet.
Internet et Fatbooker
Fatbooker, la société de Mark Fikerboorg avait opté pour une prise main facile dans les options basiques que le site proposait, son utilisation était simple et en quelques minutes, tout à chacun pouvait créer sa propre page. Il suffisait de se laisser guider intuitivement dans les fonctionnalités qui s’offraient à vous pour qu’ensuite, celui qui en désirait plus et avec un peu d’acharnement fasse d’une page personnelle une redoutable machine de communication. C’était, à la portée de tous, ça ne reposait que sur le temps qu’il fallait y passer et ainsi devenir un spécialiste de son maniement. Ainsi, les gens qui avaient un accès à Internet dans leur large majorité se posaient dans l’air du temps et naturellement ils « étaient » sur Fatbooker, un peu comme si l’on fréquentait un quartier à la mode, comme une destination, ou qu’un restaurant exotique venait d’ouvrir ses portes et qu’il fallait y être absolument pour être remarqué, pour faire parler de soi ou échanger avec des gens que l’on connaissait ou pas. Au départ, il n’était pas rare de trouver sur les réseaux sociaux des gens de la société civile ou de la vie politique, avec une notoriété grande, moyenne ou en cours d’accroissement. Ils avaient la sensation de défricher un terrain neuf et plein d’inconnu, ils se confrontaient avec les fans, les militants et avec leurs lecteurs ce qui découplait leur enthousiasme à vouloir plaire toujours plus, pour vendre plus d’albums ou plus de livres. Puis sous la pression de l’époque ce fut une obligation d’être sur les réseaux sociaux, d’avoir sa page Fatbooker, son compte Swittech, son profil Ostomgrom. Quand la mode serait passée ou que le commun des mortels disposera de son compte Swittech, ils jureront que ces nouveaux outils abrutissent les masses, alors qu’ils n’étaient qu’une forme individuel et institutionnel de promotion généralisé Le téléphone mobile aidant à cette émancipation de l’usage d’Internet ce qui entraîna, que quasiment dès son premier téléphone portable en main l’individu avec sa galerie « d’appli » comme on avait nommé récemment ces logiciels, gardait le contact sur Internet. Le réseau mondial était le lien avec l’autre, le cordon ombilical qui refusait d’être coupé pour des millions d’utilisateurs, dans les restaurants les transports en communs, comme pour le migrant à l’affût d’un rêve européen. Toute ou quasiment toute la planète s’échinait à « pianoter » sur son écran à la recherche d’une idée ou d’un sentiment qu’un article, qu’un commentaire, qu’une image pouvait susciter. La société mondiale en partie cherchait le bouleversement à travers la communion humaine et pour cela, elle avait trouvé le moyen de photographier son assiette, de se moquer de son chat ou de s’étriper avec des analyses acides. L’époque vivait la dictature de l’émotion et le soubresaut de la dernière idée en date. On avait remplacé le graffiti par le commentaire, on avait renouvelé le portrait de peinture commandé par le selfie, on avait changé l’éditorial par le tweet répété, la tribune par la page Internet. Mais sentant que le risque de changement fondamental était circonscrit, l’ancien monde et notamment le monde des médias s’avait que cela représentait le changement dans la continuité, le transfert d’un support à un autre et le court-circuit des réseaux de distribution des biens et des services. Il suffisait seulement de refaire « une mise à jour » pour y voir plus clair et s’adapter au nouveau monde que les américains, peuple pragmatique s’il en est, sous leur houlette, avaient mis en place. C’est pourquoi, assez vite, les quotidiens et les hebdomadaires sous la pression de l’érosion du nombre de lecteur de leur version papier s’empressaient de sortir des éditions numériques. La multiplication des médias et la peur de la manipulation sur Internet entraînait une suspicion massive sur la véracité de l’information et ce sont les médias traditionnels qui gardaient la confiance du citoyen au final. Il était tout simplement évident qu’Internet n’avait été qu’une fringale qui reposait avant tout sur des notions de services informatiques, de jeux, de commerce et d’outils de communication. Certain disaient, on peut tout faire avec Internet et dans ce cas-là on avait à terme même plus besoin de sortir de chez soi. Tout cela, avec une assistance complète des besoins que l’on pouvait inventer. Les américains et les anglais avaient suivis pendant des années cet axe de la « nouvelle » économie, pendant les années deux mille, ils espéraient en tirer tous les bénéfices à l’échelle planétaire.
Oui, je devenais bon, je m’améliorais grâce à Internet et je recherchais des idées mais pas des moindres et pourtant je n’avais pas bu. Pour celui qui savait faire parler de lui et qui préparait également les questions sur les forums, le but, c’est que l’on apprenne de nos erreurs et que l’on évite de les répéter. Mais pour pouvoir s’exprimer sur les Internets, la prochaine étape pour une prise de conscience à l’échelon mondiale de ses libertés numériques et défendu si cher par la constitution américaine, là aussi, tout pouvait arriver. En tout cas, les américains étaient bons en coffre-fort et ils figuraient bien dans l’album mondial mais qui auraient voulu être à leur place ? Car pendant le déploiement par phase du réseau des réseaux, moins on en disait, mieux on se portait et après avoir tenté la politique de l’attaque frontale, les activistes de l’Internet s’étaient reportés sur un réseau mondial juxtaposé à l’Internet, du nom de Tor. Parce que je pense que ça ne servait pas à Bruxelles ce genre de service après-vente qui revendiquait la liberté sur l’internet classique et que bâtir un compromis face aux Etats-Unis, ce n’est pas un petit problème. C’est peut être un petit peu secret et à la fois, il n’y a pas d’hystérie et c’est du concret. Avec quelques recherches, vous étiez bientôt sur une entrée libre et avec de la malice, j’étais au centre puisque ça donnait la parole à ceux qui habituellement ne l’ont pas.
PJP
Je reçus un mail de Bachier en Pretty Jest Privacy, plus connu sous le nom de PJP un logiciel open source de cryptographie dans lequel était stipulé une adresse Internet, elle désignait un site d’origine russe, je le remarquais en raison de l’extension du nom de domaine en point ru. Il précisait dans son message les usages pour avoir la possibilité de découvrir la partie non publique du site en question.
« Pour fouiner sur le service, je te donne quelques explications : Il faut rester cinq minutes au moins sans recharger la page d’accueil et ensuite cliquer sans t’arrêter sur l’image qui désigne un vieux micro-ordinateur des années quatre-vingt, celle avec la légende « old good 386 sx seize ». Au bout de huit clics répétitifs, tu dois atterrir sur l’un de mes sites sur le réseau Tor. Je vais t’avouer quelque chose, sur ce site, tu trouveras mon application « Airtrack » et je trouve cela tellement explosif que je ne peux me résoudre à le publier sur la toile, directement, tel quel. Et puis j’estime que dans la forme ce logiciel n’a en aucun cas besoin d’être modifié. Il te va comme un gant et pour tous ceux qui y apparaissent, de près comme de loin. Je te contacterai pour les moteurs de recherche ».
Il signait en bas du message Skrik. Je bu une gorgé de café et relus le message une seconde fois, siffla trois petite notes entre mes dents et cliquait sur le lien qu’il m’avait communiqué. J’arrivais sur un module de connexion à un espace membre, mais pour accéder au site, il fallait, tout d’abord s’inscrire et suivre le lien : « entrez maintenant ». En fait, l’identifiant et le mot de passe en crypté étaient inscrits dans une base de donnée avec un cryptage sur le mot de passe, l’identifiant était stocké dans la base mais le mot de passe, lui, n’était pas stocké dans la base de données tel quel, c’est son cryptage qui y était stocké. Une fois complété, on accédait au « deep web » l’Internet secret avec les liens « local » ou « service » il fallait cliquer sur « service ». Parmi les menus et les données inscrites sur la page, on trouvait, des logiciels pour Linux en grande majorité, mais aussi pour Swingdoors dans de moindre proportion, il y avait également, des modules de transformation d’IP qui étaient très en vogue pour celui qui espérait vouloir surfer sur la toile officielle de façon anonyme. Egalement présent des ouvrages de références en ligne sur les hackers et autres activistes du web, je repérais un livre du Pi du net, intitulé « Tor, le deep web interdit ». Pour ce dernier, tu devais remplir les champs avec une adresse mail, puis un clic sur « envoyer » et tu récupérais un mail personnalisé avec le contenu du livre avec une préface de Jérémie Bimmerdann. En recherchant plus sur le site, je découvrais dans la liste, le fameux logiciel « Airtrack » et complètement intrigué par le message de Bachier qui me revenait en mémoire, je le téléchargeais. Dans ce soft, une fois installé, pour ma version de Swingdoors 7, dans l’entête, je trouve le titre « capture » et aussitôt mis en fonction, tout le spectre radio qui circulait entre ciel et terre apparaissait sur l’écran. Les fréquences exprimées en Mégahertz étaient présentées sous la forme d’un tableau qui indiquait si le réseau était ouvert ou fermé. En scrutant les données, je repérais, parmi les informations, les ondes de télévision et de radio, celles de l’armée, des hôpitaux et de la gendarmerie, mais aussi beaucoup d’autres et en particulier, des réseaux privés de type wifi. Le champ des fréquences commençait à 26.065 MHZ de la CB à plus de 960.00 MHZ qui correspondait au téléphone mobile GSM, avec une amplitude que je jugeais importante tellement la liste était impressionnante. Je me focalisais sur les réseaux privés des particuliers dont les crêtes de puissance étaient les plus élevées. Ensuite, en les sélectionnant, je pouvais récupérer pour certain, en temps réel, l’intégralité des informations qui transitaient des terminaux aux ordinateurs. Par cette porte ouverte évidement, j’avais aussi un accès à toutes les supports de stockage. Je choisissais particulièrement le réseau wifi de notre voisin dont la maison juxtaposait la nôtre, signalé, avec la dénomination suivante: Duchaussout242.
Examen des dossiers des filles Duchaussout
Ce n’était pas que je fus maladivement curieux ni obsédé par l’existence de mes voisins mais j’avais l’impression qu’ils semblaient me narguer avec le bonheur qu’ils affichaient lorsque, je le croisais lui ou sa femme et ses deux adolescentes. Ce bonheur simple d’un couple unis avec leurs deux véhicules, travaillaient l’un et l’autre et la dénomination du terme paisible s’appliquait pour chacun d’entre eux individuellement comme au pluriel quand ils étaient réunis. Les Duchaussout, je les connaissais à peine, ils étaient discret et apparaissait comme une famille modèle, trop modèle à mes yeux. Pour ce début de soirée l’envie me prit de rentrer dans leur intimité numérique, je voulais savoir à quoi ressemblaient leur joie, leur peine sur le vaste champ d’investigation que représentait l’Internet. J’étais à la recherche de sensation nouvelle, avec une soif de découvrir les centres d’intérêt d’une famille de France qui avait un train de vie raisonnable bien qu’un petit peu plus élevé que la moyenne.
La connexion établie, je récupérais l’intégralité des disques durs des deux ordinateurs de la maison puis, je m’attaquais aux quatres téléphones portables. Vers minuit, j’avais établi une sorte de tri parmi les fichiers que je jugeais sans intérêt et me concentrait sur les répertoires, les boites mails et sms, les documents en pft, les fichiers textes, les historiques de navigation Internet, sans oublier, les photos et les vidéos de chacun des appareils. J’isolais chaque terminaux avec leurs données respectives et lorsque j’identifiais chacun des utilisateurs, je leur donnais des noms de dossier: papa, maman, tata et toutoune. Ayant peur que je ne sois découvert, dans une montée paranoïaque qui surgissait dont on ne sait où, je me déconnectais de leur réseau et alla dormir quelques heures.
Après une nuit un peu lourde et réveillé vers cinq heures, je reprenais un autre Foxapak pour finir ma nuit. Vers neuf heures trente, j’émergeais enfin, un peu léthargique, l’œil en partie voilé par une fatigue molle qui perdurait légèrement. Mon café ingurgité, j’entreprenais de consulter en détail, les informations que j’avais récoltées la veille. C’est dans l’ensemble des dossiers que je me promenais le curseur de la souris lent de celui, ou celle, qui recherche sans savoir à quoi s’attendre. Très vite, je me demandais qu’elle âge pouvait avoir les enfants Duchaussout, j’estimais environ à dix-sept ans pour la fille aînée et treize pour la cadette, je pouvais me tromper mais pas de beaucoup. L’examen attentif des messageries des adolescentes ne le confirmait pas, mais j’avais cette estimation en tête, pour les avoir vues faire du vélo dans la rue ou accompagnées par leurs parents. Dans la boite sms de Toutoune quasiment rien qui concernait l’extérieur, la correspondance était surtout concentré entre elle et sa mère, on pouvait lire venant d’elle, des messages du petit quotidien, comme de penser à prendre du pain en rentrant de l’école ou de ne pas s’attarder, après son cours de danse, ce genre de message récurrents dans les semaines qui s’étirait depuis la date de mise en service du téléphone était une conversation ménagère entre une mère et sa fille avec rien de très étonnant. Je me dis qu’après tout, il fallait s’y attendre et que chaque âge avait sa raison, je ne pouvais rien y trouver de très intéressant dans une relation épistolaire en grande partie ménagère de cent quarante signes entre une mère de quarante ans et sa fille de treize. Les liens qui unissaient la fille plus âgée et les parents semblaient avoir un caractère plus orageux. L’adolescence étant un passage un peu « conflictuel » dans la vie de parents, comme on le disait sur les plateaux de télévision dans les émissions de la deux, l’après -midi, animé par Sophie Savand, les rapports qui faisaient le quotidien de cette toute jeune fille avec l’apparence d’être posé et bonne élève révélait toutefois dans sa relation avec les autres un caractère sec et peu espiègle. Il y avait dans ses sms toujours à la fin comme un leitmotiv, une dernière phrase qui situait bien le personnage, le « merci quand même ». A la fois la reconnaissance et la compassion d’avoir fait un effort pour elle, comme une pointe de mélancolie qui devait expliquer que malgré tout elle était dans la négation de la question qu’on lui avait suggérer mais qui laissait la supposition que la prochaine fois, elle accepterait peut être. Ceci avant l’émoticon de rigueur en guise de signature, ce qui était normal pour un individu de cette génération qui était quasiment née un téléphone portable à la main. Elle ne pratiquait pas les abréviations auxquelles on pouvait s’attendre mais ces messages étaient courts, laconiques et tout aussi bref qu’un texto puissent être par son format. On sentait qu’elle avait du caractère, avec un tempérament qui s’appuyait sur le matérielle des choses de sa vie qu’elle entretenait avec les gens de son âge comme avec ses parents mais dont les messages étaient plus rares. Nombreuses, étaient les demandes formulées par ses camarades pour sortir au cinéma ou ailleurs, un mercredi ou un samedi. Elle refusait presque systématiquement en prétextant qu’elle devait réviser ou terminer un exercice venant du lycée. Elle semblait se consacrer uniquement aux études comme si elle voulait échapper à sa condition de lycéenne pour ensuite prendre son envol avec comme destination le monde du travail.
En fin de matinée, l’observation minutieuse et attentive du reste de leurs dossiers se poursuivait toujours et ma concentration devait se porter sur les connexions établies entre les ordinateurs de la maison et le monde de l’Internet. Je me déplaçais, presque sur chacune des pages qui avaient été consultés depuis deux mois ce qui me prit un temps considérable. Pour une grande partie, cette navigation avait eu lieu sur le site Fatbooker, les deux enfants ayant respectivement leur propre page à leur nom. Evidemment, ces deux adolescentes se posaient comme leurs camarades de classe dans l’air du temps et naturellement, comme tous, ils « étaient » sur Fatbooker.
J’avais terminé les dernières modifications de Mixos. Au final, je me disais que l’intégration d’un modèle complémentaire s’avérait inutile car mon application dans sa version DroïDos était opérationnelle et le site en place dans sa phase définitive. Je m’offrais deux jours de calme complet sans télévision. C’était le calme et le silence qui s’offrait dans sa totalité. N’ayant rien à faire de particulier je finissais par chercher la tâche, la mission à accomplir. Ainsi, sans savoir trop quoi faire, je me plongeais dans l’examen rigoureux des documents des deux époux.
Le dossier de Sylvie Duchaussout
Dans le dossier de Sylvie, c’est ainsi qu’elle se prénommait, je découvrais quelques traces de lien concernant des recherches à caractère médical. L’étude approfondit des liens et des moteurs de recherche indiquaient son intérêt sur certaine maladie bénigne de la peau. Elle visitait aussi beaucoup le site Docti-si-senior avec des sujets comme irruption cutané, bouton, bubon et autres détails du même genre. Son répertoire prouvait qu’elle connaissait de nombreux praticiens et son agenda sur son téléphone contenait de très nombreux rendez-vous, j’en conclus par déduction que son métier devait être commercial ou visiteuse médicale pour un laboratoire pharmaceutique et qu’elle était amenée à rencontrer beaucoup de médecins à des fins professionnels. La répétition exagérée de ces rendez-vous excluait une pathologie ou une maladie qui l’aurait assaillie. Elle devait leur vanter les bienfaits d’une pommade ou d’une crème, voire d’un médicament.
Renseigné par les informations que j’avais pu récupérer concernant l’épouse Duchaussout, je finis par me résoudre à penser que la chasse aux données la concernant devait s’achever car j’en avais fait le tour. Il me restait le second ordinateur que j’avais localisé sur le réseau, son dénominatif était Duchausout Phillipe., je m’attaquais à sa consultation et je disposais de temps devant moi, trois heures avant l’heure du dîner. Je plongeais à la tâche comme on plonge dans l’inconnu, intrigué tout de même que cette machine ne disposait pas d’un firewall qui m’aurait empêché non seulement, de parcourir mais aussi de récupérer, les précieuses informations que l’ordinateur pouvait contenir.
Le dossier Duchaussout
La première des impressions qui me sauta au visage fut que cet ordinateur était une machine de bureau, probablement un portable bien que je n’étais pas assuré des éléments matérielles qui composait la machine, sa configuration resta un mystère mais l’examen des données m’en dit beaucoup plus car je devais découvrir, non seulement, toutes une série de clichés d’antenne et de radars de toutes sortes, mais aussi des images d’instrument électronique que je n’avais pas su identifier et qui étaient aussi présentes. J’étais très curieux d’en découvrir plus et je parcourais ces photographies en les observant avec une grande attention. Sur certaines d’entre elles, je pouvais découvrir Duchaussout en compagnie d’autres individus et dont la série portait le nom de Kourou accompagné de l’année deux mille deux, avec un numéro d’ordre. Après les images qui m’avaient intriguée, je consultais les numéros de téléphone dans le répertoire. A la lecture des documents issue du traitement de texte que contenait le dossier, je compris aussitôt que Duchaussout travaillait pour le ministère de l’intérieur. J’observais des notes de services et de la correspondance avec le sigle de la DGSI accompagné par le coup de tampon qui désignait la date et la mention « secret défense ». La DGSI ou la Direction Générale de la Sécurité Intérieure était le service de renseignement du ministère de l'Intérieur français. Ce service était chargé sur l’ensemble du territoire, de rechercher, de centraliser et d’exploiter le renseignement intérieur intéressant la Sécurité nationale ou les intérêts fondamentaux de la nation. Sur les lettres qui lui étaient adressées, que je parcouru rapidement, je remarquais qu’elles s’exprimaient dans le jargon caractéristiques des agents de la fonction publique et plus particulièrement ce langage, au vocabulaire si propre aux militaires, ce fut pourtant à peu près compréhensible même pour un non-initié comme moi. Sur un fax, qui retint, en particulier, mon attention, l’expéditeur était le préfet de Seine et Oise. Il demandait à Duchaussout des traces vidéo sur un individu. Des informations très précises était données sur le profil du l’homme en question et des dates où le suspect avait été susceptible d’être à son domicile. Assaillie par une soudaine curiosité, j’allais aussitôt voir dans le dossier vidéo et commençais, l’épluchage en règle des documents audiovisuels. Je ne trouvais qu’un fichier, il ne pouvait s’agir que de celui dont le préfet avait demandé l’examen pour ses services. Je l’ouvrais et je découvrais, plus qu’une simple vidéo, une sorte de logiciel qui ressemblait à un jeu de simulation. L’image aux teintes vertes donnait l’impression d’avoir été filmé par un hélicoptère de combat. Ce type de vision par image thermique, qui permettait de voir la chaleur dégagée par des corps en pleine nuit. Par ailleurs, la fenêtre était criblée d’élément informatif avec une fonction précise. Il y avait des chiffres qui précisaient des coordonnés de position dans l’espace, des lettres qui devaient correspondre aux points cardinaux, plus d’autres composantes que je n’arrivais pas à identifier. A l’aide de la souris, j’observais en détail l’application, l’image n’était pas statique, elle relatait les déplacements d’un personnage sur une période donnée, il était tout simplement possible de l’observer sur l’ensemble d’une journée et ce, dans chacun de ses agissements. Je me suis aperçu que l’on pouvait accéder, en plus, des quatre points de vue de l’hexagone à des positions de caméra vue de haut et de bas. Dans la pièce, était disposé des meubles visibles en 3d. Cette scène était de l’image de synthèse en trois dimensions reconstituée, les détails du corps comme du visage de l’individu étaient indéfinissable car il était recouvert d’une texture uniforme de couleur sombre qui agissait comme une enveloppe. Cette masse représentait la silhouette et au niveau de la tête reposait une pancarte numérique qui semblait être comme attaché à l’homme dans tous ses déplacements, elle le suivait comme aimanté. Un clic sur celle-ci, me fit comprendre qu’elle correspondait à une page d’information avec pour fonction de renseigner de manière assez détaillé, l’individu, comme une banale carte d’identité. L’homme à son domicile se préparait à dîner et avant cela, fit la vaisselle. L’entrechoquement des assiettes et des couverts sur l’évier en inox animait la scène muette. Ça ressemblait à un jeu mais avec ce caractère militaire très accentué, on ne s’était pas complait dans des détails graphiques, c’était solide, efficace et ça fonctionnait bien. L’image apparaissait comme irréelle, pourtant il fallait se rendre à l’évidence, il se cachait dans ce logiciel, une arme redoutable.
Stupéfaction
Je restais là, assis devant l’ordinateur, ébahie par ma découverte, sidéré par ce que j’avais découvert. Il ne fallait pas s’y tromper, j’avais ici, en face de moi, un authentique moyen de surveillance dont la capacité liberticide ne laissait planer aucun doute. Je fis le rapprochement qu’entre les images d’antenne et l’application, on pouvait procéder à une sorte d’imagerie à résonance magnétique et par là même à une triangulation des données dans l’espace et ainsi acquérir une image animée en trois dimensions des individus, un peu à la manière d’un aiguilleur du ciel dans une tour d’aérodrome qui observe des avions sur une piste d’atterrissage. A la lecture des multiples documents, mes soupçons ne firent que se confirmer, il y avait là, d’autres demandes qui concernaient la mise en fonction de relais antenne. Les fréquences étaient signalées dans le spectre des ondes radios réservés à l’armée mais ce que je compris également, c’est qu’il existait tout comme les espaces d’ondes de téléphone portable des zones d’ombres, où le signal était faible voire inexistant, l’intégralité du territoire semblait ne pas être sous contrôle. Au fur et à mesure que je réalisais l’ampleur de ma découverte, je compris que mes gestes étaient peut-être, scrutés, analysés, si toutefois, on en avait fait la demande. Lisant en détail l’un des documents, il était mis en avant que la prochaine étape concernait l’informatisation complète du processus pouvant automatiser la tâche de surveillance, c'est-à-dire que des machines devaient à court termes, analyser vos agissements sans avoir besoin du regard d’êtres humains. La moindre de vos paroles pouvait être sujet à contrôle dans un système opaque où la démocratie n’avait aucun droit de regard. L’état n’avait pas dévoilé son secret mais laissait ses acteurs les plus éminents se servir de ce système. Indolore pour le plus banal de ses citoyens, il n’en était pas pour autant sans conséquence, des conséquences dont j’avais du mal à cerner les limites, tellement ma stupeur était grande sur l’instant. La peur d’être découvert se rappela à moi et je décidais de faire une copie des éléments sur une clé USB de tout ce qui concernait la famille Duchaussout, ensuite j’effaçais un à un, les dossiers situés sur mon ordinateur.
Chapitre 5) La prise de conscience
Le dîner avec les parents
J’essayais de faire abstraction sur ce que j’avais découvert chez les Duchaussout et au dîner avec mes parents et je me gardais bien d’évoquer le sujet. Ils étaient à mille lieux d’envisager l’étendu de cette histoire et j’avais pris pour habitude de rester le nez dans mon assiette pendant que nous regardions le vingt heures de David Osniatos, le présentateur du journal de la deux, ne relevant la tête uniquement que pour demander un morceau de pain ou du coca. Pendant tout le dîner mon esprit était ailleurs, ma mère m’a trouvé un peu pâle et tant qu’elle ne s’intéressait qu’à mon teins ou de mon appétit tout allait bien. Une considérable partie de la conversation fut réservée au chien alors que David expliquait la perte du pouvoir d’achat ou le frémissement du marché de l’immobilier. Le chien, un caniche abricot à l’haleine fétide et au poil devenant jaunissant avait développé une boule de graisse sur son flanc gauche. Le vétérinaire s’était empressé de préciser à ma mère que ce lipome bien qu’il n’avait pas un caractère surprenant pour son âge avancé, ne représentait pas un danger pour ce frêle animal dont les jours étaient, toutefois, comptés, au grand dam de ma mère qui était attaché à cette bête comme s’il s’agissait de son second enfant.
Je remontais dans mon gourbi sitôt la dernière gorgée de café terminé pour ruminer la suite que ce que j’allais donner à ma truculente investigation. Devais-je en parler à Bachier ? C’était dans la sphère d’Internet mon seul homologue et c’était grâce à lui et à son logiciel que j’avais réussi à pirater Duchaussout. Si je lui en parlais, aussitôt, j’aurais été découvert et je pouvais risquer une condamnation car toute la planète du web l’aurait su et à mes dépends. En plus, cette histoire était tellement incroyable que moi, le petit hacker du dimanche schizophrène depuis huit ans personne ne m’aurais cru, on se serait moquer de moi, j’aurais été la risée du web. Mes relations étaient peu nombreuse et si je m’étais égaré à partager mes investigations sur Fatbooker, il en était fini de moi, je risquais, d’une part, de ne plus être crédible et la pérennité de Mixos, je pouvais la jeter aux oubliettes. Bien qu’elle soit en place sur l’Internet l’application et le site restait vide d’abonné et de visiteurs, le retour sur investissement était nul, j’avais eu beau me consacrer tout entier à ce travail, je restais le bricoleur du dimanche avec sa petite application qui ne remportait aucun succès
Le secret
Mais comment garder un secret pareil ? Je dormis peu cette nuit et à grand renfort de Foxapak vers deux heures du matin, je finissais par fermer un œil. Cet imbroglio ne me lâchait pas, cette situation confuse et embrouillée dans ma tête ne me permettait pas d’avoir une vision saine du problème où s’entremêlait à la fois des notions de raisons et de liberté qui me dépassait. J’avais une certaine prise face au réel mais pour autant, je n’en restais pas moins schizophrène avec sa pathologie de malade mentale. Je perdais contact avec la réalité ou je courrais après elle car pendant toute la matinée, je fus replié au fond de mon lit en tachant de trouver une solution. Qu’est-ce que je pouvais bien faire ? Fallait-il parler ? Fallait-il se taire et tout oublier ? Qu’est-ce que je risquais ? Qui pouvait me croire ? Toute cette histoire était tellement incroyable. Devais-je en parler à mes parents ? Que pouvaient-ils faire pour moi ? Sans doute avaient-ils une solution ? Je me tournais et me retournais me débattant dans mes draps comme dans un linceul sans avoir de réponse.
Sortant enfin de ma torpeur et par la même occasion de mon lit mais avec toujours en tête mes interrogations, je descendais en peignoir déjeuner avec mes parents. Je trouvais un prétexte pour expliquer cet état de fait qui m’avait fait traîner toute la matinée. Suspicieuse mais étrangement silencieuse, ma mère ne releva pas cet incident qui était toutefois assez rare. Après le repas, je m’habillais sans passer sous la douche et je décidais de reprendre en détail les informations récupérées chez Duchaussout et stockées sur le périphérique USB. Je n’y appris rien de très nouveau, ça ne faisait que confirmer ce que je savais déjà, néanmoins, cette étude approfondie m’a permis de connaître avec précision les multiples rouages de ce que je devais appeler le projet de « télésurveillance »
Entre deux lampé de coca je n’arrêtais pas de me poser des questions sur les conséquences et les aboutissements que représentait un projet pareil. Mon esprit était captif d’un procédé qui dépassait tout ce que l’on pouvait imaginer en termes de surveillance. Cette omniprésence du système s’arrêtait-il aux frontières de l’Europe toute entière ? Le monde entier était-il également sous contrôle ? Etait-ce un réseau fermé ? Est-ce que seul l’Etat avait accès à ces données ? Car la surveillance était monnaie courante sur le réseau Internet, avec votre adresse IP vous étiez repérable, mais ici, il était question d’un système complet de surveillance automatisé qui allait bien au-delà d’un simple suivie d’activité sur le net. Ici et à chaque instant, si dans la vie réelle, je volais un œuf, on était en mesure de me repérer.
Un peu de technologie
Je savais qu’en matière de reconnaissance faciale les algorithmes commençait à être suffisamment performant pour détectés un visage dans une foule et lui assigner une concordance qu’il possédait en mémoire, les scanners faciaux étaient parfois utilisés dans les aéroports pour vous faire traverser une frontière. Dans le cadre d’une analyse des données systématiques inclus dans des bases d’information numérique, c’était la première fois dans l’histoire de l’homme que l’on assistait à une vision artificielle dont la fonctionnalité essentielle était de permettre à une machine, d’une part de faire l’acquisition d’images mais dont le second but était d’analyser de traiter et de comprendre l’image capturée. Il fallait souligner plusieurs choses prépondérantes dans l’approche d’un tel système. L'identification, qui consistait à déterminer l'identité d'un individu parmi plusieurs identités connues, présentes dans une base de données. Par ailleurs existait, la vérification, qui consistait à valider que l'identité prétendue était bien la bonne. Mais aussi la traçabilité qui veillait à ce que l’individu ne soit pas coupé de ces premiers moyens avec l’identification et la vérification, pour avoir constamment l’assurance que l’individu était bel et bien suivit par la technique de représentation.
Si, grâce à la magie d'une antenne radar, il suffisait de suivre une personne dans la rue pour connaître toutes les informations disponibles sur elle. Si la surveillance notamment policière était une nécessité inhérente à notre société, le mythe de la technologie incontournable, cette boite de pandore où seule reposait notre espérance devait désigner notre aptitude à défendre la démocratie.
Il existait donc un asservissement de la personne, toute entière soumise au regard des institutions militaire, juridique, policière, médicales et pourquoi pas politique.
La reconnaissance corporelle consistait à déterminer l'identité d'une personne à partir de son identité géo localisable. Pour cela, il était nécessaire que l'identité de la personne soit connue au préalable, au moyen d'un ou plusieurs passages dans un lieu particulier comme un sas ou un portique de sécurité.
On pouvait définir deux grands axes de ce type de vision par triangulation. La vision par ordinateur et la vision industrielle étaient des domaines qui se croisait ou qui se confondait assez souvent. La vision par ordinateur recouvrait la technologie de la représentation de l’image automatique, qui était utilisée dans d’autres contextes.
Dans tous les cas, l'image était parfois acquise dans des gammes de longueur d'onde que l'homme ne perçoit pas comme les infrarouges, les ultraviolets, ou les rayon x, ou encore à travers une paroi et parfois par des capteurs spéciaux, par exemple adaptés à des milieux extrêmes tels que l'intérieur de certaines installations sensibles.
Tout ce que je comprenais de cette affaire me dépassait. Je n’étais qu’au final qu’un pauvre petit schizophrène qui se perdait face à une information colossal qui le dépassait. Je n’avais pas les moyens, je n’étais pas suffisamment solide, aguerris face à l’ampleur de ma découverte. J’étais stupéfait que d’une manière aussi simple, j’avais réussi à pirater un ordinateur venant tout droit des plus hautes instances de l’Etat et des services secrets de la république. Quasiment au sommet du pouvoir, en tout cas, pas très loin de l’autorité suprême. Comment ? En ayant accès à un banal réseau domestique Wifi, j’avais pu entrer et récupérer des données marquées secret défense provenant d’un fonctionnaire qui ne devait pas être cantonné à un simple rôle subalterne.
Je n’en revenais pas de l’ampleur de ma découverte et j’essayais tant bien que mal de retrouver mes esprits mais le choc avait été violent. Bien conscient que si j’étais amené à révéler mon secret sur la toile, je mettais en danger ma liberté. Ma chère liberté qui dans mon cas ne correspondant pas à grand-chose. J’avais maintenant, une astreinte de deux jours par semaine pour me rendre à l’hôpital de jour et je ne pouvais y échapper. L’ambiance y était épouvantable et elle était bien relative ma liberté, soumis au regard des infirmiers observant le moindre de mes gestes, l’allusion de la moindre de mes paroles qui pouvait servir de précision concernant mon état psychique et avec à la clef soit me faire réintégrer un séjour long à l’hôpital psychiatrique, soit au risque de voir mon traitement à la hausse. J’étais aussi sous le regard des psychiatres et en étant porteur d’une pathologie suspecte, qui pouvait évoquer de la méfiance, comme quelque chose qui aurait été équivoque voire louche, je n’en n’étais que plus soumis à une attention soutenue, un intérêt rigoureux, de la part des « normaux » avec un traitement qui n’était pas anodin, loin de là.
Sur mes motivations
L’étendue de l’équation était conséquent et j’avais du mal à cerner les limites à ce problème qui était entier car même dans mes plus cuisants échecs, je me disais, que ce n’était pas grave, que j’allais rebondir, l’Eldorado était là avec le micro-ordinateur, Internet, Bill, Steve et c’était évident, la réussite, c’était pour demain, toujours pour demain. La surpuissance du schizophrène toujours, qui laisse cois évidement ceux avec lesquelles, je m’étais confronté et qui posait une interrogation car j’imaginais qu’un autre répondait à ma place, c’était tellement plus confortable pour les autres.
Ce site et cette application protéiforme, c’était avant tout du travail, une saine ardeur de travail de bâtisseur. Là, j’avais fait ce que j’avais pu, avec mes petits moyens mais j’avais tout donné et ça restait le travail d’un seul et non pas d’un groupe, si j’en étais fier ? Oui, évidemment. Je m’étais donné du temps à créer des concepts, ils donnaient le la d’une synthèse. Je ne savais pas ce dont j’aurais accouché, s’il avait fallu travailler en collectif, à deux ou à plusieurs. Mon niveau aurait-il peut-être été meilleur ? Je reste humble quand je regarde la concurrence, c’est souvent très élaboré, très bien maîtrisé et puis, ils sont avec des bagages de gens à peu près normaux, alors que je suis en informatique qu’un piètre programmeur, pas un chercheur ni un ingénieur. Le niveau qu’il soit sur le net où à la télévision, reste très professionnel et très élevés. Dans les émissions que j’aimais regarder sur News-Tv, ils étaient au fait de chaque détail, qui faisait la vie politique et celle des médias du monde entier. C’est normal, me direz-vous c’était leur métier l’information. Pourtant j’avais l’impression qu’ils étaient constamment en réunion de travail , car rien ne leur échappait, ils avaient toujours une attention en éveil et quand je constatais qu’Olivier Silnilsa maîtrisait parfaitement bien son sujet, tout le temps, lors des débats et des interviews et qu’il rebondissait sur chaque élément qui donnait sujet à des questions qui avaient été soulevé, en collant à la petite comme à la grande actualité, j’étais en droit de trouver ça bien. Ceci étant dit, c’était son travail parce que, là aussi, il s’agissait de travail avant tout, avec ce qui entraînait et animait un débat riche, foisonnant d’idée en France avec une question qui se posait sur le temps qui passait et une échappée, dans un contre la montre. C’était une course dans le dédale des politiques, des journalistes, de ses acteurs, de ses leaders qui faisait l’opinion, je ne retiendrais pas tout hélas, la mémoire était sélective.
L’ange ou le démon
Je restais dans mon grenier pendant toute la soirée, une chose qui m’était plutôt familière car je ne me donnais pas beaucoup d’occasion d’aller dehors, en particulier le soir. A Dreudan, après vingt heures, les bars étaient fermés et je n’avais pas d’amis. C’est ainsi que comme chaque soir ou presque, je partageais mon temps à regarder les programmes de « Débat du jour » en première partie de soirée qui réunissaient ce qui faisait l’actualité politique et culturel avec Marcella Dirisi et Ivan Taleb sur la chaîne du groupe Prenium, ensuite, je passais sur News-Tv, sa filiale pour regarder l’émission « Pour ne pas vous mentir » d’Elisabeth Haffnad. Le sujet du soir était stipulé au bas de l’écran : Getworld l’ange ou le démon. Parmi les invités, se trouvaient un ancien directeur générale de la firme, un auteur, deux journalistes et le secrétaire d’état à la nouvelle économie qui venait d’obtenir son poste, il y a peu, à la suite du dernier remaniement en date du gouvernement. Le débat fut riche de détail que je ne supposais pas à propos de ce géant du web. La partie qui devait me faire tressaillir le plus, concernait la récupération des données qui pouvait être faite à votre détriment et dans un usage complètement mercantile et à des fins exclusivement commerciales. Vous faisiez une recherche et immanquablement, elle était archivée dans la mémoire d’énormes ordinateurs sur lesquelles étaient stockés l’ensemble de la mémoire du web. Intéressé un moment par ce que je découvrais à travers les récits des protagonistes de l’antenne, je finissais par ne plus fixer mon attention sur ce que je percevais, car par vagues ininterrompues, je n’avais de cesse de penser au projet de télésurveillance et de ses conséquences. Je ne marquais mon attention que sur Elisabeth plus rayonnante que jamais et qui m’intriguait beaucoup. A un point tel que, j’imaginais très vite, qu’elle connaissait mon secret, à travers la relance et les commentaires qu’elle donnait dans l’émission de ce soir. A vingt-trois heures cinquante-cinq, elle fit une allusion comme à son habitude sur une photographie d’un député anglais en slip compromis dans une affaire de mœurs, elle commenta l’image de façon subtile, ce qui la concernant, ne devait pas m’étonner un seul instant.
Chapitre 6) La communication et les motivations
La TV et le PC Elisabeth
La télévision et l’ordinateur étaient quasiment, sans cesse allumés dans le grenier spacieux qui me faisait office de chambre. La plupart du temps, j’étais sur la chaîne d’information News-Tv, avec cette petite musique des intervenants qui m’avait accompagné pendant une partie de mon adolescence, elle me donnait une sensation de présence et j’avais survécu à ça. Pour celui qui regardait ou qui écoutait ce genre de chaîne quand un sujet important faisait l’actualité, comme, par exemple, des attentats, ou une catastrophe naturelle, les journalistes se répétaient sans cesse en continu, pour faire vivre avec le téléspectateur, l’évènement. Dans des périodes plus calmes, les nuances relatives aux informations étaient constantes, contrairement à ce qu’il en paraissait. En revanche, la publicité omniprésente, entrecoupée de jingle restait abrutissante et comme les campagnes duraient plusieurs semaines, en musique de fond, c’était plus dur à supporter. Les programmes du soir donnaient lieu à des débats dont les hommes politiques et des spécialistes venaient entériner une polémique ou faisait naître un sujet. Je remarquais, chaque soir à vingt-trois heures comment avec professionnalisme et esprit d’à-propos, Elisabeth Haffnad maîtrisait son débat avec ses invités. Son émission « Pour ne pas vous mentir » était très prisée des politiques, des journalistes et experts de tous les appareils du système français. Pour avoir consulté sa fiche Documédias à de nombreuses reprises, je savais que cette normalienne de trente-six ans, avait été correspondante à Washington pendant huit ans pour l’hebdomadaire Paragraphe Magazine. Née d’un père, ancien ambassadeur du Koweït en France pendant la période de la première guerre du Golfe et d’une mère Strasbourgeoise, cette femme au physique plaisant, avec des allures de l’actrice américaine Lauren Baccool à vingt cinq ans, avait été la compagne, pendant le temps d’un quinquennat de Marc Larivardière, ancien ministre de la culture et membre actif du parti des Rigoristes. Cette union n’avait pas fait long feu quand l’alternance eut lieu avec les présidentielles. Depuis, il avait refait sa vie avec la porte-parole de son groupe parlementaire de l’Assemblée Nationale, le député des Hauts de Seine, Nathalie Neuclos. Ça avait fait vivre une sérieuse déconvenue à Elisabeth et c’est lorsqu’elle reprit les rênes d’une émission qu’elle fit le deuil de Larivardière mais d’une certaine manière c’était sa revanche médiatique qu’elle prenait et au cas où il l’aurait totalement oublié, avant le générique de fin, elle avait toujours un petit mot, une petite phrase acide, quasiment indolore pour celui ou celle qui n’avait pas suivi attentivement son parcours. Cette note aiguë qui marquait chez elle un souvenir amère me faisait sourire à chaque fois. Cet humour à la fois aigre et piquant traduisait une personnalité vigoureuse quoique un peu rancunière et je me plaisais à imaginer connaissant leur trait de caractère à chacun, les liens qui avait rapproché puis éloigné le ministre et la journaliste.
Economie
Les débats de « Pour ne pas vous mentir » étaient débordant de richesses et ils collaient à l’actualité de façon très étroite, au fil des émissions, on pouvait dégager une certaine idée de ce que représentait la France dans ses aspects les moins flagrants. Ce que l’on pouvait en retenir, c’était qu’il ne faisait pas bon avoir peu de bagage lorsque l’on voyageait sur les chemins de la vie, parce que c’est la société toute entière qui te renvoyait l’image d’un médiocre ou d’un inadapté. En schématisant, il y avait deux sortes de gens, ceux qui ont fait des études et suivit un cycle normal avec une conscience précoce sur ce qu’il fallait entreprendre pour s’élever parmi les autres et ce distinguer, eux, avaient des emplois et puis il y avait les non ou peu qualifié, avec ou sans emploi. Les uns, étaient favorisés, les autres plutôt laissés à eux-mêmes, parfois ces derniers étaient instables et finissaient marginaux à la case prison. Les autres pour la plupart des honnêtes citoyens. Depuis dix ans, on avait créé quatre cent cinquante mille emplois dans la fonction publique en France, l’assurance chômage représenterait en deux mille dix-huit, un poids pour l’Etat de trente-cinq milliards d’euros, les entreprises privées n’avaient quasiment plus embauché pendant cette période et l’éducation nationale sortait du système cent cinquante mille élèves sans formation, sans diplôme chaque année, la religion islamique s’en était mêlée avec des attentats meurtriers. Le modèle à la « française » l’état protecteur devenait à la fois plus fragile et plus coercitif. Les autres pays d’Europe semblaient moins souffrir du manque de travail et en Angleterre on parlait de plein-emploi mais avec ce qui entraînait également des problèmes de précarité et des bas salaires. La classe dirigeante des biens nés et des sages, ceux-là dans le souci d’avoir toujours la paix et surtout ne pas à avoir à se confronter avec les autres faisaient tout pour maintenir l’ordre et l’alternance politique de décennie en décennie avait à peu près maintenu la paix civile depuis la révolution, ce n’était pas qu’ils étaient d’accord sur tout mais conscient que ce pays était la sixième puissance mondiale avec soixante-dix millions d’habitant, le compromis ourdie, manigancé l’emportait, sur les excités de droite comme de gauche et ses extrêmes, militants soldats ou seigneur de cartels. Donc, les gouvernements successifs avaient jugé que le peuple était pour en grande partie autiste et que le progrès allait changer la donne, avec la mondialisation, dans l’industrie et dans les services. Du travail, il y en avait eu moins, beaucoup moins et seul les plus courageux et les plus qualifiés en avaient encore. Alors, on a inventé la crise comme une cause réelle et sérieuse de raison. Il fallait bien trouver un bouc émissaire. Il y avait eu des guerres au vingtième siècle, il fallait inventer au vingt et unième, autre chose, alors ce fut la crise. Sur le plateau, il n’y avait pas d’antagonisme mais souvent deux lignes qui faisaient semblant de s’affronter et dont les discours convergeaient, l’un vers l’autre, vers la reproduction des élites, les intérêts bien compris et l’unité de la Nation.
Sur l’histoire de news tv et Premium
News-Tv avait vu le jour sur la télévision numérique terrestre en deux mille quatre, cette chaîne d’information n’avait eu depuis cette époque que peu de concurrent. Ils avaient établi leur succès sur une formule qui reposait à la fois sur l’éditorial et sur le rendez-vous des évènements avec de l’image à chaud. Leur slogan publicitaire dans les annonces télévisuel diffusée et qui mettait en avant la chaîne était : « Le commentaire de vos images ». La chaîne était déficitaire depuis la première année de sa mise en exploitation et son propriétaire le groupe Prenium Media mais chez les professionnel du secteur on préférait dire P.M, avait fait sa fortune dans la téléphonie et la communication ce qui était habituel dans ce type de groupe. Mais leur capital, ils le devaient aussi et surtout dans le domaine de l’Internet. C’était un groupe imposant et multimédia régnant sur Internet, la télévision, l’édition, et le téléphone mobile. Coté en bourse et capitalisé à hauteur de 20 milliards d’euros, tirant sa force de cette assise et suivant les directives des agences en conseils stratégiques américain, ils avaient choisi pour le secteur de l’Internet au début des années deux mille l’option des trois p, qui correspondait à Pharmacie, Pornographie, Poker. C’est ainsi, qu’ils étaient devenus la première plateforme de vente de médicament dans le monde francophone, les premiers dans le nombre de site pornographique publié dans le monde et pour finir, les premiers dans le secteur des jeux de casino en ligne. Parti au départ du simple constat que ces requêtes, des fameux 3P sur les moteurs de recherche étaient les plus fréquemment demandées, ils s’étaient attaqués au problème de façon rationnelle et rigoureuse avec une maîtrise qui s’était montré judicieuse et lucrative. De manière implacable et d’une grande dureté professionnelle où seul le hasard ne devait pas s’immiscer en ligne de compte quel qu’il soit, ils étouffaient leur potentiel client qui avait pu s’aventurer dans les parages d’une de leur entité. La synergie entre les filiales devant être totale.
La décision sur Elisabeth
C’est à la suite de cette émission que je prenais ma décision. Il fallait, absolument que je rencontre Elisabeth, il fallait que je lui explique ce que j’avais découvert. Bien que peu rapide et ça, je le devais en partie aux médicaments, j’avais pris ma décision, Elisabeth était la femme idéal pour partager mon secret. Qu’avais-je à perdre ? Elle saurait me conseiller et à deux, nous serions plus solides pour affronter l’Etat. C’était un leader d’opinion qui devait avoir un carnet d’adresse conséquent. Que pouvais-je redouter de cette femme, fine, forte et intelligente. Je ne savais pas pourquoi, elle m’inspirait confiance et je lui étais tout dévoué comme une icône orthodoxe sur le coin d’un mur, comme le portrait de ma femme, comme la mère de mes cinq enfants et ce cadre disposé sur votre bureau près des factures de mon entreprise centenaire.
Aussitôt, je fis des recherches pour trouver un email lui correspondant, j’allais sur le site de la chaîne et je trouvais une page Fatbooker à son nom et je commençais la rédaction de mon premier message avec une ambivalence que je me gardais bien de montrer.
Les premiers messages enflammés
Ma chère Elisabeth
Je vous écris, car c’est un immense besoin. Bien sûr, je sais que c’est ridicule d’entretenir un monologue vain et que cette lettre fera le tour de la sphère de vos proches. L’occasion de pouffer de rire, une nouvelle fois est sans doute trop belle, c’est un risque que je balaye d’un revers de la main, je n’en ai rien à faire. Ma démarche avec vous, c’est un coup de cœur permanent, du matin au soir, je pense à vous. Je vous écris et je vous écrirai tant que cela sera nécessaire, c’est plus fort que moi. Je suis bien persuadé que sur le banc des prétendants, je ne dois pas être le seul à vous écrire. L’amour n’a parfois rien de rationnel et je ne suis d’aucune logique.
Nous étions Jeudi il était minuit trente-sept et je postais mon premier message.
Ma chère Elisabeth
Je vous écris une fois encore, je suis bien conscient que cette lettre n’aura à vos yeux que peu d’importance. J’en prends le risque, je ne peux m’en empêcher. Résister est difficile et que cela soit en rêve ou réveillé votre souvenir me hante constamment. Pourtant, depuis vous avoir vu dans « Pour ne pas vous mentir », ma vie à radicalement pris un détour des plus curieux, je suis tout simplement tombé en extase devant mon poste de télévision, radicalement amoureux de cette jeune femme sincère et troublante qui a vite désarçonné un ministre comme un chef de parti par quelques vérités bien trouvés. Vous êtes charmante et pas simplement d’un physique merveilleux, mais une exception parmi les femmes actrice de la sphère publique. Je vous aime ! Qu’y-a-t-il de mal à ça ? Sans vous connaître mais le peu que je découvre me fait rêver, certaine nuit, je rêve de vous, mais c’est toujours trop bref, je me réveille et je suis charmé une fois de plus. C’est incroyable comme vous suscitez l’interrogation. Vous avez parfaitement distillé quelques informations, juste assez pour devenir la coqueluche des journalistes et des internautes, félicitations. J’ai, tout de suite su que vous étiez différente, un ovni parmi la basse-cour des gens de télévision. Néanmoins votre silence est tellement éloquent que s’acharner plus devient indécent. C’est un cruel dilemme que je ne peux résoudre seul, mon âme vous est dédiée, ma raison est préoccupée, harcelé par le doute. Voilà, c’était une missive de plus à votre jardin de cœur. Une lettre de plus à ranger dans le courrier des téléspectateurs amoureux. Ecrit, sans grand talent et à la première personne du singulier, dont le seul bénéfice aura été d’ouvrir le voile sur des heures difficiles mais amusantes qui ont jalonnés ce qui me retient à vous. Le style laisse à désirer mais les intentions sont bien là, veuillez ne pas en tenir rigueur dans la vie, sur le web ou ailleurs.
Au départ, dans mes lettres, je donnais mon avis et mes bons points, un peu comme si le dentifrice était resté ouvert sur le lavabo et je peste contre ma femme imaginaire pour autant de laxisme avec le rangement et avec la place des choses, parce que je suis un être hybride entre la culture qui est à gauche et l’entreprise qui est à droite, un gauchiste libéral. Un ministre du budget de 50 ans qui se verrait bien à L’Elysée. Tout à la fois un peu réactionnaire et un peu libertaire, à la fois chargé par des valeurs qui rassemblent en même temps la famille et qui donnerait le droit au mariage homosexuel, bien que cela ne soit pas le principe universel d’un homme et d’une femme.
Toutefois, je ne m’attendais pas non plus à parler dans le poste, je n’en avais pas la capacité, le sens des réalités ne me sont pas étranger. J’étais dans la position du joueur de loterie qui chaque semaine fait sa grille et qui ne sait pas s’il va gagner, ni combien, sept euros ou un millions ou rien du tout et il y a l’excitation du joueur, dans une addiction comme une autre.
Puis viendront une dizaine de message à la suite dont certains plusieurs fois par jours. Tout ceci se fit dans un intervalle d’une semaine, moments ou les nuits furent courtes et l’angoisse à son comble. Heureusement, j’avais emmagasiné une énorme quantité de Foxapak ce qui devait me permettre de moduler entre mon sommeil et mes angoisses. Je modulais sans cesse avec la maladie comme sur le fil d’un rasoir invisible, le tout avec le souci qu’à l’hôpital de jour comme au foyer de mes parents, rien ne transparaissait de mes funestes préoccupations.
Ma chère Elisabeth
Je prends néanmoins le temps de vous écrire, Comment faire autrement ? Vous êtes la plus belle femme que j’ai eu l’occasion de voir dans ma vie. Le saviez-vous ? Ça vous étonne ? Evidement le physique est une chose mais le reste est toute aussi extraordinaire, un véritable conte de fée. Je suis aussi bien conscient que votre vie ne doit pas être facile, jongler avec les journalistes, la rue, je comprends facilement qu’il vous faut manœuvrée avec précision et habileté pour vous protégez encore et encore, des ragots, des sous-entendus ridicules qui briseraient une réputation de femme bien sous tous rapport. Ce sont les petits problèmes qu’amènent la notoriété et qui vous font préférer et c’est tout à fait justifié, l’anonymat du Koweït.
Ma chère Elisabeth
Je ne cherche pas à vous nuire, je ne le pourrais pas. Je suis loyal et droit, n’ayez pas peur de moi. Qu’imaginez-vous ? Que je veux vous promenez sur les Champs-Élysées, faire la tournée des clubs de Paris à votre bras ? Allez au casino de Deauville en votre compagnie ? Que j’ai pu faire un pari minable avec quelques débiles ? De toute façon je n’ai pas d’amis. Que croyez-vous que je cherche ? Faire le crétin sur un plateau de télévision, la célébrité kleenex pour quinze minutes chronos ? Les querelles de clocher de la télévision me laisse froid. Au mieux, j’en souris. Je reconnais qu’au départ, c’est la vanité qui m’a poussé à être tant sûr de moi, ce sacro-saint optimisme orgueilleux dans le feu de l’action qui me colle à la peau. Est-ce une tendance négative que d’avoir confiance en soi ? Je sais, s’engager est difficile, on vient vite à penser que l’on ne vous aime pas comme il le faudrait, la situation est complexe, nous n’avons pas été présenté, on ne se connaît finalement qu’à peine, c’est la raison pour laquelle, j’ai décidé de faire simple et pur à la fois. C’est à la fois très simple et très compliqué, mais, je ne me voile pas la face. Mes sentiments sont profond à votre égard, comment pourraient-ils en être autrement, vous êtes si merveilleuse. Vous seriez fleuriste rien ne serait différend à mes yeux, je vous appartiens corps et âme, faites de moi ce que vous voulez, ma fidélité vous pouvez compter sur elle car elle est aveugle. Je ne suis qu’une petite molécule mais je vibre pour vous, dans l’espoir de vous voir mienne. Mes mots sont faibles, pour décrire l’amour que je vous porte, votre voix résonne dans ma tête, votre image bouscule mes neurones, vous vivez en moi tout au long de la journée, vous toujours vous, ça tourne à l’obsessionnel car vous êtes la femme idéale. Comment vous dire tout mon amour ? S’il fallait vous suivre au Koweït, je n’hésiterais pas une seule seconde, jusqu’au bout du monde, loin du marasme Parisien. Je ne crois pas à l’amour passionnel et destructeur, je crois dans l’amour total, solide, sans réserve ni infidélité, basé sur la communication et le respect de l’autre “ Partagé entre raison et sentiment, j’ai choisi mon camp, j’ai littéralement pris le parti des lois du cœur, les seules qui m’inspirent et me font vibrer, je sublimerais donc au-delà de tout principe fondé sur le raisonnable, dans la vie, sur le web ou ailleurs.
Ma chère Elisabeth
Rien n’évoque mes lettres dans les programmes de News-Tv, je préfère cela. Je ne sais pas où va l’amour que je vous porte, je suis bien conscient qu’il ne mènera à rien, j’en ai l’intime conviction, je ne peux pas vous convenir, je ne suis rien, je dois avoir cent cinquante mots de vocabulaire et l’art de la conversation m’échappe partiellement, le fossé socioculturel est bien trop vaste entre nous et vous ne serez jamais ma femme. Mes rêves illusoires, ces rêves étranges et dérisoires, je dois les laisser de côté pour me plonger dans la réalité, C’est ainsi, je dois faire avec. Une fois encore, j’ai rêvé de vous cette nuit, ce fut très agréable, je ne me souviens pas des détails mais c’était assez pour me réveiller et combler ma nocturne satisfaction. Vous étiez ravissante, une fois encore, j’adore vous voir les cheveux tombant sur vos épaules. On vous sent complètement à l’aise dans ce rôle d’arbitre de la politique et des « affaires », l’émission est bien rodée, c’est maintenant une petite machine bien orchestrée un peu étroite pour vous. La prochaine case, quand est-ce ? S’il en a une évidemment. J’aimerai vous voir, les cheveux frisés battus par le sel et le soleil, vous voir dans un autre cadre que celui de la télévision, sur une plage ou ailleurs. Je ne serais jamais votre amant, les admirateurs zélés, par principe, ne partagent pas la vie des présentatrices de télévision. Je ne me comprends pas moi-même, comment j’en suis arrivé à idolâtrer une figure des médias. C’est infiniment bizarre. Le personnage m’a tout de suite séduit, femme tronc pour les nouvelles de « Pour ne pas vous mentir » au vocabulaire sophistiqué, femme distribuant gage et bon point dans l’actualité de la politique, rien n’aurait pu laisser supposer que je tombe amoureux de vous. Tout à fait incroyable et étonnant de ma part, pourtant il faut bien constater que c’est le cas, mais je ne suis pas sensible aux minauderies de circonstances, en gros plan, cela fait partie du spectacle, ce qui m’intéresse c’est la jeune femme avec toute ses contradictions et ses interrogations, la profondeur de la magnifique créature. L’enveloppe est remarquable de beauté et de charme, c’est un fait que personne ne remet en cause, tous sont unanimes. Pour ce qui se dissimule derrière la face publique c’est encore un mystère qui me passionne, le peu que je connaisse est stimulant, vous placez l’amour au-dessus de tout, vous ne comprenez pas l’échangisme, autant de valeurs que je trouve infiniment respectueuse, cette planète est un bordel, impossible de comprendre mes contemporains sur ces questions. J’ai lu sur le net que vous aviez peur d’être prise pour un “ porte manteau à fantasmes ” Je ne connais pas la teneur du courrier que vous recevez mais loin de moi la pensée de voir en vous ce genre de femme. Je n’aime pas le mot fantasme, je n’en ai aucun. Mais pourquoi cette peur ? En ce qui me concerne, je vois en vous une femme exceptionnelle mais je n’ai pas de fantasmes vous concernant. Evidemment, je me pose des questions et cela évite de parler seulement de moi. En quoi pourrais-je vous faire peur ? Si cela s’adresse à moi, je ne comprends pas du tout cette position. Enfin bref…je suppose que dans le flot de lettre que vous devez recevoir, c’est l’idée majeure qui doit ressortir, mais, je le répète, vous n’êtes pas un porte manteau à quoique ce soit, à fortiori à fantasme. Votre première vocation “ Nonne vétérinaire ” C’est loupé quoiqu’en y réfléchissant bien et si l’on considère que les téléspectateurs sont des brebis égarées, c’est presque réussi. Je trouve fascinant que vous vouliez rentrer dans les ordres, j’adore ça, je suis baptisé mais athée et un peu agnostique aussi car je trouve extraordinaire l’impact de l’église sur les civilisations. Moi également, je voulais être vétérinaire quand j’avais huit ans et auparavant, je voulais être routier car on pouvait écouter la radio en même temps que conduire, j’écoutais énormément la radio étant enfant, à cette époque la bande FM n’existait pas, le transistor était roi. J’entretiens à votre égard une sorte de culte et mon regard est bien plus que, seulement bienveillant. Des préjugés ? Je n’ai pas le sentiment d’en avoir eu, je ne m’intéresse qu’aux faits, vous concernant. J’ai parfois dû être maladroit, abrutis mais c’est toujours dans l’optique de vouloir être plus proche, avec des hypothèses peu pertinentes. Très honnêtement, je ne suis sûr de rien, je me contente de vous suivre dans vos déclarations en n’écoutant que vos réponses, les journalistes vendent leur salade mais il n’y a que vous qui m’intéresser au final. Je ne vous reproche rien, vous menez votre vie comme bon vous le semblez, je vous veux heureuse car vous le méritez, vous êtes l’excellence. La population vous attribue des aventures que vous n’avez pas ? Laissez les baver, c’est triste mais vous suscitez, au même titre que beaucoup le contrecoup de la notoriété, que cela ne vous empoisonne pas la vie. Je vis dans la plus grande confusion, en vous écrivant régulièrement et je sais, que ces missives ont un impact limité. C’est ridicule d’entretenir une telle relation, voué désespérément à l’échec. Comme je vous l’ai déjà dit, je n’attends rien, je ne recherche rien de particulier, vous me fascinez, personne sur terre ne me fait un effet tel que vous. Je n’attends, d’ailleurs rien du service après-vente, ma démarche n’a rien de rationnelle, je ne me l’explique pas. Finalement ce n’est que de l’amour à sens unique. Dans mon désert affectif, vous êtes l’oasis, vous avez toute mon affection et mon profond respect.
Ma chère Elisabeth
Dans mon esprit, dans mon corps et dans mon âme, vous êtes présente à chaque instant. Mon temps vous est consacré exclusivement, je ne travaille plus, rien ne me passionne plus que vous. Mes seuls centres d’intérêts sont la lecture, la télévision et l’Internet mais vous occupez la première place. L’élan : le geste que vous préférez chez un homme. Il m’a fait défaut, avec d’autres femmes. Cela n’aurait pas changé grand-chose à ma vie. Finalement des petites gourdes sans grand intérêt. Avec vous, c’est un défi permanent, j’espère que vous pensez ces mots, plus vite que je ne les dis. Je ne joue pas, j’ai horreur des jeux qu’ils soient vidéos ou autres. Je ne dissimule rien, pourquoi le ferai je ? J’ai mis mon âme à nu, je vous appartiens tout entier. La fascination que vous exercez sur moi est totale et je sais pourtant exactement pourquoi je vous aime. Vous avez la chaleur des femmes de l’Orient, comme tous les timides, j’ai une retenue maladive mais quand la glace se fend, je suis complètement barré. C’est difficile de parler de soi, un exercice périlleux, je n’aime pas tellement ça, une certaine pudeur imbécile. Comme je regrette de ne pas avoir le talent d’un “ Romain Garien ” ou d’un Boris Vréant pour vous exposer plus correctement ce que je suis, ce que je vis. Les mots me manquent pour vous décrire comment vous êtes, à mes yeux, précieuse, unique. Je suis tombé dans les arcanes de l’amour, je n’avais pas tous mes moyens, mais dans mes sursauts de conscience, je n’avais Dieu que pour vous. Vous êtes si différente, la vie ne m’a pas donnée l’occasion de rencontrer une femme aussi exceptionnelle. J’aime cet esprit à la fois très concentré sur ce qu’il fait et complètement “ délirant ” dans son approche au quotidien. Je suis identique. Méticuleux, pratique, et par ailleurs dans la plus grande confusion parfois. Irrationnel. Pessimiste. Je fais tout comme si demain la terre explosera et dans ma situation elle explosera. Mes parents vieillissent inexorablement, ce sont les personnes les plus proches physiquement et pourtant si un jour je devais vous rejoindre, je n’hésiterai pas une seule seconde. Je dois me rendre à l’évidence, ce jour n’arrivera pas, mais l’espace de quelques secondes par jour, il m’arrive d’y penser. Je me répète. Je me distingue peut être par mon imbécillité chronique, mais rien ne me fera changer d’avis, vous êtes la femme, inoxydable, parfaite, idéale. Je n’ai pas pour habitude de m’extasier devant toutes les beautés que je croise. Je suis difficile, exigeant, la plupart sont de toute façon hors de portés. Une paire de lunettes suffit à vous habiller. Je suis un cas, ma raison ne répond à une quelconque logique lorsque je suis là à vous écrire. Je distille quelques mots qui ne sont que le dixième de ce que je pense dans la totalité.
Ma chère Elisabeth
J’ai rêvé de vous cette nuit, vous donniez une conférence de presse en anglais. Puis, ensuite nous étions dans une ville d’Europe de l’est avec des grattes ciels, nous parlions toujours en anglais en faisant des travaux de terrassements dans les reflets bleutés des immeubles. Curieux non ? Complètement stupide comme rêve, mais assez étrange car c’est la première fois que je vous visualisais, d’habitude on me parle de vous mais vous n’apparaissez pas. De quoi me mettre de bonne humeur pour la journée.
Ma chère Elisabeth
J’ai décidé de vous tutoyez. Une fois encore, je suis subjugué par ta prestance comme par ton physique si sublime, la femme parfaite dans toute sa splendeur, un magnifique tableau sur le plateau. Dans ton émission, il y avait deux femmes éblouissantes de beauté, Caroline Fouquet et toi, je te rassure tout de suite, tu as bien plus de charme que Caroline, c’est curieux pour l’une comme pour l’autre, on a entendu les mêmes stupidités du début, femme froide, méprisante, je crois que c’est un vieux fantasme d’homme de vous juger ainsi, n’est-ce pas maîtresse ? Mais je suis loin d’être un adepte de la cagoule et du collier de chien, mais je sais que cela existe chez des tarés au fin fond d’une cave. Dans ce que je t’ai écris, je ne sais pas, si je fais comme tout le monde. Cela serait embêtant, je me sentirais coupable de ne pas avoir essayé d’être différent des autres. Je dépense sans compter lorsqu’il s’agit de t’adresser la parole, je t’ai dans la peau, je ne vois aucune autre explication. C’est d’ailleurs assez paradoxal dans la vie courante, je suis légèrement en retrait, j’écoute, j’analyse, j’essaye de trouver des révélations inavouées, je ne communique qu’avec parcimonie, c’est une des faces de ma personnalité que j’aimerai gommer. Evidemment ce que j’avance ici est purement spéculatif, une étude plus approfondie pourrait étayer mes propos. Mon approche par anticipation, est pragmatique, empirique, mais je ne suis ni devin, ni gourou et mes réflexions reposent sur du concret, de la matière grise. Enfin bref, tu rayonnais de splendeur hier soir, comme d’habitude. Tu me subjugues littéralement, tout ce que tu fais remarquer est juste, simple, limpide, brillant. Un ovni sur la planète du paf, c’est dingue, tu es tout ce que j’ai toujours recherché chez une femme. J’ai l’impression de te connaître depuis l’enfance, il règne chez toi une empathie qui me touche en plein cœur à chaque fois que tu prends la parole. C’est extraordinaire de t’entendre dans ce panier de crabes des gens de télévision, des personnages femmes et hommes de la sphère publique. Je n’ai jamais vu cela, ni ressentie une émotion pareille. C’est abracadabrantesque, je ne soupçonnais pas qu’un jour, je puisse sentir dans une telle osmose avec une personne. Démentiel, il n’y a pas d’autre terme. Très à l’aise, ce qui ne gâche rien, tout ce que tu as dit, je voulais l’entendre.
Ma chère Elisabeth
Faut-il vous faire un dessin, messieurs ? Comment avez-vous pu penser que je reste dans ces bois ? J’aime cette très chère femme, à mes yeux il n’y a qu’elle, jusqu'à mon dernier souffle. C’est ainsi, je n’y puis rien changer. Comment auriez-vous pu en douter mademoiselle ? Les choses étant ce qu’elles sont, les fautes de goût sont maintenant très éloignés de ma petite personne. Je m’inscris maintenant dans une normalité, comment dirai-je ? Tranquille. J’étais, l’espace d’un court moment à l’assaut du château qui détenait la princesse de mes rêves. Vous voilà rassurez ? Ma raison est une chose qui a, à certains instants passés, défaillit, devrez-vous me le rappeler sans cesse ? Ne cherches pas, une explication, cela me semble insurmontable, je suis tétanisé à l’idée que tous mes espoirs volent en morceaux. Tu comprendras que je puisse avoir envie de ne pas avoir mal. Suis-je complètement malade ? A mille lieues de la réalité, me raccrochant à un rêve comme à une bouée de sauvetage. Je m’interroge. La seule chose dont je suis certain, c’est l’amour que je te porte et il guide mes pas dans cette obscurité. Dans cette demi-teinte, je fais un pas en avant et deux pas en arrière mais l’essentiel est que tu saches que je te suis fidèle, comment pourrait-il en être autrement ? Tu es si parfaite, je n’en reviens pas, je n’imaginais pas qu’une femme puisse à un tel point me mettre dans un état pareil. Tu respires le bon sens, tu es magnifique, tu me subjugues littéralement. Tu m’envoûtes. Je subodore, j’essaye des pistes, sans être jamais certain que cela soit l’ultime vérité. La seule certitude est l’amour qui me transporte et me donne des ailes. Depuis le début, à travers tous mes textes, j’ai toujours voulu te plaire. J’ai toujours agis afin d’obtenir tes faveurs. Un amour sans bornes, sans limites. Tout ce que je veux c’est être avec toi, même te sentir dans une autre pièce me comblerai de bonheur. Tenir le cap, chaque lettre est une nouvelle étape, mon amour est comme un feu ardent qui ne faiblira jamais, le combustible est l’oxygène que je respire. Cette source incandescente lumineuse est toujours présente dans mon cœur, dans mon âme, dans mes tripes à chaque instant. Tu es la seule élue de mon cœur, pas de ballottage incertain, pas de bulletin blanc, je vote pour toi à chaque élection, la présidente de mes rêves. Une reine, ma reine, notre royaume où le soleil ne se couche jamais. Resplendissante comme un astre immortel. Les mots me manquent pour te décrire combien à mes yeux, tu es si importante. Je voudrais tant, par mes gestes te faire part de mon amour, toutes les occasions seront bonnes pour te prouver par des attentions affectueuses l’exact reflet de mes sentiments. Dévoué corps et âme, je te vénère plus que tout. Je me convertirais pour toi si tu me le demandais. Tu es tout pour moi, j’ai l’impression de te connaître depuis des lustres. Une âme sœur comme si tu avais été présente depuis le début, j’ai appris au fil du temps à te découvrir, jour après jour et tu m’as éblouie. Pas une, ne t’arrive à la cheville, il n’y a aucune autre femme dans ma vie, il n’y en aura pas d’autres. Je t’ai cherché partout. Je sais désormais que tu es la femme de ma vie, le verdict tombe, implacable destin qui me raccroche à toi, comme une sentence merveilleuse des plus douces et des plus voluptueuses. Ne suis-je pas un peu stupide ? A te trouver toutes les vertus de l’univers, est-ce que je n’en fais peut être pas un peu trop ? Tu peux compter sur tout mon amour. Je ne plaisante pas, j’ai dans la tête des montagnes de question à ton sujet, ma réponse tu l’as connais. Je te suis dévoué, ma dévotion pour toi est sans limites et je n’ai jamais ressenti une telle ferveur à l’égard d’une femme. C’est de l’hypnose, de l’amour divinatoire, y portes-tu encore attention ? Je ne le sais pas, je n’ose pas imaginer le pire, ce sera comme un coup de poignard, le sol se dérobera sous mes pieds. Le chaos et le vertige s’abandonneraient à moi pour le restant de ma vie. Cette perspective, je ne veux pas y croire.
C’est ainsi, que ce terminait, une partie des échantillons de la première salve de message que j’envoyais à Elisabeth. Cette correspondance à sens unique était écrit dans la ferveur du petit matin comme dans le silence de la nuit ou seul résonnait mon cœur plaintif. Au-delà de simple courrier d’un amoureux télévisuel, c’est son grand esprit de synthèse qui excitait vivement ma curiosité à son égard. Il fallait que je la rencontre c’était obsédant, incontournable et nécessaire.
Impossible de faire abstraction sur ce qui avait sifflé dans mes oreilles dans les haut-parleurs de ma télévision depuis ma découverte, j’avais la vague impression qu’il fallait se poser et ne pas réagir sur une impulsion, trop hâtive. Ça aurait pu être mal interpréter comme une volonté volubile mal contrôlée ou désordonnée, une logorrhée inappropriée. Je ne voulais pas non plus d’une exagération pompeuse qui pouvait nuire à mon discours qu’il fallait sobre et incisif. C’est pourquoi, entre deux textes, je me replongeais dans les données du logiciel de Duchaussout et les courriers de la DGSI mais m’informant, tout de même, sur les ondes de télévision, je devais avoir néanmoins un semblant de soupçon entremêlé d’espérance. J’avais eu la douleur silencieuse pour ne pas avoir relaté le détail de mes découvertes chez les Duchaussout.
Alors que j’étais sur le chemin de l’hôpital de jour qui avait décidé de ne plus lâcher en me renvoyant l’image d’un inadapté, d’un malade mentale, d’une chose soumis aux regards normatifs des agents de l’état, dépendant aux chants des acteurs de ce même état et ce, qu’elle que soit son niveau d’intervention. Heureusement au bout de 8 ans ça pouvait évoluer, il était temps. Me sentant légitime dans une intégrité intellectuelle qui s’adressait de la même façon aux pauvres comme aux riches, aux puissants comme aux faibles mais toutefois peu farouche car rien ne devait me soumettre, j’appuyais pendant cette journée une indépendance de propos qui allait jusqu’à provoquer le sourire.
Puis résonnant dans ma tête comme autant de chants des sirènes qui se rappelaient à ma mémoire comme Ulysse. Avec un ultime but et objectif depuis tant d’années, je ne pouvais détacher mon esprit à l’idée que la principale motivation trépidante qui m’avait animé, avait été de vouloir travailler. Comme je le disais, la mémoire est sélective et l’information massive. Ce pouvait-il qu’il reste un espoir de rejoindre cette équipe ? Ce genre de réflexion, je ne l’avais sorti que de mon chapeau, je ne l’avais ni lu, ni entendu, auparavant mais ça me paraissait évident. Pourtant, j’avais peu d’expérience et l’âge était grandissant, j’avais pourtant toute l’énergie qui s’offre à vouloir ne pas décevoir, une seule seconde, et avec moi l’idée que la fatalité de la maladie à partir du moment où elle est traité, domestiqué, neutralisé ne devait plus faire très mal. J’étais stabilisé, et il fallait prendre les médicaments, faire attention à sa consommation d’alcool et être vigilant sur les troubles du sommeil premier manifeste en chef de la schizophrénie.
Motivation sur News-Tv
J’avais donc la naïveté d’y croire à cette jeune femme sur News-Tv, parce que j’avais entretenu une bonne connaissance de l’histoire du groupe. Je connaissais bien la maison et elle était toujours aussi attrayante, captivante et riche de bénéfices pécuniaires comme de la foisonnante personnalité de ses acteurs humains visibles ou invisibles à l’écran. Il existait un rapport de causes à effet sur tout ce qui m’avait motivé à entretenir avec tant de soin les éléments se rapportant au groupe depuis deux mille dix. Car en fait, telle que je l’avais entendu par bribes éclairantes, les commentaires donnaient lieu à un compromis. A l’heure de midi, c’était sans espoir, il ne fallait rien en attendre et à vingt-trois heures, on pouvait renouer avec. Cette bi polarité quelques peu contradictoire et qui se produisait dans l’expression des journalistes en disaient long sur le flux et reflux de l’information débités par paquet, la concomitance avait pour sujet une bizarre antinomie. On pouvait trouver un terrain d’entente sur ce que je lui demandais, une rencontre, ce n’était rien pour cette fille plaquée or. Puis, ce n’était pas la charité, c’était de l’intérêt bien compris dans un échange reposant sur du travail et un gain dans une interaction réciproque.
Après tant d’années j’avais vécu mon interprétation de la réalité sans certitude qu’avec des hypothèses que j’étayais sans cesse, elle devait sans doute imaginer que j’en étais là, avec mon espoir et la faiblesse d’y croire, en adoptant une tactique, certes dans ma prose, j’étais concis, vif, alerte, avec une pensée endogène vers ce qui me poussait vers l’extérieur, ce qui avait été peut être remarqué mais dans la vie, en dehors de ces lignes, j’étais peut être sans doute lent, hésitant, diminuer physiquement par les neuroleptiques, et ça, elle n’était pas en mesure de se poser la question. Le handicap mental et le traitement changeaient la donne par rapport aux normaux et ce qui leur semblait naturel était chez moi un petit effort tout au plus, en aucun cas, neurasthénique ou anémique, dans un état d’abattement ou de tristesse. Il y avait un monde entre des cerveaux aguerris du monde professionnel de la télévision et un patient au passé lourd et à la posologie conséquente. Tout ce que j’imaginais, c’était que, quoiqu’ils doivent penser de ma vie ou de mon état de santé, j’étais décidé, déterminé à leur prouver que même s’il n’existait pas une petite place aussi insignifiante soit-elle au sein de la chaîne, mon récit, mon histoire, mon combat, resteraient en tant que cas d’école et œuvre de légende de la communication électronique pour quelques années. Mon seul souhait était de pouvoir oublier ne serait-ce que cinq minutes ce handicap dont le rôle prépondérant me hantait comme un fantôme tourmenté par son sort. La seule option qui m’apparaissait tangible, c’était de réaliser mon rêve, en idéalisant une fonction, en purifiant une tendance qui s’était matérialisé à travers la télésurveillance. Ainsi, j’avais sublimé un travail que j’imaginais comme le vecteur de toutes mes espérances. Je cherchais une âme sœur, je me l’étais inventé comme un graal qui auparavant n’existait pas. Il n’y avait pas de travail, c’est alors qu’à l’heure d’Internet, on s’en invente un, et qu’importe les horaires, qu’importe même la reconnaissance, le « data labour » en poche et l’espérance lointaine d’être constamment remarqué dans les croyances erronées du téléspectateur isolé, me donnaient un redoutable optimisme qui ne me faisait pas renoncer à la tâche. Un peu à la manière de l’ouvrier tenace et galvanisé, participant à un effort de guerre par amour de la patrie. C’était et, c’est encore très clair, je voulais quitter ma condition humaine, comme un réfugié qui fuit la guerre, comme pour fuir l’hôpital, ses patients et ses soignants et qui, pour certain me renvoyait l’image désagréable de la maladie, de l’apathie, de l’oisiveté ou de la simple bêtise. Je désirais retrouver Paris et le tumulte de la brève qui tombe, de l’antenne qu’il faut rendre à l’heure, du fil conducteur sur lequel on ne doit pas déroger.
C’est Paris, que j’avais laissé bien amèrement, et malgré moi pour suivre des parents avec lesquelles, je ne m’entendais certes pas trop mal mais dont j’avais la sensation d’avoir cerné les limites au bout de nombreuses années de vie quasi commune et quotidienne. Je ne voulais pas finir avec eux, même avec un certain confort, parce que pour eux, leur vie était derrière et non pas devant. La mienne de vie, était déjà bien entamée et la fin de l’après-midi pouvait encore devenir ensoleillée. Mes parents, eux pouvaient se retourner et se satisfaire d’une existence bien remplie, une vie professionnelle correcte et accomplie, des moyens, un bon cadre de vie, mais qu’en était-il de moi ? Qu’est-ce que j’avais accomplie dans la mienne ? Un site web, une application, le piratage du siècle, c’est tout. Comment ? Il aurait fallu se satisfaire de cette vie de retraité et finir avec maman ? C’est le seul destin dont il fallait que je me satisfasse ? Une maigre pension, un travail payé au rabais ou dans une association comme bénévole, au nom de quoi, je devais me soumettre à cette vie et renoncer à lutter ? Parmi les hommes de cette terre et habitant dans un pays riche, je n’étais sans doute pas le plus malheureux, mais j’avais toujours pensé que l’on pouvait rester maître de son destin, comme la phrase facile à entendre d’un ministre malin, Pourtant, je ne volais la place de personne dans mon enthousiasme de trouver un but sur News-Tv, je voulais juste laisser ma place à l’hôpital à un autre, alors je souhaitais des actes, pas d’achoppement, pas de climat délétère qui serait nocif pour les deux parties, pas de compassion, ni d’un attentisme de circonstance. Je ne voulais pas faire commerce de mon handicap ni qu’on fasse usage de mon handicap à des fins électorale, ni au titre d’un état tout puissant inquisiteur et suffocant mais ce que j’attendais c’était de la considération, du travail et de la bonne humeur dans une solution qui se devait être un droit pour chacun des dignes habitants de la planète pour faire table rase d’un champ de vision du présent pour le moins obscurcis.
La télévision est un média souvent généraliste qui s’adresse à la masse et bien sûr il m’arrivait de croire que la télévision s’adressait à moi en particulier, un peu comme un jeu, comme une complicité que les communicants entretenaient dans une équipe dont tout faisait croire que l’ambiance était bonne quoiqu’il advienne, ce qui d’ailleurs devait être le reflet de la réalité. Dans les méandres d’une forme de folie, je restais attentif mais néanmoins lucide, bien que soumis à la douce illusion que l’on voulait me faire passer un message avec ce qui était dit.
Internet était un média robuste, optimisé pour la synthèse des médias dans la dernière coupe de cheveux à la mode car on pouvait croire que tout ce qui était publié était lu par tout le monde. Les limites de mon site et de mon application que j’avais déterminées, délimitées avait été un espoir, pourtant, ce n’était pas un spectacle des Chippendales, mais la question qui se posait déjà était que faire après, si ça ne fonctionnait pas ? Comment rebondir ? La seule réponse que je trouvais, reposait sur la possibilité de travailler, donc j’étais condamné à travailler pour réussir une autre mission, un but ultime et comme un dingue, s’il le fallait et je m’y étais, déjà, employé sans mollir, sans l’ombre d’un doute comme un entêté, un chien qui n’en démords pas.
J’exprimais ici dans mon application et sur le site, un travail qui reposait sur une myriade de petite compétence multiple de programmeur du web. C’était l’addition de connaissances qui proposaient dans sa globalité un site cohérent dans sa forme avec de nombreux cas de petit savoir-faire acquis par le travail et l’empirisme. En aucun cas, je ne pensais avoir un quelconque talent. C’était une expérience où régnait une expertise qui voulait rivaliser avec l’excellence en souhaitant se confronter avec lui-même, pousser ses limites avec des moyens qui n’étaient pas considérables. C’était donc un vrai savoir-faire et une inspiration toujours renouvelée sur le quoi faire après. Un courage titanesque qui avait jalonné à travers un travail singulier d’un seul et non d’un groupe ou d’un collectif. On assistait donc là, à une œuvre qui à mes yeux était maîtresse et qui avait donné un style à l’époque plus qu’aucun travail du même acabit. Sans comparaison possible avec ce qui a pouvait jouer en sa défaveur, je restais toutefois le plus rationnel possible et j’avais été à me consacrer à l’ouvrage totalement. Dans ce que je pouvais exprimer, tout semblait suspect avec la maladie qui m’avait choisie en deux mille huit, c’est pourquoi on finissait tôt ou tard par ne plus pouvoir s’expliquer au risque que le costume de la maladie vous rattrape dans le discours d’un spécialiste qui avait forcement son mot à dire sur un cas ou un autre puisque lui aussi avait un costume à porter celui du sachant, de l’expert. Néanmoins, j’avais besoin de me confronter au réel de la vie de l’entreprise, de partager et de ne plus vivre dans le virtuel. Malgré tout, je m’y sentais bien et vivre à travers un poste de télévision ou un écran d’ordinateur m’apportais beaucoup. Je regardais tous les soirs en différé sur l’Internet, l’émission de divertissement « Débat du Jour ». Cette version en flux continu vidéo présentait un risque de vulnérabilité de sécurité. Pour satisfaire à des besoins de défense, les sociétés américaines du secteur avait mis au point des logiciels qui permettaient à la maison mère de News-Tv d’avoir un droit de regard sur l’intégralité des disques durs de votre machine. Si j’avais écrit un livre, une pièce de théâtre ou écrit des rimes à vingt centimes, ils étaient en mesure de consulter mon ordinateur, d’exploiter mes données et éventuellement de les déposer auprès d’une société de droit d’auteur, si je ne l’avais pas déjà fait. On en était déjà arrivé là en deux mille six dans cette zone nauséabonde de l’Internet, où régnait pêle-mêle des programmes pédopornographiques, des faux médicaments et des addictions maladives à des jeux de toutes sortes. C’était à trois clics de vous et à la portée innocente de l’un de vos enfants. Toujours est-il que cette permissivité accorder à une multinationale de pouvoir observer le contenu de votre ordinateur, elle était acquise de fait, à partir du moment où vous acceptiez les clauses d’utilisation du logiciel de flux vidéo et comme ils étaient leader sur ce marché en tant que standard incontournable, vous ne pouviez, vous y soustraire si vous désiriez regarder une vidéo sur la toile.
Chapitre 7) La résolution et l’espoir
Bilan des envois de courriers
Pendant une semaine, l’envoi intensif de message à Elisabeth avait été quasiment ma seule occupation. Avec une dévotion toute religieuse, je regardais son émission en scrutant chaque détail, en analysant la moindre phrase qui aurait pu faire allusion à mes envois de courrier sur son site Fatbooker. Certaines de ses prises de paroles de fin d’émission me laissait cependant perplexe mais j’imaginais qu’avec un physique pareil et une intelligence aussi brillante, cette jolie femme devait attirer le téléspectateur, esseulé, qui devait entretenir un caractère libidineux et avec une audace sans retenue. Inconsciemment, j’envisageais donc une caricature de moi-même pour concevoir un personnage qui m’aurait ressemblé. Tout en sachant que les motivations qui nous réunissait, moi et cet autre, s’arrêtait à l’intriguant charme d’Elisabeth et qu’au-delà me concernant, mes motivations, reposaient sur le futur de la démocratie et de l’approche de la liberté individuelle dans notre société. Notre belle démocratie pouvait peu à peu muter en horrible junte armée sous le joug de quelques militaires aussi rigide que discipliné ou de la seule volonté d’un homme soit-il président de la république et premier personnage de l’Etat.
J’avais fait parvenir des dizaines de mails à Elisabeth en précisant mes coordonnées téléphoniques et évidement, mon adresse de courriel. Je lui indiquais, en plus, l’adresse de mon site, car en me mettant à nu, dans une transparence que je voulais partielle, je souhaitais ne pas l’effaroucher comme une biche qui aurait pu rester figé par des phares de voiture dans l’obscurité d’une forêt épaisse.
Au bout du neuvième jour, le résultat de mes courriers enflammés était très peu entraînant et malgré tous mes efforts, rien ne semblait avoir perturbé le fil de ses émissions qui s’enchaînaient les unes à la suite des autres dans une routine toute quotidienne, bien orchestrée par les équipes de News-Tv. J’en venais à désespérer, pourtant, je tenais l’affaire du siècle, avec un scoop que tous les journalistes s’arracheraient afin de posséder les documents qui étaient miens. Hélas, personne sur cette planète ne devait porter attention à ma personne. Il fallait bien se rendre à l’évidence, je n’étais personne, juste noyé dans les soixante-cinq millions d’individualités qui peuplait la France, juste un parasite qui vivait à vingt-huit ans chez papa et maman dans une vie aliénante du parcours de malade mentale. Je n’étais personne, un électeur tout au plus, qui n’avait aucune carte, mais qui pensait fermement que la culture pouvait rendre plus libre les individus et que l’entreprise créait des richesses. Une sorte de compromis entre le social et le libéralisme, entre le faible qu’il fallait absolument protéger et le fort qui devait s’affranchir des tenailles de l’Etat centralisateur, mais je n’étais personne, je ne connaissais personne dans un système qui devait à chaque instant faire jouer son réseau et ses corporatismes.
Je ne suis personne
J’étais sous l’effroi de constater qu’aux yeux du reste du monde, je n’étais qu’insignifiance mais que de ma petite estrade qui m’avait élevé dans le cœur du pouvoir à un éminent secret, j’étais comme un jeune dieu Antique, revenant de quelques campagnes guerrières qui m’auraient fait toucher les portes du monde terrestre. J’avais vu ce qu’aucun ne soupçonnait, j’avais repoussé les frontières de l’incroyable et pourtant c’était bel et bien présent, à une portée de clic, sur une clé USB. Ca écrasait d’un seul coup, les empreintes digitales, ça donnait un sérieux coup de vieux à une technique qui venait presque d’apparaître à travers la preuve génétique de l’Adn. Tout ceci dans ce logiciel pour le septième ciel : la télésurveillance comme j’aimais le dénommer encore et encore, dans le peu de neurone qui étaient restés mien.
HDJ La vie aliénante du malade
La journée du vendredi se déroula sans incident. J’avais passé une demi-journée à l’hôpital de jour parmi des indigents et j’étais surexcité, dépité à l’idée que tout pouvait continuer comme ça, dans la logique de cette vie aliénante de vie de malade. Dans ma vie, je tournais en rond coincé entre ma famille qui n’avait pas de réponse à mon mal être et les psychiatres qui ne voyaient en moi, qu’un cas statistique. Tout en étant soumis au principe de précaution et à la volonté coercitive que je n’avais pas d’autre choix que de me soumettre à l’injonction médicamenteuse et à la fréquentation de l’hôpital de jour. Au lieu de me soustraire à la pure et simple folie aliénante de cette vie, l’institution se contentait de me la faire digérer, de me faire admettre que l’Etat se voulait de bien préserver la tranquillité et la paix de la société civile. Bien que je fusse persuadé que je ne représentais pas, ni un danger pour moi-même, ni pour les autres. Il fallait pour donner cette preuve de mon intégrité civile, que je m’acquitte d’un droit à la probité, comme si personne n’était en mesure de constater ce niveau de conscience, parce que subjectif et personnel. Je restais assujetti au bon vouloir des infirmiers et des psychiatres deux fois par semaine dans un choix qui opposait la raison d’un malade qui se soigne face au devoir de la fonction d’Etat. Cette preuve, j’en étais le seul garant car les équipes changeaient à l’hôpital et à chaque nouvelle tête, il fallait aller au-delà des apparences pour à nouveau nouer des relations de confiance qui devait se maintenir de manière continue. Faute de quoi, si ce climat de confiance venait à être rompu, une ambiance délétère s’instaurait avec le psychiatre et à cet instant les choses changeaient à votre sujet et l’on finissait dans le pire des cas avec une ordonnance au combien salé, de la même façon que dans un restaurant vous êtes surpris par une addition au prix élevée. Ordonnance, qui était vérifié dans l’acte d’achat des médicaments auprès des pharmacies mais également à travers des prises de sang régulières qui devaient indiquer les dosages des substances dans le corps du patient. J’avais été diagnostiqué schizophrène par la sphère médicale mais bien que ce soit par recoupement et par l’intérêt que mon cas représentait, en prenant comme exemple mon parcours que je connaissais bien, j’en étais arrivé à la conclusion que le diagnostic établi était plausible, j’étais un schizophrène, pourtant mon tempérament ressemblait à celui d’une personne plutôt réservé et peu apte à l’élan, un peu introvertie, voire gauche dans ses rapports à autrui. Ça, c’était ma personnalité. Mais on ne pouvait pas décemment me reprocher un trait de caractère, non, c’était autre chose comme quelque chose à la fois d’étranger et qui venait de moi.
D’après ce que j’avais pu lire, il y avait fort à penser que le cannabis avait sans doute été l’élément déclencheur de ma schizophrénie. Il existait un terrain, une faille psychique dans laquelle le mal aurait pu s’infiltrer. Si j’avais échappé à la drogue, j’aurais sans doute évité la schizophrénie, Vivant à la fois, avec la conscience de ce que j’avais, ce n’était pourtant pas les symptômes de ma maladie qui m’encombrait beaucoup. Je disposais de mes quatre membres, néanmoins le handicap s’était posé sur moi, mais, avec les médicaments et une hygiène de vie raisonnable tels que me l’avait décrite les médecins, je pouvais avoir la chance de vivre au-delà de soixante-dix ans. La chimiothérapie était à notre époque, assez au point et susceptible de me faire oublier les aléas lourd de cette maladie du comportement. L’accord tacite qui avait été discuté avec mon psychiatre, soulignait que je pouvais moduler avec la posologie ce qui me garantissait un sommeil à peu près équilibré et un faible potentiel de taux de rechute. La crise aiguë qui aurait nécessité une hospitalisation longue devenait hypothétique, lointaine et hors de propos dans le discours des médecins. La psychose s’était peu à peu transformée en névrose grâce à la thérapie et l’absorption constante de médicament psychotrope.
Les bonnes résolutions face à la maladie
Avec le souci d’être cartésien comme la rigueur que nécessite la programmation de la syntaxe de l’informatique, j’étais avec cette maladie aussi méticuleux et carré que quand il s’agissait de coder une fonction. L’indiscipline et la négligence donnant de mauvais résultat, l’informatique et la psychiatrie, ces deux sciences bien opposées avaient au moins ça en commun. La psychologie faisait partie des matières qui n’étaient pas quantifiable par les mathématiques, mais on pouvait faire confiance dans les médicaments, aux sciences de l’observation, aux mécanismes transpersonnels pour en déduire avec une forme de rigueur que pour mieux vivre, dans mon cas, il fallait vivre avec la chimie.
Le rejet de l’institution
Malgré tout et grâce à mon aptitude à comprendre et à mon sens des responsabilités limités, j’avais découvert chez moi avec cette surveillance à grande échelle un sentiment de rejet à tout ce qui ressemblait à un agent de la fonction publique. Qu’il fasse traverser des enfants à un passage piétons ou qu’il soit ministre, cette limitation de la surface de liberté des individus, je l’imputais à tous les corps de l’Etat. Cette confiscation de liberté prenait réalité dans toute mon histoire car depuis mes seize ans, je n’avais été que soumission. Une soumission qui fut certes bien agréable, celle relative au plaisir, de la drogue, du sexe, de la performance puis elle avait pris d’autres formes moins douces dans le cadre de vie que représentait Dreudan. Puis ce fut l’hôpital, avec une soumission à l’injonction thérapeutique, j’en étais réduit à une condition, celle de celui du malade et ici et malgré tous mes efforts, je n’arrivais pas à combattre cette état de fait. Depuis mon piratage de données, il fallait prendre en considération que l’Etat tout puissant, contrôlait tout, et bien au-delà de tout ce que l’on avait jusqu’à lors envisagés. Getworld, Seatle, Fatbooker et leur droit de regard commercial sur l’information apporté à l’édifice Internet, était ridiculisé face au pouvoir des états.
Je faisais un parallèle qui me semblait évident entre ma vie de patient et la vérité de la télésurveillance et vous n’aviez la paix nulle part même quand vous l’aviez vraiment car l’Etat avait tout décidé à ma place, mes ressources, mon traitement, mes allers et venues à l’hôpital de jour. Cette dépossession de mes capacités, la perte de sa maîtrise au profit du principe de précaution qui impose au malade une existence d’assisté en entretenant un système doté d’une double contrainte informelle mais effective du « tu me soignes mais je ne suis pas dans l’authenticité » ou « Je suis libre mais jusqu’où s’arrête ma liberté », cette interdépendance, j’avais beaucoup de mal à l’accepter. Cette état de privation de mes facultés propres ou de mes droits fondamentaux désignait un boulet empêchant le déploiement de mon potentiel ou qui servait à signaler qu’une personne n’était plus dans les rails de la bienséance et elle était assujettie sans en avoir conscience. La frustration qui sommeillait en moi devint une révélation toute entière. Cette notion de domination ou d’exploitation était les principes de l’aliénation psychiatrique et sociale qui prenaient un sens en moi tout particulier. Qui que ce soit pouvait être atteint pour une maladie psychiatrique grave, il n’existait pas de vaccins pour s’en prémunir et tout à chacun pouvait être louche ou susceptible de commettre un délit. Au-delà, on pouvait être suspect jusqu’à preuve de votre culpabilité. Dans cette surveillance globalisée, je me sentais comme un pion et sachant que le malade schizophrène pouvait avoir un comportement inadapté voire violent en cas de crise vis-à-vis de son entourage, on pouvait aisément penser qu’une population dite à risques devenait susceptible d’être mis sous surveillance étroite plus aucune autre.
Le coup de téléphone
A la fin de la journée de vendredi, je pris ma douche en rentrant de l’hôpital vers dix-huit heures puis tout en me rhabillant, j’allumais la télévision comme si rien ne pouvait plus m’étonner. Après un rapide survol des chaînes de télévision je m’arrêtais sur l’émission « C’est pour plaire » qui était consacré à la surveillance globale et dont l’intitulé était « NSA, les oreilles du monde ». On venait d’apprendre que François Poitevin et Nicolas Ablaski pendant la campagne présidentielle de deux mille douze avait été écouté dans le cadre de la politique sur le renseignement des Etats-Unis, évidement je haussais les épaules quand j’entendais Yves Puerto faisant répéter plusieurs fois à ses invités les phrases qui devait marquer les esprits des plus crédules. Avec ce que je savais, je considérais ce genre d’émission comme absolument inutile voire fallacieuse puisque qu’elle tentait de masquer une réalité qui était encore plus invraisemblable que de simple écoutes téléphoniques. Persuadé que ce type de débat ne s’adressait plus à moi depuis dix jours, je m’apprêtais à écrire un mail court à Elisabeth lorsqu’à dix-huit heures trente précise, je reçus un appel sur mon Dphone. Un numéro s’inscrivait sur l’écran mais dans l’incapacité de savoir à qui il correspondait, je décrochais au bout de la seconde sonnerie. Aussitôt à l’autre bout du fil, on raccrochait. Je notais, cependant que le numéro étant celui d’un portable et comme personne ne m’appelle jamais, j’étais intrigué par l’appel. Dans le doute, je consultais sur l’Internet sur un site d’annuaire inversé les informations relatives au numéro. Je découvrais avec stupeur que le numéro d’abonné était une femme et son nom m’évoqua, tout de suite, Elisabeth. Il était enregistré au nom d’Elisabeth Strassman qui devait être le nom de sa mère, pendant la période post Larivardière, elle avait gardé son nom de jeune fille ce qui devait tout du moins, pour son état civil, lui permettre de garder le mystère sur sa réelle identité. Le nom était accompagné d’une adresse : le 51, avenue de Villiers dans le dix-septième arrondissement de Paris. Pendant trente secondes, je fis une petite danse mécanique entre le bureau et la table basse de la pièce en répétant plusieurs fois le nom d’Elisabeth sur un ton proche de la synthèse vocale d’un robot, puis reprenant mes esprits, je m’assis dans mon fauteuil préféré, pour méditer la suite des opérations.
Chapitre 8) Direction Paris
Le départ de Dreudan
Le lundi suivant, à 6h04 exactement, je m’étais faufilé dans la cuisine dans une maison encore endormie. J’ai avalé un dernier café, j’ai poussé la porte du jardin doucement pour éviter de faire du bruit, l’air était vif mais il ne pleuvait pas, j’ai placé les sangles de mon sac sur mes épaules et je me suis éloigné sans me retourner.
Dans le train
Le paysage que j’avais sous les yeux était ensoleillé, verdoyant et fleurie, il avait fait beau tout le mois d’avril et la floraison en mai était magnifique. Ce spectacle des champs dont les graines commençaient à peine de germer présentait une nature magnifique renforcée par le soleil rasant du petit matin. Dans le train qui m’emmenait vers Paris, à partir de Grofort, plus aucune place assise n’était disponible. En me préparant de bonne heure et sur le quai avant tout le monde, je me garantissais une place coté fenêtre. Je serrais entre mes jambes mon sac à dos qui contenait mon vieil ordinateur portable Yoshibas et un change complet de vêtement. Je sentis mon Dphone vibrer. Dans la poche de mon jean avec l’assurance de savoir de qui l’appel pouvait bien venir, je le fis taire en portant ma main au portable. Tout autour de moi se trouvait dans le même compartiment des gens qui allaient travailler à Paris ou dans sa périphérie. Intérieurement, je m’amusais à trouver pour chacun d’entre eux des métiers qui correspondaient à leur allure vestimentaire et travaillants dans des entreprises auxquelles, j’inventais le nom. Ce jeu me prit cinq bonnes minutes. La femme d’une quarantaine d’année assise en face de moi devait être comptable à la Coperap, mon voisin, un solide sénégalais taillé dans la masse devait être physionomiste vigile au Coco Beach, un club privé à Antibes, sur ma droite se trouvait Thierry éleveur de porc près de Quernédec en Bretagne, un peu plus loin assise sur le strapontin Nazira première vendeuse dans le magasin de prêt à porter Styliz’art à Parly 2, ou encore Chantal toute de noire vêtue qui devait sans doute être coiffeuse. Puis, il y en avait encore bien d’autre et je pensais, invariablement, à ce qui me tenait en haleine depuis quinze jours qui devait en savoir bien plus sur tous ces gens que moi et ma pauvre imagination et il ne devait pas se tromper, pas lui, car ce n’était pas sur de l’évaluation qui reposait sur l’habillement ou la coupe de cheveux c’était une connaissance fondé sur une méthode rationaliste et sur de la science informatique.
Sur les applications plausibles
Les aboutissants de cette application j’en percevais les limites confrontées aux automatismes d’une foule disciplinée se rangeant à droite sur l’escalier mécanique dans la gare Montparnasse. Ça faisait longtemps que je n’avais pas vu autant de monde et je prenais pleinement conscience de la puissance de cet outil de surveillance et de reconnaissance. On pouvait même concevoir que bientôt sans faire de l’anticipation erroné, qu’avec des lunettes adaptées et « intelligentes » la police se déplaçant à pied pouvait interroger en temps réel une quantité de profil sans avoir à vérifier par une quelconque pièce d’identité le pedigree de chaque citoyen. Pour avoir vu un reportage sur Muse7 concernant la reconnaissance faciale ainsi que la vision par ordinateur, je savais que ces procédés et ces algorithmes devenaient obsolètes avec les nouvelles technologies par onde radio et la reproduction du réel mise en avant par la télésurveillance. Une fois sur le quai à attendre la rame de métro, je mettais en forme un autre champ d’application qui préfigurait le futur. Si l’on pouvait surveiller un être humain, on pouvait tout à la fois établir que pour les objets en mouvement le même type de procédé pouvait faire loi comme par exemple dans la conduite de véhicule, le comportement d’un homme comme les agissements d’une intelligence robotisé pouvait mener vers une organisation assistée. Différents constructeur de véhicules avait bien compris l’intérêt à terme de ce type de technologie et Getworld avait déjà mis au point des prototypes de voiture qui ne demandaient pas à être conduite par l’être humain. Il y avait une autre dimension dans l’approche du procédé mis au point par l’état, il y avait une dimension qui touchait de près notre rapport avec le pouvoir, notre place dans la société. Comme un vulgaire médicament soignant le diabète, on pouvait traquer les recoins de l’imprévisible et offrir pour tout à chacun une sécurité plus grande.
Arrivé au métro Wagram
J’avais repéré que l’adresse d’Elisabeth se trouvait près du métro Wagram. Pour avoir connu le quartier quand j’habitais à Levallois-Perret. Je descendais donc à cette station, son immeuble était cossu, de type haussmannien et se situait presque au niveau de la rue Viet près du lycée Carnot. La porte avec digicode disposait d’un porche avec une cour intérieur qui sans doute avait abrité une écurie avant l’arrivée de l’automobile. Je décidais de me rendre sur le trottoir d’en face pour observer l’immeuble et ses appartements dans les étages supérieurs, je n’en tirais aucune conclusion, la façade avait été fraîchement ravalée et de toute façon, ce n’était pas le genre d’habitat où l’on pouvait s’attendre à voir sécher du linge aux fenêtres.
Le général de Gaulle
Un peu plus bas dans l’avenue, je repérais un petit hôtel, deux étoiles et heureusement, il y avait encore de la place. Je réservais la chambre qui n’était disponible qu’à partir de douze heures et tournait les talons vers les rues de la majestueuse capitale. Revint à moi comme un leitmotiv qui n’avait plus d’âge, un extrait radiophonique de mai mille neuf cent quarante cinq du général de Gaulle qui reste très connu même par toutes les jeunes générations tellement, elle fut diffusée: « Paris outragée, Paris martyrisée, mais Paris libérée » et Paris à cet instant c’était moi, j’étais enfin libéré, je m’étais auto libéré du joug de mes parents, de l’emprise sur ma vie de l’hôpital et moi aussi j’étais le général de gaulle pendant ce printemps deux mille seize et je venais libérer la France et en l’occurrence mon premier objectif c’était Paris. Une ville que je retrouvais fleurie avec un temps sec, mon Paris, le terrain de toute mes expériences, le berceau de toutes mes illusions, le soleil de toutes mes espérances et qui, comme Icare avait fait fondre la cire de mes ailes après avoir échappé au labyrinthe de la défonce.
Dans Saint Germain
Je remontais le boulevard Malesherbes direction la Concorde, puis, je traversais la Seine, ensuite je me dirigeais vers le quartier Latin. Je mis environ deux heures avant d’atteindre mon objectif, la librairie Renia, presque au bout du boulevard Saint Germain. Pendant près de trois quart d’heures j’ai déambulé dans les rayons de ce très grand marchand de livres spécialisé dans les sciences et je me concentrais sur deux rayons en particulier celui consacré à la santé mentale ainsi que celui sur les sciences des ondes électromagnétiques. J’achetais plusieurs livres et j’allais déjeuner au restaurant rapide Mac-Sydney près du boulevard Saint Michel.
L’ouvrage sur la schizophrénie
Dans l’après-midi, j’allais m’installer sur une chaise devant l’un des bassins du jardin du Luxembourg et commençais la lecture de l’un des ouvrages. Je choisis celui intitulé « La schizophrénie, un regard neutre sur la maladie », dont l’auteur Lester Nash était un professeur en psychiatrie et en sciences cognitive de l’école de Palo Alto en Californie. J’appris dans l’avant-propos du professeur américain que la schizophrénie était une maladie qui provoquait un trouble mental sévère et chronique appartenant à la classe des troubles psychotiques. Que la condition humaine schizophrénique, c’était être différent des autres. Que tout comme les autres psychoses, la schizophrénie se manifestait par une perte de contact avec la réalité immédiate. Que l’on vivait autrement sa relation au monde. Que cette même personne pouvait aussi percevoir des objets ou des entités en réalité absentes. Qu’une personne atteinte de schizophrénie accordait à des éléments de l'environnement des significations excentriques ou croyant qu'ils ciblaient sa personne, en dehors de toutes manifestations logiques ou plausibles. Que typiquement, la personne schizophrène avait l'impression d’être sous contrôle lié par des forces immuables qui lui dictaient tels ou tels comportement à respecter. Que la schizophrénie s'accompagnait aussi généralement d'une altération profonde du fonctionnement cognitif, d’une aptitude à comprendre, de sa représentation social, des troubles de l'hygiène, de la régulation des émotions, de la capacité à entreprendre ou planifier des actions centrées sur des buts. C’était la raison pour laquelle aux tourments du malade s’ajoutait le désarroi des proches. Pour ne rien n’arranger, l'espérance de vie des personnes touchées était estimée inférieure de douze à quinze ans à l'espérance de vie moyenne. Que chez la personne schizophrène elle-même, la consommation de drogues et l'exposition à des stimulations sociales ou émotionnelles invasives précipitaient les phases aiguës de la maladie. Que la schizophrénie était couramment traitée par la prise de médicaments antipsychotiques qui prévenaient les phases aiguës ou diminuait l'intensité des symptômes. Que certaines formes de psychothérapie et de soutien éducatif étaient souvent prodiguées parce qu'elles favorisaient aussi le maintien de la personne sur le marché du travail et dans la communauté. Que dans les cas les plus sévères - lorsque l'individu présentait un risque pour lui-même ou pour les autres -, une hospitalisation pouvait être nécessaire. Que de nos jours, les hospitalisations étaient moins longues et moins fréquentes qu'elles ne l'étaient auparavant. Mais que cependant, seule une petite minorité de personnes souffrant de troubles mentaux adoptait un comportement dangereux pour les autres et que pour prolonger le cadre de cet ouvrage, le professeur Lester Nash abordait toutes ses questions et tentait de répondre par son approche aussi didactique que technique aux malades, à leur famille et aux praticiens du monde entier.
Crédit : Contenu soumis à la licence CC-BY-SA 3.0.
Source remixée : Article Schizophrénie de Wikipédia en français (auteurs)
Les livres de sciences
Je me plongeais également dans la lecture des trois ouvrages concernant les technologies des ondes électromagnétiques: « La diffusion de la lumière par les ondes ». « La représentation 3D grâce à la triangulation au laser », et « La combinaison des infrarouges ».
Je fus très intéressé par ce que j’appris dans le principe de la diffusion dynamique de la lumière:
Que lorsque la lumière d'un laser atteint des petites particules dans une micro cuvette, la lumière diffusait dans toutes les directions. Que ce phénomène était principalement de la diffusion de Rayleigh, diffusion élastique où les particules étaient plus petites que la longueur d'onde considérée. On pouvait mesurer l'intensité de la lumière diffusée par les particules à un angle considéré au cours du temps. Cette dépendance en temps-réel venait du fait que les particules dans un liquide étaient soumises au mouvement brownien à cause de l'agitation thermique. La distance entre diffuseurs, la concentration locale, change ainsi sans cesse. Il en résultait des interférences constructives ou destructives et l'intensité totale mesurée contenait des informations sur la vitesse de mouvement des particules.
Sur ce que j’obtenais comme information sur le laser :
Qu’un laser était un appareil qui produisait un rayonnement spatialement et temporellement cohérent basé sur l'effet laser. Qu’au XXIe siècle, le laser est plus généralement vu comme une source possible pour tout rayonnement électromagnétique, dont fait partie la lumière. Que les longueurs d'ondes concernées étaient d'abord les micro-ondes (maser), puis elles se sont étendues aux domaines de l'infrarouge, du visible, de l'ultraviolet et commencent même à s'appliquer aux rayons X.
Le type de laser dont les travaux de recherche avaient probablement débouché sur le projet de télésurveillance devait être à gaz, atomiques ou moléculaires.
Que le milieu générateur de photons était un gaz contenu dans un tube en verre ou en quartz et que le faisceau émis étai particulièrement étroit et la fréquence d'émission était très peu étendue. Parmi les exemples les plus connus étaient les lasers à hélium néon, utilisés dans les systèmes d'alignement. De catégorie de classe 1 à balayage : ce qui les rendait comme lasers sans danger, à condition de les utiliser dans leurs conditions raisonnables prévisibles. Cette classe 1 avait été déterminée en fonction des lésions que pouvait provoquer un laser, elles variaient en fonction de la fréquence du laser, les lasers infrarouge et ultraviolet étant bien plus dangereux que le laser visible.
Crédit: Contenu soumis à la licence CC-BY-SA 3.0.
Source remixée : Article Rayon X de Wikipédia en français (auteurs)
Puis ensuite, sur les ondes infrarouges :
Que le rayonnement infrarouge était un rayonnement électromagnétique d'une longueur d'onde supérieure à celle de la lumière visible mais plus courte que celle des micro-ondes. Qu’avec les rayonnements qui étaient utilisés pour analyser la matière, les atomes étaient trop petits pour être visibles ou palpables, on ne pouvait donc les connaître que de manière indirecte. C’était pourquoi quand on observait la manière dont ils perturbaient un rayonnement, on a constaté qu’il existait une méthode de diffraction lorsque les atomes étaient organisées de manière ordonné, l'étude de cette répartition spatiale de l'intensité diffusée permit de caractériser l'organisation de la matière
[ ].
Que l'infrarouge était associé à la chaleur car, à température ambiante ordinaire, les objets émettaient spontanément des radiations dans le domaine infrarouge ; la relation était modélisée par la loi du rayonnement du corps noir dite aussi loi de Planck. Car tout corps à une température supérieure à 0 kelvin ou zéro absolu°C émettait un rayonnement électromagnétique appelé rayonnement thermique ou rayonnement du corps noir. [ ].
Complété par l'écossais John Leslie, un mathématicien et physicien qui avait mis au point le cube de Leslie, un dispositif destiné à démontrer et calculer la valeur d'émissivité thermique de chaque matériau selon sa nature et sa géométrie. Le découpage pouvait être lié à la longueur d'onde ou à sa fréquence avec les émetteurs, ou encore aux bandes de transmission électromagnétique [ ].
Je fus surpris également d’apprendre que les équipements de vision traditionnelle de nuit, comme la caméra infrarouge de la fin du XXIe siècle utilisaient les infrarouges lorsque la quantité de lumière visible était trop faible pour voir les objets. Que le rayonnement était détecté, puis amplifié pour l'afficher sur un écran, les objets les plus chauds semblant être les plus lumineux. Dans ce cas présent, un projecteur d'infrarouge associé au système de vision par triangulation 3D laser, permettait de visualiser des objets sans chaleur intrinsèque, par calcul, cette lumière étant émise hors du spectre visible. La capture des volumes et de ces images par des systèmes numériques, pouvait être faite sur les longueurs d'ondes correspondantes à l'infrarouge. On pouvait en même temps apprécier ces images pour leur intérêt artistique car elles montraient des scènes à l'ambiance étrange, aux couleurs crûes dans une génération de style inconnue pour l’œil public [ ].
Crédit : Contenu soumis à la licence CC-BY-SA 3.0.
Source remixée : Article Infrarouge de Wikipédia en français (auteurs)
Pour des raisons historiques, ces ondes électromagnétiques étaient désignées par différents termes, en fonction des gammes de fréquence, ou appelé également de « longueur d'onde ». Par longueur d'onde décroissante, les ondes radio et les ondes radar étaient produites par des courants électriques de haute fréquence. La longueur d'onde avait une importance historique et pratique en optique et au XIXe siècle, Joseph von Fraunhofer étudiait, déjà, le spectre solaire. La variation de vitesse provoquait, au passage d'un milieu à un autre, des réfractions. Quand la célérité de la lumière variait, la longueur d'onde en faisait autant. Cette variation dépendait légèrement de la fréquence, ce qui causait aussi de la dispersion [ ].
Crédit : Contenu soumis à la licence CC-BY-SA 3.0.
Source remixée : Article Ondes électromagnétiques de Wikipédia en français (auteurs)
Le retour à l’hôtel
L’air avait fraîchis, il était seize heures trente, les nuages masquaient maintenant le soleil et je voulais m’allonger sur un lit. C’est pourquoi, je décidais de rentrer en taxi. Alors que je consultais mes messages sur mon téléphone, je devais me rendre compte qu’ils étaient près d’une dizaine tous venant de ma mère et dont l’un était de mon beau père mais je ne les écoutais pas. C’est une fois que je fus à l’hôtel, qu’un par un, j’examinais leur contenu puis méthodiquement, je les effaçais sans l’ombre d’un regret comme un être psychorigide face à tous les bons sentiments de la terre. Il fallait que je me débarrasse de mon Dphone, car en fonction de la possibilité qu’apportait la géolocalisation l’endroit où je me trouvais pouvait être repérer, en s’inquiétant de ma fugue inopiné de chez mes parents, loin de l’hôpital, je pouvais être amené à être recherché puis appréhendé pour une non soumission au contrôle de santé publique, peut être que j’étais même, déjà, repéré. Pas rassuré et un peu en colère d’avoir omis ce détail qui compromettait ma liberté retrouvé, dans le doute, tout de même, j’enlevais la puce du terminal de chez Seatle. Puis je m’endormais tout habiller sur le lit, la télévision allumée. A mon réveil, je visionnais l’émission « Débat du jour » sur C4A avec Marina Dirisi avec Ivan Taleb qui présentait le journal télévisée, les premières vingt minutes. Il était question d’un attentat kamikaze à Marseille qui visait un commissariat. L’acte n’avait pas été revendiqué. Une fois le Journal Télévisé terminé, je prenais une douche et sorti dîner Porte de Champerret dans un restaurant Cambodgien dans lequel nous avions eu nos habitudes, mes parents et moi. Il s’agissait du Phénix de Phnom Penh, mais je ne savais pas, s’il existait toujours ou si les propriétaires avaient changés. De retour à l’hôtel, je me posais devant la télévision pour regarder les émissions de la soirée. Ils commentaient, évidement, l’attentat de Marseille mais surtout, je décomptais les minutes qui me séparaient de l’émission d’Elisabeth.
Chapitre 9) La rencontre
Dans l’immeuble
C’est à peine si le standardiste de l’hôtel leva les yeux de son écran quand il me dit bonsoir mais je sentis par son ton qu’il était tout de même surpris de me voir sortir à minuit passé dans la nuit noire de ce tranquille quartier du dix-septième arrondissement. Deux minutes plus tard, j’étais au pied de l’immeuble d’Elisabeth et je sortis de mon sac une radiographie médicale, cette feuille de plastique me permit en la glissant dans l’interstice de la porte et de son chambranle, d’ouvrir le loquet. Une fois dans le hall, je réitérai mon opération avec la porte qui menait aux escaliers et je m’assurais au préalable que près de l’interphone, se trouvait bien le nom de Strassman. Au premier étage, il y avait un local de compteurs électriques, qui devait me servir de pièce de retrait, au cas où quelqu’un s’aventurerait dans les étages et j’attendis le retour d’Elisabeth. Il était possible qu’elle ne soit pas seule, quelqu’un pouvait l’attendre chez elle mais confiant et résolument optimiste, j’avais balayé de ma tête ces hypothèses qui m’auraient arrêté si je les avais prisent en considération ne serait-ce qu’un instant. Au bout d’une demi-heure assis dans l’obscurité en haut des marches du premier étage de l’escalier, à l’affût du moindre bruit dans l’immeuble, j’entendis le son électrique de la première porte qui s’ouvrait, retenant mon souffle, la lumière s’allumait et j’entendis des talons qui résonnaient sur les dalles de pierres de l’entrée. Après un bref coup d’œil, je constatais que c’était bien Elisabeth qui rentrait dans l’ascenseur, sur le côté, pour ne pas être vu, je le laissais passer à l’étage et j’emboîtais sa progression en m’engageant dans les escaliers. Au quatrième, il stoppa et alors que j’étais haletant au troisième, j’hésitais à continuer ma course. Me ravisant, je repris ma respiration et monta les dernières marches quatre à quatre. Elisabeth sortait de l’habitacle quand j’arrivais à sa hauteur, elle fut, certes, surprise, je le sentis, tout de suite, c’est pourquoi, je pris la parole le premier pour la rassurer et pour éviter qu’elle ne crie.
-Je suis Lionel Gauthier c’est moi qui vous ait écrit, j’ai besoin de vous parler c’est extrêmement important, il s’agit d’un projet secret défense, il me faut vingt minutes pour vous l’expliquez
M’observant de la tête au pied, elle finit par me dire d’une façon impassible, ne sachant si j’allais sortir une arme en cas d’un refus de sa part.
- D’accord, je vous laisse une demi-heure. –
Chez elle
Elle me fit rentrer le premier dans l’appartement et m’accompagna dans le salon où elle déposait son sac dans l’un des fauteuils qui ornait la pièce. Je m’asseyais dans le canapé et sortis mon ordinateur de mon sac à dos, elle semblait agacé que je vienne ainsi la déranger dans son havre de paix, chez elle, l’endroit où elle était certaine de ne pas être jauger, juger par des esprits retors ou frondeurs et me dit en soupirant comme si j’allais lui annoncer que la pluie en général avait pour effet de mouiller ceux qui y était exposé. Je la regardais sous la lueur d’une lampe halogène et elle me paraissait moins jeune que sous la lumière des projecteurs d’un plateau de télévision, on pouvait remarquer que sans maquillage certaines minuscules rides près des yeux attiraient l’attention, elle était tout aussi désirable qu’à l’écran mais avec une dimension, moins éclatante, moins lumineuse que l’idée que je m’en faisais. Sur un ton un peu sec, elle me posa la question suivante :
- Alors de quoi s’agit-il ? On veut tuer le président des Etats-Unis ?
Je lui expliquai en détail le cheminement de mes découvertes et lui racontait toute l’histoire n’excluant aucun détail. Toutefois, je me gardais de bien lui raconter mon parcours de malade mentale qui aurait pu entacher son discernement et voir en moi un homme à l’intégrité intellectuelle et mentale qui n’était pas hors de soupçon. Sur mes activités, je précisais uniquement que j’étais un développeur informatique qui habitait en province sans donner plus de renseignements. Je ne voulais pas qu’elle en sache plus car ça pouvait ternir son jugement sur moi. J’essayais d’être le plus clair possible et fort d’avoir des documents en ma possession, j’étayais sans cesse avec des mots simples mais consistants l’histoire qui me tenait en alerte depuis maintenant quinze jours. Elle me posait des questions précises et la seule évocation de ces sujets confirmait le fait qu’elle comprenait ce que je lui racontais et elle semblait en prendre toute la gravité qui s’imposait. Elle avait des hypothèses car au moment où je répondais dans la confirmation de ses suppositions, elle acquiesçait d’un hochement de tête. Toutefois quelque peu dubitative, elle exprimait aussi des doutes et j’avais cette impression, qu’elle voulait avoir la confirmation de ce que j’avançais, qu’elle voulait me prendre en défaut en étant sûr et certaine que je ne racontais pas des sottises, elle faisait en sorte que je sois à court d’arguments ou sinon désarçonné par la fulgurance des interrogations qu’elle soulevait. La conformité dans laquelle, nous étions tous les deux, m’impressionnait. Je ne me dérobais à aucune question même avec l’appréhension d’être parfois un peu technique, il ne fallait éluder aucun détail ou éviter un sujet qui aurait pu être négligé, bien que j’avais parfois, un peu de mal à trouver mes mots.
Elle me proposait de boire un verre et m’énuméra ce qu’elle avait de disponible, elle m’offrit un whisky alors qu’elle se contentait d’un verre de vin blanc. Elle semblait curieuse, j’excitais vivement son intriguant intérêt, son désir de savoir, la singularité de mon histoire plus les effets de l’alcool suscita chez elle, un sentiment totale à la fois de curiosité entremêlé de gentillesse, et une attention qui était à la fois de merveilleuse et à la fois extravagante avec l’histoire de la télésurveillance. Après lui avoir montré toutes les preuves que j’avais accumulées comme les courriers, je lui montrais le logiciel et les images capturées par le logiciel puis après avoir porté à ses lèvres le verre de vin, elle me dit :
- Vous seriez prêt à me confier ces documents ?
Je lui répondais :
Ça dépend, il faudrait une action coordonnée pour prévenir plusieurs médias, les journaux, les télévisions, internet.
- Pour cela, il faut les convaincre et c’est mon rôle mais sans preuves nous n’irons pas loin, me dit-elle -
- Je ne veux pas que mon nom soit cité, je vous donne les preuves et ensuite vous pouvez vous débrouillez avec. Les conséquences, je ne veux pas les connaître et cette affaire ne me concernera plus, je n’en n’attends rien, elle m’encombre cette histoire.
- Personne ne sera au courant vous pouvez en avoir l’assurance et je n’ai pas l’habitude de donner mes contacts.
Je ne rechignais pas sur un second verre de whisky et elle s’éclipsa de la pièce, un instant, elle revint habiller par un kimono de soie avec des motifs en idéogramme, se posa devant moi et faisant glisser de ses épaule la frêle étoffe, me dit :
- Tu veux ?
Je répondais :
- Bien sûr.
Puis je sentis le parfum de ses lèvres encore parfumé par l’alcool sur ma bouche.
Au siège
Le lendemain vers 9 heures nous sommes arrivés dans les locaux de News-Tv qui se trouvait non loin de la tour Montparnasse. Elisabeth avait déjà passé au préalable, deux coups de téléphone pour fixer l’heure d’une réunion avec les responsables de l’antenne et nous étions attendus. Elle n’en avait pas trop dit, néanmoins, elle avait stipulée, que cette réunion était d’une extrême urgence. Je n’arrêtais pas de suivre Elisabeth avec l’impression que je ressemblais à un jeune chien dont la laisse aurait été coupé mais en se rappelant de la main qui le caressait et plus utile encore, qui lui donnait à manger. Tout le monde à notre contact ne fit semblant de rien. Quoiqu’il en fût des considérations canines et de l’attention que l’on y portait, la réunion eut lieu à dix heures trente précise.
Posant ses lunettes sur la table, Elisabeth exposa dans les grandes lignes ce que je lui avais rapporté la veille et dans un long argumentaire donnait un certain nombre de détail en répétant à mon intention par deux fois,
- Tu m’arrêtes si je me trompe.
Ce que je me gardais bien de faire et la raison en était fort simple, cette fille avait très bien compris mon discours et plus encore elle donnait les perspectives à court et à long termes que pouvait avoir l’écho d’une telle information et pour que d’un seul coup toute la sphère politico -médiatique puis le grand public connaisse la nature du projet secret. Thierry Oléron le directeur d’antenne, les mains sur la tête, l’écoutais et posa quelques questions auxquelles, elle répondit avec justesse. Cécile Chartier, la rédactrice en chef de la chaîne, manipulait son stylo d’un air incrédule et sceptique en réaction à ce qu’elle entendait. L’incertitude qu’elle manifestait vis-à-vis d’Elisabeth et cette histoire l’avait rendue perplexe et face à cette indécision, elle reprit son assurance alors que nous lui faisions lire les courriers venant de la DGSI. Thierry restait de longue minute sur le logiciel que je lui désignais sur le vieux portable, il me posa quelques questions d’ordre technique sur lesquelles, je n’avais aucune difficulté à répondre. Puis, il consultait la correspondance entre Duchaussout et sa hiérarchie. La réunion se termina vers treize heures, à son issue, nous étions tous d’accord pour mettre au jour cette affaire quoiqu’en soit les conséquences pour les carrières de chacun car des occasions comme celle-ci étaient rares dans la vie des professionnelles des médias c’est pourquoi et malgré la faible résistance de Cécile Chartier qui restait elle, un peu sceptique, nous avons décidé de partir déjeuner dans un petit restaurant bien connu de toute l’équipe pour continuer à parler des directives à appliquer. La côte de bœuf était un petit restaurant qui ne payait pas de mine, c’était l’archétype parfait du petit bistrot parisien avec le menu du jour inscrit à la craie blanche sur une grande ardoise. Les nappes à carreaux rouges et blanches et l’intérieur en bois patiné donnaient un petit air kitch qui devait plaire aux touristes égarés comme à ceux dont les commentaires sur Internet avaient fait saliver. D’un bloc, Thierry et Cécile choisirent le poulet aux tagliatelles et aux morilles et Elisabeth opta pour le lapin aux pruneaux, tandis que moi ce qui retenait mon attention ce fut la brochette de bœuf. Thierry et Elisabeth présentaient un air bravache qui me surprit de prime abord, l’atmosphère se détendait et les plats furent apportés. On arrosait le tout, avec une bouteille de Bourgogne qui s’avéra un peu juste pour nous quatre bien que Cécile buvait exclusivement de l’eau.
Avec les journalistes
La conférence de rédaction s’est tenue vers quinze heures avec la totalité des journalistes qui étaient présent au siège de la chaîne. Il y avait l’équipe du matin avec Steve Stanin et les quatre chroniqueurs de l’émission : « Débrief Matin », dont l’audience était la plus haute et la plus commenté sur les réseaux sociaux. Christophe Sabrier l’éditorialiste politique et rédacteur en chef de l’hebdomadaire : « Parenthèses politique » était présent. Il y avait également, le couple phare de la tranche horaire dix-huit/vingt heures, Carola Barnot-Janssen et Thomas Cordi qui étaient réunis pour assister à l’évènement. Tout le monde était très concentré car depuis le matin, avec mon arrivé et cette réunion à huit clos et impromptue, la rumeur avait fait place à des controverses imaginatives et il planait comme un vent de tension dans la rédaction, un peu comme l’atmosphère qui régnait avant les résultats définitifs d’un second tour des élections présidentielles. Malgré le secret que nous avions maintenu et afin que l’effet de surprise ne provoque un affolement dans les couloirs de la chaîne, nous avions tenu le silence jusqu’à lors et il avait été respecté entre les quatre personnes qui était au courant de l’affaire. Dans la salle de réunion, certains étaient debout et la trentaine de personnes qui étaient présentes tentaient tant bien que mal de prendre des notes. C’est Thierry qui prit la parole et dévoilait dans les grandes lignes la situation. Il expliqua comment par des sources sûres, on avait découvert l’existence de preuves irréfutables qui accablait l’Etat et en particulier le ministre de l’Intérieur. Une partie des journalistes à l’évocation du terme « preuves irréfutables » se tournait alors vers moi en pensant que je n’étais pas là, par hasard et l’on entendit comme une sorte de rumeur à cet instant précis. A cela, je souriais bêtement en clignant des paupières. Thierry précisait également que le scoop devait être sorti après-demain matin, le jeudi et qu’il exigeait le secret durant toute cette période. La coordination avec le journal Résistance pour la presse traditionnelle et avec l’International Post, en plus, pour la couverture Internet, devait être totale, Thierry indiquait ainsi que dès à présent, il était en pleine négociation avec Eddy Jaffrat et Anne Dintail pour la simultanéité des déclarations. Pour chacun de ces deux médias, huit pages devaient être exclusivement réservé à la nouvelle, c’était à la Une et annoncé comme l’information du siècle. Pour conclure, Elisabeth prit la parole pour indiquer une fois encore, qu’elle tenait, elle et Thierry à une extrême discrétion sur l’affaire en affirmant que le bon déroulement de cette opération en dépendait en partie. J’étais là, dans un coin les yeux rivés sur Elisabeth à l’affût d’un de ses regards. Puis, quand elle eut terminée, ce fut au tour des questions que l’auditoire devait poser, je reconnaissais Valentine Cornièze envoyé spéciale souvent présente lors de direct dans les Balkans qui tenait à poser sa question à Elisabeth, c’est alors qu’une pluie de questions nouvelles furent soulevés dans les rangs des journalistes. Je fus contraint à prendre la parole mais un peu impressionné, j’avais un discours confus au départ dont les contours étaient flous et vagues, puis en prenant conscience que mon propos n’était pas à la mesure de mon niveau d’explication, je me reprenait en faisant fi de ma timidité, je m’exprimais le mieux possible devant l’auditoire. A l’issue de la réunion, Elisabeth vint vers moi et me dit :
- Pendant vingt-quatre heures, je n’aurais pas beaucoup de temps à te consacrer, alors tu t’occupes comme tu peux et on se retrouve après l’émission de ce soir, ça te va ?
J’acquiesçais dépité de sentir, qu’elle m’échappait, que je ne comptais plus pour elle. J’étais vexé qu’elle me traite avec autant peu de considération car j’aurais voulu rester dans son bureau à écouter le son de son stylo Grain-blanc à trois mille euros sur le papier alors qu’avec mon stylo à bille, j’écrivais quelques romances qui auraient dû la combler. Alors qu’elle rentrait dans son bureau, je l’a suivais pour récupérer mon sac. Tout au long du restant de l’après-midi, je fus sollicité par plusieurs journalistes de différentes émissions, ce n’était pas ceux dont on avait l’habitude de voir le visage à l’antenne, c’était plutôt des travailleurs de l’ombre, des rédacteurs dont les textes étaient lus par d’autres. Leurs questions étaient pointues mais c’était devenu la routine et je leur répondais avec la manière et la forme car j’avais pris pour habitude de savoir rebondir et d’anticiper en fonction des réponses que je leur fournissais, à grand renfort de détail éclairant. Leur stupeur face à mes affirmations les laissait parfois silencieux puis quand ils avaient pleinement prit conscience de la signification portée à chacune de mes paroles, c’était à leur tour de rebondir et d’appuyer les faits avérés à leur raisonnement. C’est alors que mon témoignage consolidé, prenait toute sa dimension d’incroyable récit, avec les preuves que j’avais en ma possession et qui étaient irréfutables. J’avais la méthode du discours, je maîtrisais parfaitement les rouages qui donnaient à cette histoire la véracité indiscutable des faits. Je sentais que parfois le doute devait continuer à planer dans mes affirmations et que je n’arrivais pas à persuader mes semblables car ce que j’expliquais était à la fois surprenant et effrayant. On avait vu dans la littérature de science-fiction de la fin du XXe siècle des histoires similaires et elle avait tôt fait de marquer les esprits et de défrayer la chronique en posant d’immenses interrogations sur le devenir de nos sociétés occidentales. Ce que l’on pouvait en retenir, c’est de penser que de la fiction, des petits génies avaient mis en applications ce qu’ils avaient vu dans quelques films hollywoodiens et la réalité avait dépassé l’œuvre imaginée. Que de l’étincelle dans un cerveau humain, on avait fait jaillir une réalité qui se voulait moins sombre qu’une société liberticide avec des relents de démocratie complémentaire. Mais pouvait-il en être autrement alors que la violence des faits, ramenait à penser que chaque citoyen pouvait être soumis au contrôle. Au nom de n’importe quelle cause, n’importe quel sujet puisque soustrait au regard de la nation toute entière. Tout en ayant confisqué à la société cette capacité à s’indigner, on s’arrangeait avec la possibilité d’entendre la voix du peuple pour discuter du cadre établi. Dans le projet de télésurveillance, le cadre qui unissait ses protagonistes avait été balayé par le pouvoir mais il n’était pas dit que les parlementaires ne connaissent pas aussi l’existence du projet et y souscrivent dans le cadre de la répression contre un terrorisme grandissant. En tout cas, c’était toute, l’assemblée dans un complot ourdi qui s’était levé d’un seul bon pour faire valoir les avancées technologiques que le pays était en mesure de fournir. Mais comment admettre que le secret avait été aussi bien tenu. On avait droit, soit, à un simulacre de démocratie avec des députés complices, soit le complot d’un gouvernement s’apparentant à une dictature dans une entreprise policière et technocratique et dans les deux cas la voix du peuple avait été atrophié, réduite à néant.
Je restais pendant toute la fin de l’après-midi dans la salle de réunion et je faisais des allers et retours entre le distributeur de café et mon siège. Puis, vers dix-huit heures, je regardais à travers la baie vitrée du couloir et j’observais la pièce occupé par la régie finale qui ne rassemblait qu’une dizaine de personne toutes concentrées vers le mur d’images et les consoles aux multiples paramètres disséminés en face d’eux. Cette pièce servait à récupérer, à mélanger, à monter, puis à diffuser les images qui passaient à l’écran. Visiblement, ça ne devait pas plaire à tout le monde que je reste, là, dans le couloir, à observer le théâtre des opérations. Au bout de cinq minutes, une femme d’une trentaine d’année qui devait probablement être l’assistante du réalisateur vint me dire, presque en s’excusant que si j’avais la gentillesse de les laisser travailler, ils m’en seraient très reconnaissants. Je ne voyais pas en quoi je pouvais les gêner mais j’obtempérais sur le champ en ramassant mon sac à dos.
Sur le plateau
Je me dirigeais vers les plateaux de télévision où un climat de tension régnait car il était dix-huit heures et Jean-Marie de Squemec accompagné par un colossale garde du corps Russe, venait de sortir de la salle de maquillage. J’observais un instant le bal des caméras auto dirigées qui se déplaçaient silencieusement devant les présentateurs. De la place où j’étais j’entendais à peine leurs paroles mais pendant les séquences où ils n’étaient pas à l’antenne, ils discutaient encore avec le réalisateur et les gens qui s’activaient sur le plateau. Ils répondaient à une voix ne venant de nulle autre part que d’une oreillette, tout en élevant la leur de façon à être parfaitement compris dans le micro de l’antenne. Surprise par le retour, brutal du direct, Justine Courjeune s’arrêta en pleine phrase ce qui pour le téléspectateur peut faire très mauvaise impression, pour reprendre le cours du journal. Une personne de la sécurité vint à ma rencontre et à nouveau, on venait m’annoncer que je ne pouvais pas rester-là et que si j’avais l’obligeance de partir, ils m’en seraient gré. C’était bon, j’en avais assez de leurs plates excuses et de leur bienveillance de circonstance pour me faire déguerpir. Je leur avais apporté la primeur de l’information du siècle et ils me jetaient comme un chien galeux. Résolu, je quittais les lieux pour rejoindre l’hôtel que j’avais laissé, il y avait presque vingt quatre heures.
A l’hôtel
Vers minuit, je replaçais la puce dans mon DPhone et téléphonais à Elisabeth. Nous avons brièvement évoqué l’affaire et elle précisait que nous ne pouvions finalement pas nous voir ce soir. Elle était froide, presque sévère à la limite de l’humanité et elle m’expliqua que si elle m’avait eu dans son lit c’était uniquement parce que j’avais été repérer auparavant et qu’elle ne craignait pas grand-chose, elle ajouta d’une voix sèche et méprisante comme le couperet d’une lame de métal qui tranche la nuque d’un innocent.
- On savait déjà tout de toi alors que tu regardais « Débat du jour » en différé, monsieur le pirate des Caraïbes.
Sidérer par cette nouvelle qui rétrospectivement ne devait pas tant m’étonner, je n’insistais pas. Une fois le téléphone éteint, j’étais contrarié et atterré et je restais assis sur le lit pendant quelques minutes. En moins d’un jour, j’avais obtenu beaucoup, puis j’avais la sensation d’avoir tout perdu, quasiment sur un simple effet du sort. J’avais tenu dans mes bras, une femme qui représentait à mes yeux, la quintessence humaine incarnée, j’avais été amené à établir ce qui servirait de poutre principale à l’élaboration d’articles pour soutenir une nouvelle exclusive et dont la portée avait des conséquences nationales voire internationales et j’étais là, ce soir, loin de tout, seul au monde, seul contre tous, réduit à ce que nous étions au final, de la naissance, seul jusqu’à la fin.
Chapitre 10) A la DGSI
La police à l’hôtel
On frappa à la porte de manière énergique mais sans faire de raffut tonitruant et je compris que c’était important, qu’il me fallait ouvrir. Juste le temps d’enfiler mon pantalon et mettre un tee-shirt, un peu hagard, j’entrebâillais la porte. Aussitôt, l’un des deux hommes qui se tenait devant moi me dit d’une voix ferme en brandissant une carte de police qu’il fallait les suivre, que la police voulait me poser quelques questions. Il m’appela par mon nom et j’ai eu la sensation d’avoir été démasqué, je n’allais cependant pas m’échapper en me précipitant vers la fenêtre de la salle de bain. J’enfilais tranquillement mes R-Snickers tout en pensant qu’il aurait fallu tôt ou tard s’attendre à ce type de situation, qu’elle était prévisible et ne pas s’étonner par cette venue de ces deux représentants de l’ordre. Je n’ouvris pas la bouche pendant que je m’habillais sauf pour poser la question, s’il était nécessaire que je rassemble toutes mes affaires et les prendre avec moi. Le second policier qui n’avait pas encore ouvert la bouche, me répondit que ce n’était pas utile. Il fallait uniquement, m’habiller et les suivre et que pour l’instant, c’était tout ce que l’on me demandait. Avant de partir, il s’assura par une fouille au corps que je ne disposais pas d’arme dissimulée sur moi. Rassurés, ils m’encadrèrent sur le chemin de l’extérieur de l’hôtel ou discrètement, je montais dans un véhicule de couleur sombre garé sur une aire de stationnement privé. La voiture démarra et cent mètres plus loin, fit retentir sa sirène qui l’exonérait de suivre avec attention les priorités et les feux rouges tandis que sur le toit un gyrophare amovible de couleur bleu appuyait le caractère officiel par sa répétitive fonction. Le trajet ne fut pas très long que cela soit en termes de distance comme en termes de durée car environ huit minutes plus tard, la voiture rentrait dans la cour d’un immeuble que je reconnaissais comme le siège de la DGSI à Levallois-Perret. J’avais eu l’occasion de voir la façade lors de reportage sur la chaîne d’information. On me fit patienter dans une sorte de salle d’attente près du hall d’accueil en présence d’un policier en uniforme au seuil de la porte qui s’assurait que je ne prenne pas la fuite.
Dans la salle d’attente
Tout en regardant autour de moi, je me suis mis à réfléchir sur les questions qui m’avaient assaillies depuis ce que je considérais comme mon arrestation. Etait-ce l’usage répétitif de mon téléphone portable qui m’avait trahis et fait découvrir aux autorités le lieu où je séjournais ? En tout cas, ce ne devait pas avoir un lien évidement, avec l’hôpital mais bel et bien avec l’affaire, avais-je été pisté par cet effroyable agent de renseignement que représentait ce logiciel ? Etais-ce Elisabeth ou la direction de News-Tv qui m’avait donné ? Est-ce que mon passé m’avait rattrapé après qu’ils aient pris des renseignements sur moi ? Autant de questions qui se posaient à moi comme un leitmotiv, comme une idée récurrente, un trouble obsessionnelle incessant. Ce passage dans cette pièce agis sur moi comme une catharsis qui me faisait prendre conscience du taux de désagrément qui allait s’abattre sur moi et j’arrivais à en circonscrire toute la dimension. Toutefois je n’en étais réduit qu’à des conjectures.
Dans le bureau de Raubier
Puis, après une demi-heure d’attente, un homme, aux cheveux coupés en brosse, au costume gris claire et à la cravate jaune avec des motifs vint me demander de le suivre. Il m’accompagna jusqu’à son bureau et nous fumes rejoins par l’un des deux fonctionnaires qui était venu me chercher à l’hôtel. Le bureau était spacieux et j’ai tout de suite compris que j’avais à faire avec un haut fonctionnaire pas un agent de la circulation, Il me fit asseoir dans l’un des fauteuils qui était situé en face de son bureau, alors que son homologue prit une chaise et la disposait sur ma droite. Il poussa sur le côté gauche une pile de dossier et reposant à plat ses deux mains me dit d’un ton assuré :
- Monsieur Gauthier, nous ne sommes pas là, pour perdre du temps et en tant que directeur général adjoint de la sécurité intérieure, j’ai un certain nombre de devoir et de règles à respecter. Mon nom est Philippe Raubier et voici mon collaborateur monsieur Dallet qui vous a amené jusqu’à nous.
Tout en l’écoutant et très intimidé par la solennité des propos que je venais d’entendre et anticipant le pire des scénarios. Je tordais dans tous les sens, les phalanges de mes doigts entre le pouce et l’index de ma main droite.
- Nous savons beaucoup de choses sur vous. Vous êtes célibataire, vous avez trente ans. Vous êtes soignés dans un centre de santé mentale à Dreudan, vous avez un traitement et un suivi médical vous est vivement conseillé.
Il fit une pause pour observer ma réaction. Les doigts croisés et imperturbable comme pour masquer mon ressentis, je l’écoutais comme s’il s’agissait d’un réquisitoire.
- Est-ce que vous êtes d’accord avec cette réalité ?
Cette dernière phrase me stupéfia car tout en comprenant que je devais totalement y répondre puisque c’était une question, qui me rappelait ô combien il existait entre lui et moi un vaste univers qui était une autre dimension, ailleurs que celui que nous étions censé partager. Entre lui et moi devait exister un monde fait d’une réalité qui ne se mélangeait pas. Dans sa phrase, il y avait l’absolu vérité des faits qui étaient : indéboulonnable, parce que purulent et pénétré par ma vie quotidienne depuis huit ans ; logique, parce que si j’avais un traitement, j’étais soumis forcément à un suivi médical et stigmatisant, parce que je devais être d’accord avec cette affirmation qui était conforme à sa réalité. Une réalité qu’il imaginait aller chercher très loin dans le flux et reflux de mes pensées divagantes et erronées.
Ce à quoi je lui répondais après quelques secondes d’hésitations.
- Oui, bien sûr
- C’est parfait et vous savez pourquoi, vous êtes là ? Ajouta-t-il
- Non, pas vraiment. Dis-je en baissant les yeux
Il se renfonça dans son fauteuil et me dit d’un air ironique mais sérieux.
- Eh bien moi, je vais vous le dire, puisque vous ne savez pas vraiment pourquoi vous êtes là, vous êtes sur le point de révéler au grand public tout ce pourquoi nous avons travaillé si durement depuis quinze ans. Vous voulez déstabiliser la république monsieur Gauthier et ça nous contrarie, on ne sait pas encore vraiment comment vous vous y êtes pris mais ça peut faire très mal au pays et actuellement alors que court la menace terroriste ça nous agace vraiment beaucoup monsieur Gauthier et vous en êtes conscient de tout ça ?
Je baissais la tête en regardant les mains puis je repris le manège avec mes phalanges, un peu abattus par ce que je venais d’entendre.
- J’attends de vous des explications fit-il, après trente secondes de long silence
La gorge noué, le verbe hésitant, je commençais à réciter ma lente narration sur comment j’avais piraté les ordinateurs de mes voisins puis dans l’ordre chronologique, je m’évertuais à donner d’un ton monocorde, le lent déroulement de mes exploits tout en m’appliquant à raconter dans les moindres détails, les différents rebondissements qui m’avait amené à rentrer en contact avec Elisabeth Hafnad et News-TV. Je ne cachais rien et j’en étais bien incapable car l’envie de pleurer venait à poindre. Avec des débuts de trémolos dans la voix mais reprenant mes esprits, je rassemblais mes émotions et termina mon exposé. Ils m’écoutaient avec toute l’attention qui s’imposait et ne m’interrompit pas. Alors que j’arrivais à la fin de mon analyse, Dallet me posa quelques questions sur la technique que j’avais utilisée pour pirater les Duchaussout, auxquelles je répondais sans effort. C’est alors que Raubier reprit la parole :
- Les faits que vous évoquez ici sont graves et vous mettez en danger la sécurité de l’état, nous allons vous entendre dans le cadre d’une audition.
J’hallucinais, comment pouvait-il être possible quand en moins de quarante-huit heures les choses avaient tournées aussi aigrement en ce qui me concernait. Comment James Bond le super fonctionnaire avec un balai brosse sur la tête, avait-il eu la bonne idée de me convier à faire une déclaration qui pouvait remettre en question ma précieuse liberté. Est-ce que j’allais terminer en prison à pourrir à Fleury-Mérogis ou classé fiche S et assigner à résidence comme un triste terroriste. Est-ce que je rêvais ou est-ce que l’hallucination dans une forme paranoïde de la schizophrénie allait finir par s’arrêter. Intérieurement, je bouillonnais mais je savais que si je n’arrivais pas à me contrôler dans cet univers clos du bureau de Raubier, j’allais aggraver mon cas et ce n’était pas le moment.
- Veuillez me suivre. Me dit Dallet.
Laissant Raubier dans son bureau qui me lança alors que je franchissais la porte.
- On se reverra, monsieur Gauthier
Puis Dallet m’entraîna dans un bureau au troisième étage de l’édifice.
J’avais une menace tellement redoutable et je ne voulais plus retourner en première ligne et m’exprimer mais nos destins se croisaient et les rôles s’entremêlaient entre les fonctionnaires de la DGSI et moi. Même, si je n’avais pas à m’expliquer, j’y étais forcé, encerclé avec des explications qui étaient décodés de façon critique. Alors dites-moi monsieur Dallet, ce que je devais dire, car ça m’évitait de réciter une phrase entière dans un personnage qui pleure. D’ailleurs, pourquoi ce ne serait pas normal, de pleurer car c’est une question assez simple et j’avais une gamme assez originale mais je n’ai pas aimé ce matin-là. Ça peut paraitre paradoxal mais le travail des pirates informatiques, je trouvais que l’on en parlait mal et on les mettait dans un environnement qui n’était pas sain. J’avais lu des textes appropriés et en fait, on était libre de son destin où aucun ne parle de son enfance et qu’est-ce que je disais, que j’aimais la vie en premier lieu avec l’application Mixos mais Dallet ce n’était pas mon frère jumeau et c’était lui qui exagérait avec ses questions. Je supposais qu’ils cherchaient des volontaires pour une éventuelle coopération, car les questions elles étaient meilleures qu’avant. Mais Il semblerait que la première des réponses données c’était conforme à ce qu’ils savaient déjà et j’ai, tout de suite compris, que ma nouvelle politique interne, on devait la garder en mémoire avec ce qu’il s’était déroulé, il y a quinze jours. Ecorné par les nécessités avec des termes qu’ils utilisent dans les affaires d’attentats, je me demandais, si nous étions dans un état policier. Il y avait des choses tragiques et mon sentiment, c’est qu’il y avait des gens qui voulait s’inscrire dans ma Une et qui ont basculé dans une action de faiblesse. D’ailleurs, il aurait fallu trois éléments, alors retour sur cette heure qui avait tout changé pour les téléspectateurs qui nous auraient écouté. Car en plus, ils ne l’auraient pas volé avec une palette de mesure que l’Etat utilisait contre nous et pour cela, Dallet allait chercher un coupable disparu depuis vingt quatre heures. J’essayais quand même de minimiser les faits et ce qui était remis en cause surtout, c’était le travail de la police. Peut-être qu’ils nous diront comment, ils comptaient rénover le bateau de fond en comble car une fois que c’est grillé, on enlève la carapace et je vous raconte ce que j’ai vécu et vous avez encore plus peur quand ils auront des casques, des caméras, des enregistreurs et des micros. Avec un psychologue pour discuter, surtout, je voulais qu’on sache vraiment que vous nous avez rendu notre sentiment à tous et c’est rare, pour tous ceux qui ont le sent, ont été fascinés par les rythmes envoutant de l’Inde et de son haschisch et parce que c’est un peu incongru cette chose, je vois les choses comme ça et je me relève très vite car elle sera en concert à ma table, le vingt cinq janvier à l’assemblé nationale et c’est accessible pour chacun. J’étais un grand créateur et ça m’avait choqué mon licenciement. C’était difficile à résumer mais il était quelqu’un qui avait conscience de sa finitude et c’était son anniversaire, il y a quelques jours et cette nouvelle avait enflammé les médias qui avaient dit stop à l’entourloupe un matin par semaine. Donc, le processus récriminatoire s’était amplifié et il c’était senti un peu menacé pour la nouvelle reprise et vous le voyez aussi avec vos amis les fonctionnaires. Alors ne vivez pas dans le passé, puisque, c’est la caméra qui change la gamme.
Le regard un peu perdu dans mes réflexions, Dallet me dit en haussant le ton
- Je vais vous accompagner à votre chambre d’hôtel, pour que vous puissiez réunir vos affaires et cette après-midi vous verrez le patron.
Retour vers l’hôtel
Dix minutes, plus tard nous étions Dallet, son collègue et moi dans la voiture qui devait me ramener à l’hôtel.
Ah oui, là, c’est nettement plus professionnel de faire que c’est extérieur à la France et c’était leur devoir pour protéger les citoyens, tous les citoyens. C’est vrai que mes parents étaient toujours positifs, oui, je me rappelle et c’était vrai que les enfants sont cruels car on est loin d’être parfait. Mais, c’est le deuxième plus beau jour de ma vie et j’étais en forme depuis que je m’étais réfugié dans la voiture. Personne ne pourra oublier que je me suis exprimé, en disant, que vivre dans la peur, c’était délibéré pour retrouver des formules uniques et pour ne pas prendre part de leur deuil. D’ailleurs, elle est revenue avec son fils pour lui dire que ce sera le dernier hommage sur ce qui reste une belle somme. Voilà les grands titres avec un quatre à zéro dans un concert. Oui, je trouve cela très drôle car on voit que les voitures n’ont absolument rien à voir alors que les victimes sont aussi les anciens otages jusqu’à l’explosion. Reste à savoir, si cette mesure aura un impact sur les apprentis pirates puisque c’est un bel éditorial et c’est courageux. Une fois de plus, vous vous opposez, mais avec quatre saisons dans la formule et comme on reçoit une décoration merci de ne pas dépasser le poids total de la voiture, car je crois que c’est Oscar Wilde qui le disait, mais j’ai quelques réserves que je vous dirai. Il a choisi de faire des œuvres croisées pour ne pas disparaitre comme ça et c’est difficile à expliquer. Lui, il a une femme plus vieille et le spectacle c’était lui et je vais vous offrir vos Unes avec votre meilleur souvenir sur les circuits. Car désormais, je vous vois le dimanche en train de tourner en rond et quand on regarde la grille de lecture, c’est celle de la mort et je préfère me lâcher sur scène que sur Swittech avec l’explosion des serials killer et c’est ce que l’on va voir car il nous oblige à l’engagement.
Arriver dans la chambre je me précipitais sur mes médicaments et je prenais en catastrophe deux comprimés de Foxapak avec un verre d’eau. Il était temps car depuis près d’une heure, j’étais envahi par des pensées de toutes sortes, comme assailli par des idées envahissantes qui m’empêchaient de raisonner sainement, une sorte de délire intrusif. A coup sûr, c’était le manque de médicaments qui m’avait fait atteindre cette situation ou s’entremêlait des instants de démence et des croyances incongrues.
C’est quasiment lorsque que j’avalais les neuroleptiques que Dallet reçu sur son téléphone portable un appel. Alors que je rassemblais mes affaires disséminées un peu partout dans la pièce que Dallet tout en étant au téléphone appuya sur la télécommande de la télévision et se mit à rechercher le canal seize qui s’avérait être celui de News-Tv. Dallet le téléphone à la main discutait avec un correspondant qui visiblement regardait également News-Tv. Il était midi quand les titres des informations de la mi-journée retentirent et le duo de l’info indiquait à sa Une : « Scandale aux Etats-Unis, Speaknet dénonce un système généralisé de télésurveillance ».
Puis Dallet éteignait la télévision et sorti de la pièce le téléphone toujours collé à son oreille pendant que l’autre inspecteur et moi, nous attendions qu’il est terminé. C’est à son retour qu’il fut possible de quitter les lieux et le retour à Levallois, au siège de la DGSI se fit aussi vite que quelques heures auparavant.
Chez Nividracq avec Raubier
A mon retour on fit mettre une paire de menottes à l’un de mes poignets et on m’attacha à un anneau scellé dans le béton et je patientai dans une petite pièce sans fenêtre. Une heure environ plus tard, on me conduisit dans un bureau au quatrième étage du bâtiment où l’on me fit asseoir sur l’un des deux fauteuils face à un bureau où s’entassait des piles de dossier de différentes hauteurs. Face à moi se trouvait un homme de quarante-cinq ans environ au visage émacié qui m’adressait la parole en premier.
- Monsieur Gauthier, je suis Pierre Nividracq et je vais être très clair avec vous, compte tenue de votre audition de ce matin et face aux faits qui vous sont reprochés, nous devrions porter plainte contre vous.
Il s’interrompit un instant, regarda sa montre puis reprit :
- Mais ! Car il y a un mais, en apprenant ce matin que Speaknet nous a pris de cours. La donne internationale a changé depuis ce matin. Nous pensions que cela allait sortir dans la presse tôt ou tard mais pas aussi vite. Comme nous n’avons pas la preuve que vous avez communiqué à Speaknet le résultat de vos recherches, nous ne pouvons, décemment, pas vous accuser d’être responsable de cette situation de connaissance planétaire des agissements de l’Etat au niveau américain et européen. La balle est désormais dans le camp de nos alliés, les USA. Vous nous enquiquiner monsieur Gauthier et si nous vous mettons en examen, tout pense à croire que l’on peut compter sur les journalistes pour mettre leur nez dans cette affaire et vous avez assez donné en matière d’exploits chez News-Tv. Si la presse apprenait que l’on vous poursuit, ça pourrait faire du tort à la république et vraiment, nous n’avons, pour plusieurs raisons, pas besoin de ça.
Puis après avoir regardé un instant par la fenêtre, il ajouta :
- Vous comprendrez facilement pourquoi dans l’état actuel des choses, vous poursuivre pour des faits qui relève de la petite cybercriminalité et qu’un novice aurait tout aussi pu commettre, comme vous l’avez fait, nous embête. Nous avons fauté dans l’imperméabilité de notre système de sécurité. Monsieur Duchaussout n’est pas responsable, il y a eu disfonctionnement au sein du service de notre outil informatique. En faire part à la presse, nous serait préjudiciable, nous ne pouvons pas faire abstraction de ce détail qui nous gêne. Dans ces conditions, nous avons décidé de transiger avec vous. Vous avez été diagnostiqué schizophrène en deux mille huit d’après ce que nous savons et vous semblez vouloir retrouver une activité et une vie normale, n’est-ce pas ? Nous sommes prêts à vous aider, pour cela nous vous demandons une petite contrepartie. Vous allez voir c’est infime face à ce qui vous attend si vous n’acceptez pas ou si vous ne respectez par notre accord. Ce que nous recherchons activement, c’est votre silence.
Il répéta deux fois ces deux derniers mots.
- Nous vous proposons d’entreprendre une formation de retrouver un travail dans la vie active en revanche vous faites un silence absolu sur ce que vous avez vécu à Dreudan et à Paris pendant ces quinze derniers jours,
Je lui répondais pas très sûr de moi.
- Moi je veux bien mais qu’en est-il de News-Tv ? Ils sont au courant, eux pourront parler et commenter l’affaire.
A cela il me dit d’un ton rassurant :
- Ça c’est notre affaire de faire avec les médias ça ne nous arrange pas qu’ils aient été en contact avec vous mais la gestion des journalistes ça ne repose que sur notre savoir-faire et sachez-le, cet exercice repose sur des années d’expériences.
Après plusieurs heures de stress accumulée et la prise de Bepanote et de Foxapak, il y avait encore deux heures, je sentais que maintenant, j’allais mieux, que mon cortex était au repos et ma lente redescente parmi la race des humains étaient amorcés avec les deux pieds solidement à plat sur la terre. J’avais la sensation que finalement les choses tournaient mieux que je ne l’espérais. Qu’est-ce que représentait mon silence face à une perspective des plus noires, si j’avais contesté. Mais surtout, j’étais sur le point d’accomplir un nouveau démarrage dans ma vie et ainsi quitter ma condition peu enviable, vers un nouvel horizon qui se dégageait et qui me paraissait plus radieux qu’avant et j’y plongeais tout entier, corps et âmes de la même façon que l’on prend la décision d’appuyer sur une détente, ou de se jeter dans le vide mais avec un dénouement moins tragique.
Raubier prit la parole :
- Gauthier, nous voulons vous faire confiance, vous êtes intelligent, vous avez bien compris que la France est un grand pays qui ne peut se permettre d’avoir des services de renseignements peu fiable. Accepter de tenir votre langue quoiqu’il arrive et vous aurez l’assurance d’avoir une vie paisible et normale. Sinon, compter sur nous pour ne vous faire aucun cadeau.
A ces mots, avec une grande aspiration, je me tournais vers lui et bredouilla ces quelques mots :
- Je n’ai pas d’autres alternatives donc j’accepte. J’ai du mal à comprendre pourquoi cet affaire a démarrée, alors je ne souhaite qu’une chose, c’est qu’elle s’arrête.
A cet instant, Nividracq tapa des deux mains sur son bureau et prononça.
- Bien, monsieur Gautier, vous prenez la juste et bonne décision et je sens que nous pouvons nous faire confiance mutuellement. Le temps pour nous de prendre quelques précautions et vous êtes libre.
Vers seize heures une voiture de service conduite par Dallet me raccompagnait à la gare Montparnasse et je pris le prochain train pour Dreudan. Pour le retour à la case de départ.
Chapitre 11) Speaknet
A Dreudan
Mes parents paraissaient bien contents de me retrouver mais je me gardais bien de m’étendre sur ce qu’avais représenté mes occupations pendant ces deux jours dans la capitale. J’appris que la police était venue interroger ma mère et quand l’absence de nouvelle me concernant, elle avait prévenu l’hôpital de ma disparition au sein du foyer. Après un repas sommaire en regardant le vingt heures de la deux qui citait bien évidement l’affaire et son traitement par Speaknet, j’ai échangé quelques mots avec mon beau-père, sur ce sensible dossier. Tout en lui expliquant que cette découverte et ces procédés pouvaient avoir des conséquences insoupçonnées et dramatiques, il me répondit d’un air résigné que pour l’individu qui n’avait rien à se reprocher, ces technologies ne représentaient pas grand-chose. Il renchérit son argumentation en m’affirmant qu’en ce qui le concernait, être observer par des robots, il n’en avait rien à faire. Convaincu qu’il n’avait pas analysé en détails l’étendue de ses réflexions qui me paraissaient bien courte, je mis fin à la conversation à la dernière cuillère de dessert à la vanille que j’avalais. J’étais persuadé qu’à la lecture de Paragraphe, le lendemain, il prendrait la mesure à travers la plume d’un journaliste de son quotidien préféré, d’une vision nouvelle. Avec moi, il ne voulait, ni pouvait faire l’effort de prendre en considération les arguments que je défendais, c’est pourquoi dans une sorte d’objection par principe et de circonstance, il s’obligeait à trouver dans mes constatations qu’une suspecte pensée.
La lecture des articles
Je retournais dans mon studio et en attendant l’émission d’Elisabeth, je me mis à faire le tour des organes de presse sur Internet qui parlait de l’affaire. Les articles étaient succincts et bien que l’on fasse références à Speaknet, j’avais le sentiment que la presse dans son ensemble avait pour ce premier jour de la parution de la nouvelle, été un peu pris de cours et pour être mieux renseigné il fallait mieux attendre le lendemain. Malgré tout, je trouvais, un article écrit dans un anglais global, cette langue de mauvais Shakespeare mondiale que l’on appelle aussi le Globish, un article qui visiblement avait été écrit dans la précipitation de l’événement et dont personne ne prenait à sa juste valeur, la portée sociétale qu’elle représentait.
Il s’agissait d’un article d’un certain Jerry Backman qui faisait la synthèse des documents que Speaknet avait mis en ligne, le matin même. Cet article reprenait point par point des notes de services qu’Edward Stincken avait eu en sa possession et qu’il avait soustrait au regard de la CIA, quand il était encore administrateur système. Ces notes recoupées avec les informations piratées par un certain Sergueï Prikalev devaient servir de base à l’élaboration des articles de Backman.
Je savais désormais qu’un individu en interaction avec une machine était donc vu par Jerry Backman comme un acteur en représentation et qu’il jouait toujours un rôle, lequel pouvait être différent selon la nature des interactions et comme si je jouais mon propre rôle, je me mettais à lire un autre article de Backman.
Vidéo surveillance classique
La technique de la vidéosurveillance classique avait fait apparaître des funestes conclusions. Depuis le début des années deux mille, les études statistiques concernant l’efficacité des politiques de vidéosurveillance classique, on conclut à une inexistence de résultat probant. La Grande- Bretagne avait investi près de 500 millions de livres sterling en dix ans pour développer et réparer le réseau des caméras en fonctions et s’était équipé du plus vaste système de vidéosurveillance d’Europe, mais uniquement trois pour cent des délits, étaient résolus à l’aide de ces caméras. Londres représentait la ville la plus équipée avec 500 000 caméras, néanmoins, ce n’était pas la ville la plus sûr au monde. On s’était aperçu également que la délinquance n’avait pas diminué mais qu’elle s’était surtout concentrée, là, où il n’y avait pas de caméra. Cette incapacité à réduire les délits a poussé les occidentaux vers d’autres pistes de rationalisation de la surveillance. Alors que la technologie était au point, pour passer à une autre dimension, c’est ainsi que la télésurveillance à vue le jour. En deux mille quinze, on en a conclu que ces services étaient plus pratiques, plus rentables et plus efficaces avec à terme le déploiement de l’automatisation des tâches et l’arrivée des nouveaux algorithmes d’intelligence artificielle.
Crédit : Contenu soumis à la licence CC-BY-SA 3.0.
Source remixée : Vidéosurveillance de Wikipédia en français (auteurs)
Le Temps Réel
Mes capacités en anglais étant limitées, aux alentours de vingt et une heures, je me rendais sur le site de « Temps Réel » qui, je le savais, avait eu pour habitude de collaborer avec Speaknet sur les précédentes affaires. Sans avoir besoin de fouiller beaucoup dans les pages du site, je trouvais des informations sur la télésurveillance globale et principalement son historique dans un article assez long et traduit en français.
Le titre était « Scientia est potentia » (« la connaissance donne le pouvoir »)
La télésurveillance globale faisait référence à la mise en place d'une surveillance de masse mondialisée sur des populations entières, par-delà les frontières nationales des États-Unis.
Ses racines historiques remontent au début du XXIe siècle, notamment après l'adoption conjointe par les États-Unis et le Royaume-Uni de l'accord secret « Coat Fog » qui a abouti à la mise en place d'un premier réseau de télésurveillance américain et anglais connu sous le nom de code « Datazone ». L'existence de cette télésurveillance globale, cependant, n'a pas été reconnue lors de la couverture médiatique des révélations d'Edward Stincken, qui ont déclenché un débat politique mondial en deux mille treize sur le droit à la vie privée à l'ère du numérique. Toutefois, pour le grand public, on peut espérer que c'est la série de divulgations détaillées de documents internes à la NSA, en mai deux mille seize, qui révélera pour la première fois l'échelle considérable de l'espionnage de la NSA, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des frontières des États-Unis. La plupart de ces documents furent divulgués par un hacker Russe au sein de la CIA et de la NSA, Sergueï Prikalev.
Aux États-Unis, la NSA collecte les données télé virtuelles de plus de trois cent millions d'Américains.
Les données recueillies par ces programmes de télésurveillance sont régulièrement partagées avec le FBI et la CIA. De plus, la NSA fournit des interceptions faites sur le territoire américain à la Drug Enforcement Administration (DEA, agence de lutte contre la drogue), à l'Internal Revenue Service (IRS, un service du fisc), ainsi qu'à d'autres agences chargées de faire respecter la loi.
La géolocalisation d'un individu mobile ou statique désigne l'action d'obtenir sa position, ses coordonnées et ses agissements. En agissant de la sorte, la NSA collecte chaque jour plus de 7 milliards de données de géolocalisation d’individus. Cela permet aux analystes de la NSA de cartographier les réseaux de relations, en corrélant les modèles de leurs déplacements au cours du temps avec les dizaines, les centaines, les milliers de personnes ayant croisé leur chemin.
Entre deux mille huit et deux mille douze, le DATAZONE a intercepté de manière massive les images des sonars /caméras utilisés à raison d'une toutes les deux minutes pour chaque géolocalisation vidéo. À partir de ce réservoir de données et d'images collectées sans distinction, l'agence britannique a pu expérimenter diverses technologies de reconnaissance faciale. Elle a cependant échoué au départ à en filtrer les images pour les conversations (trois à onze pour cent du total) par des outils de détection automatique. Des cibles importantes comprennent des membres et adhérents du groupe connu sur Internet sous le nom des anonymes, ainsi que des lanceurs d'alerte potentiels. Selon Edward Stincken, la NSA a aussi ciblé des journalistes qui rédigeaient des articles critiques envers le gouvernement américain après les attentats du 11 septembre 2001 Dans le cadre d'une opération conjointe avec la CIA, la NSA déploya des postes de géolocalisation secrets dans 80 ambassades et consulats américains à travers le monde. Le quartier général de l'OTAN fut aussi utilisé par des experts de la NSA pour espionner l'Union européenne.
La Direction générale de la Sécurité extérieure (DGSE) entretient des relations étroites avec la NSA et le DATAZONE, à la suite de discussions portant sur une coopération renforcée débutées en novembre 2006. Au début des années deux mille dix, l'étendue de la coopération dans l'interception conjointe des données numériques par la DGSE et la NSA a augmenté de façon spectaculaire.
En deux mille onze, la DGSE et la NSA signèrent un mémorandum formel pour l'échange de données, qui facilita le transfert de millions de métadonnées de la DGSE à la NSA. De décembre deux mille douze au huit janvier deux mille treize plus de soixante-dix millions de métadonnées ont été remis à la NSA par des agences françaises de renseignement.
Crédit : Contenu soumis à la licence CC-BY-SA 3.0.
Source remixée : Surveillance globale de Wikipédia en français (auteurs)
La dernière émission
Une fois ma lecture terminée il était pile vingt-trois heures pour l’émission d’Elisabeth, elle portait un tailleur orange qui allait bien avec ses cheveux mi- longs auburn tombant sur ses épaules. L’émission était évidemment, consacrée à la télésurveillance et il y avait présent : l’ambassadeur des Etats-Unis en France, Jeffrey Untall, Phillipe de Mirmont secrétaire d’état au ministère de la défense, le représentant de Speaknet pour l’Europe francophone, Bruno van Deniels, et Eddy Jaffrat du journal Résistance. Ce qui me surprit tout d’abord, ce fut la grande décontraction qui régnait sur le plateau. L’américain et le secrétaire d’état n’étaient pas souriant mais pas non plus le visage crispé ou les trais tirés, comme s’ils avaient été maintenus sous pression toute la journée. J’en conclu et j’eu la confirmation avec les réponses aux questions que posait la journaliste, que le caractère important de cette fuite d’information au détriment des américains ne devait pas être forcément le fruit d’une quelconque négligence, mais le souci de voir la société civile être absorber par un secret qui devenait trop envahissant pour les grandes nations. Comme la vérité devait être digérée autant que l’on en planifie les circonstances et il s’avérait peut-être que la messe était dite et qu’avec le dossier confidentiel divulgué c’était une partie des souhaits, des nations occidentales, qui venaient d’être exaucés.
Jeffrey Untall parlait un excellent français mais avec un accent épouvantable, il ne faisait plus d’effort même invité sur un plateau de télévision. De Mirmont et lui furent très clair et on sentait bien que la ligne qui s’imposait à eux deux, était de ne pas en rajouté mais de ne pas, non plus, minimiser les faits, ni remettre ne en cause la véracité des documents qui avaient été trouvé.
La tension d’Eddy Jaffrat était à son maximum et il fulminait, car non seulement la nouvelle, lui avait été volée par Speaknet et le quotidien Temps Réel à vingt quatre heures près, mais sur le site du quotidien du soir, on trouvait déjà des informations qui n’avaient pas été encore révélé par mes sources. Les données de Duchaussout dont j’avais abreuvé News-Tv et Résistance n’étaient pas aussi précises et fournies et bien qu’elles aient un caractère national, donc plus local, elles ne suscitaient pas un engouement aussi important que celles de Speaknet et du hacker Prikalev. Par ailleurs, il avait la sensation que la situation lui échappait que le diplomate et le haut fonctionnaire se moquaient de lui. Bien qu’il essayait de ne rien faire apparaître dans un comportement qui aurait pu éveiller des rumeurs sur une éventuelle supercherie, il avait évoqué avant l’émission avec Bruno van Deniels, le cas de figure qui voulait que la NSA et la DGSE avaient vu les choses arriver et pire, qu’ils les avaient un peu encouragés. Cette conclusion que je réalisais au fur et à mesure du débat, s’appuyait sur les réactions que j’avais examinées avec attention auprès de Raubier et de Nividracq. Se pouvait-il que toute cette mise en scène n’avait été que du vent et que j’avais joué, malgré moi, un rôle d’apprentis hacker et que, bonne fille, la République contente du service que je lui avais rendu, me remerciait en m’oubliant mais avec, tout de même, un emploi à la clef.
Avec une grande maîtrise, Elisabeth tenta d’obtenir des réponses sur les bouleversements qu’allait engendrer ce type d’application et sur les effets que nous en retiendrons dans notre vie quotidienne. Très vite, se dégagea l’idée venant des intervenants officiels des états que c’était la fin de la violence et qu’une nouvelle ère de justice absolue s’offrait au monde. Ils s’évertuaient à voir dans ce progrès un vaste programme qui allait changer nos comportements les plus vils et nous rendre la vie plus simple. Le belge van Deniels émit la notion que les états devait avoir à changer leur constitution et notamment les amendements concernant le nouveau droit à l’image, la représentation était constitutive de la liberté de chacun, par conséquent cet enfermement des gestes par un procédé informatique et géolocalisable en temps réels était une atteinte au citoyen. Il fallait donc débattre à l’assemblée et au sénat. De Mirmont proposa qu’il fallait également changer le contenu du texte qui concernait les droits de l’homme et du citoyen, notamment l’article premier qui devenait pour l’occasion dans sa nouvelle mouture et qu’il lisait avec un air dramatique : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits mais soumit à la bienveillance de chacun. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans une optique, un souci et un esprit de fraternité ».
Ce que Eddy Jaffrat exprimait également avec virulence, c’était qu’il fallait s’attendre à un retour en force des grandes idéologies des années mille neuf cent soixante pour, comme il le disait « résister au système » . Cette réaction à cette violence symbolique devait permettre de s’extirper du système mais en fait et plus simplement, juste essayer de l’oublier. Quand il affirmait ça, le rédacteur en chef de Résistance avait une idée en tête, c’était la première de couverture du quotidien qui avait défrayé la chronique depuis les années soixante-dix. Cette Une, du lendemain l’équipe l’avait particulièrement choisie pour marquer les esprits et le dix neuf mai deux mille seize devait rester dans les mémoires avec en titre : « Fliqué, vous pourrez sourire » avec en arrière et gros plans, la photographie d’un œil dont une partie, en surimpression, était en 3D filaire.
L’émissaire belge de Speaknet évoqua également un document sur lequel se trouvaient des preuves irréfutables de la prochaine étape de la mise en place du DATAZONE, son futur. La question qui faisait débat au sein de l’administration américaine à travers son agence du renseignement reposait sur la question du passé et du présent. Si un délit avait été commis il y a une semaine, à Denver à treize heures quarante, on pouvait facilement consulter les données qui se rapportait à cette période précise, dans un périmètre donné et par là même, on était en mesure d’identifier les personnages présents sur la scène du crime, Dans ce cas de figure, la télésurveillance se posait comme un outil « a posteriori », en revanche, une fois que les système d’intelligence artificielle aurait été en place, comme c’était déjà en version béta dans certains lieux qui étaient encore secret aux USA, on pouvait déterminer les principales étapes du passage à l’acte éventuel et donc, on pouvait ainsi calculer en temps réel qu’un individu était sur le point de commettre un délit. Evidemment, suivant son comportement, comme notamment celui qui tenait dans son poing une arme, déterminait qu’il était plus susceptible de commettre un délit et ce en subissant les fourches caudines du logiciel de la NSA. La police pouvait, ainsi, être présente sur les lieux et intervenir plus vite. Le langage de la police qui servait d’apanage aux témoins d’un homicide comme seule explication avec : « Il ne fallait pas être au mauvais endroit au mauvais moment ». Cette maxime devait être oubliée, reléguée au rang d’une période passée.
Elisabeth intervint pour relancer le débat, en s’adressant à Jeffrey Untall. Sa question portait sur le fait de savoir si d’ores et déjà les USA n’avaient pas mis en place des portiques qui établissaient le profil de chaque personne se rendant aux Etats-Unis. Il répondit avec une totale transparence sur les raisons qui avaient poussé le gouvernement à favoriser la mise en place de ces portiques. Cette transparence peu commune à ce niveau de responsabilité faisait croire à l’inévitable volonté de l’Etat américain à dominer le monde avec ses technologies nouvelles et pour cela, il fallait commencer dans un premier temps à protéger son espace vital. Il rappela au passage que les nombreux cas d’attentats terroriste rendaient le monde instable et les américains dans ce cadre de la surchauffe sécuritaire avaient défini qu’il fallait mieux prévenir que guérir. Ils restaient pour autant, la première puissance mondiale et pour des raisons uniquement commerciales, être capable de négocier avec le reste du monde. Il ajouta, enfin, qu’en matière de sécurité intérieure, ils n’avaient de leçons à recevoir de personnes. C’est pourquoi dès deux mille dix, la télésurveillance était opérationnelle et qu’elle s’appliquait à toutes personnes séjournant aux Etats-Unis comme touristes, homme d’affaire ou simple immigré à l’affût de sa carte verte. Comme on pouvait l’apprendre dans les documents de Speaknet, la couverture du territoire des USA était effectuée par des satellites de la NASA, alors que l’Europe de l’Ouest ne disposait que de radar installé sur les relais qui était en partie réservé à la téléphonie mobile. C’est à cet instant qu’Elisabeth se tourna vers Eddy Jaffrat et van Deniels pour connaître leur avis sur la question européenne qui se posait tout autant, si ce n’est plus encore. Non seulement, le terrorisme avait frappé la France et plus globalement le problème des réfugiés venant d’Afrique interrogeait les esprits, avec des questions à résoudre plus conséquentes encore que le cas américain. Laurent prit la parole et revint un moment sur son idée des grands mouvements pacifistes qui devaient s’emparer du débat et le porter jusqu’à Bruxelles s’il le fallait. Selon lui, on assistait à une ère de responsabilité écologique des civilisations. Le mot d’ordre était donné, il fallait faire attention à l’autre, ramener l’individu au centre de l’arène, comme le souci de toutes les préoccupations. Seuls, les états ne pouvaient pas tout diligenter ni tout diriger et c’est pourquoi, il fallait rendre au public, une partie de lui-même. La connaissance de tous par tous, au même titre que la couleur de vos chaussettes ou que votre pedigree devait affranchir et ne pas restreindre. Alors que des voix s’élevaient d’Orient pour crier au scandale sur une société transparente qui deviendrait à son apogée totalitaire, le rédacteur en chef du quotidien s’emblait dans une sorte de fatalisme enthousiaste, malgré tout, conservé la foi qu’il avait dans le monde occidentale et que la France, terre du siècle des lumières et des droits de l’homme pouvait encore jouer un rôle aussi second soit-il, face à une Amérique hégémonique.
L’émission s’achevait et comme à chaque fois, Elisabeth fit une petite allusion ironique. Cette fois-ci, elle présentait l’image d’une vidéo surveillance classique avec un jeune braqueur d’épicerie peu professionnel qui se faisait dérober son arme factice par la vendeuse, en y ajoutant un commentaire, auquel je m’identifiais immédiatement, comme si cette phrase m’était adressée en particulier. « Une arme en plastique, ce n’est pas ce qu’il y avait de mieux ». Je suis resté 20 bonnes minutes dans mon fauteuil, les pieds sur le bureau devant ma télévision, en me demandant si j’allais enfreindre ce que je m’étais engagé à respecter, le matin même à la DGSI. Devais-je, oui ou non prendre mon téléphone et appeler Elisabeth ? Il y avait 48 heures, elle s’était offerte toute entière, l’espace d’une nuit. Il y avait vingt quatre heures, elle m’avait tenu à distance et malgré, qu’elle représentait la plus désirable de toute et la plus vénéré des femmes dans ma longue vie de célibataire, je souhaitais en rester là.
Chapitre 12) Le retour chez le psychiatre
La Violence symbolique
On pourrait définir une théorie générale de la violence symbolique légitime pour le pouvoir globalisé. Mais avec ce qu’abordent certains docteurs géniaux de la pensée du XXe siècle, c’est que la violence est comme constitutive d’une réalité sociale effrayante. Pour commencer, la violence symbolique reste doublement tyranique, puisqu'elle fixe des portés arbitraires à travers un pouvoir arbitraire. Dans un processus particulier et élitiste, dans lequel cette violence symbolique applique une institutionnalisation d'une capacité méconnue, cette capacité monstrueuse, c'est le pouvoir de la violence symbolique qui était parvenu à donner avec rigueur des sens comme légitimes, tout en masquant les rapports de forces qui le sous-tendent. Avec le consentement implicite des dominés, cette violence symbolique s’appliquait et s’exerçait car les dominées ne disposait, que pour penser cette domination, qu’aux modes de pensée des dominants. La violence symbolique de la télésurveillance se mettait en place par le biais de l'éducation comme à travers une action pédagogique, mais également de toutes les institutions légitimes, comme la télévision, le cinéma, les journaux. Dans une légitimité des institutions qui est variable selon les individus et selon le temps, cette idée de violence symbolique rapporte à l’intériorisation par ses agents à la domination sociale. Elle est effectuée par rapport à la position qu’ils occupent dans un domaine donné et notamment à leur place sociale. Cette violence est en dessous de la conscience et ne repose pas sur une condition dominante d’un individu sur un autre mais sur une condition d’une position en fonction d’une autre. La hiérarchisation des groupes sociaux est le fondement de la légitimité des schémas où se trouve la violence symbolique.
La télévision à qui l’ont fait crédit parvient à imposer ses schémas comme légitimes, la confiance que peut perdre la télévision comme institution vis à vis de ceux qui y sont soumis est un grand danger pour elle. Ce qui explique que pour certains présentateurs la notion de cultiver leur image d’expert est très importante. De la même sorte que les émissions dites « de débat » au cours desquelles les invités sont essentiellement des « consultants de télévision » sont aussi des organisations de justification.
La violence symbolique n'est pas simplement un endoctrinement ; elle établit une fonction d'un maintien de l'ordre, sans que le sujet qui l'exerce s'en aperçoive, consciemment.
Crédit : Contenu soumis à la licence CC-BY-SA 3.0.
Source remixée : Article Violence symbolique de Wikipédia en français (auteurs)
Pire encore, on avait distillé des informations dans la sphère publique sur la surveillance généralisée, peu à peu. Ce devait être un lent processus de prise de conscience que tout à chacun d’abord sur Internet et ensuite dans la vie en temps réel allait être pisté, traqué, d’un statut à un autre, de suspect potentiel en attendant de prouver votre non culpabilité. Il était clair qu’en procédant par étape les Etats Unis et l’Europe avait préparé ses citoyens à une société de la responsabilité, ce n’était pas nouveau mais ça s’inscrivait encore plus et le contre coup des droits de l’expression devait s’accompagner de devoir que la société toute entière devait adopter. D’une société de droit, nous convergions encore plus vers celles des devoirs. Vous pouviez craindre qu’une relation adultérine ne se pose en problème avec la télésurveillance et vous étiez confronté à tous vos actes passé et présent voire même dans le futur si l’intelligence artificielle avait des raisons de le calculer. Le principe de précaution s’était imposé en Europe comme il s’appliquait déjà aux Etats-Unis dans des proportions telles que la stigmatisation au préalable devint une norme. Votre niveau de savoir et de consentement de la règle en vigueur devait vous amener à devenir un citoyen modèle et formaté, ce n’était pas très différends de ce que nous connaissions auparavant mais à l’usage ce que vous disiez, ce que vous faisiez était soumis à la violence symbolique du contrôle social. Plus d’espoir de se libérer du regard de l’autre, avec le big data vous deveniez une statistique avant d’être localisé sur le terminal d’enregistrement. Dès votre plus jeune âge, On pouvait déceler tous les comportements comme la masturbation tout aussi bien que celle définie d’abjecte et d’alarmantes comme la cruauté envers les animaux.
Le contrôle social
Le contrôle social représentait l'ensemble des pratiques sociales, qu’elles soient formelles ou informelles et qui impliquait de produire et de garder dans une position stable la similitude des individus aux modèles de leur groupe social. Selon les différents types de société d’une à l’autre, ses modalités varient. Ses effets sont discutés : comme le ciment de l’unité pour les uns, il représente pour les autres, toutes sortes de techniques de propagation de la communication sur l’opinion poussant à la domination et à l'aliénation.
Dans les modalités du contrôle social qui va vers le contrevenant, ou vers les membres du groupe, le corps social opèrent dans un premier temps avec ses sanctions et ses jugements. Ces sanctions et ces jugements peuvent être positifs, comme les médailles officielles, les compliments, ou des félicitations scolaires, on parle alors de sanction positive mais à l’inverse, ils peuvent être aussi négatifs, comme la peine de prison, le mépris public ou des railleries. On peut également vous rappelez à l’ordre avec la police, les tribunaux ou un service pénitentiaire, ils sont alors formels, quand, ils sont informels, ces jugements peuvent être exprimés par chacun. Selon Durkeim « L’une est appliquée par des corps définis et constitués et l’autre par chacun et par tout le monde ». Pour le rôle du contrôle social informel, le système de croyances est plus important que les lois imposés par l’Etat parce les valeurs sociales sont intériorisées et elles deviennent un aspect de la personnalité de l’individu. Les institutions pénales sont spécialisées dans le contrôle social mais toutes les institutions ont un rôle, comme la famille pour apprendre les normes, la religion pour les transmissions des valeurs et la promotion des normes, l’entreprise, et même l’institution des médias de masse dans une fonction latente de contrôle social qui possède un puissant pouvoir de jugement. Dans une société qui bascule toujours plus dans la fabrication du consentement et notamment dans les démocraties libérales, quand les sociétés changent, le contrôle social à tendance à évoluer. A partir de la Renaissance, le contrôle social s’est étendu comme par exemple avec l’hygiène et les usages du corps. Puis le contrôle est devenu plus formel quand les sociétés se sont différenciées et individualisées avec la centralisation du pouvoir de l’Etat. En partie à cause des regroupements urbains et de l’individualisme, le contrôle informel avait perdu de son efficacité, ils resurgissaient. Pour finir, à l’heure des sociétés industrielles, la privation de liberté est devenue le type normal de la répression pénale dans l’emploi d’une discipline correctrice ce qui annonçait une judiciarisation de la société. Après mille neuf cent quarante-cinq, le contrôle social se posait avec une question difficile avec les nouvelles technologies, car il existait déjà au début des années deux mille, un arsenal de technique mis en place qui renforçait le contrôle étatique avec la télésurveillance des endroits privées et publics. On passait, donc, à un cap supérieur. Car même fort, d’apporter la critique sur les réseaux sociaux, ces nouveaux outils de l’information et de la communication obligeaient par une double contrainte, à un système qui exerçait sur l’individu une telle influence qu’il paralysait tout élan. Toutefois, il y aurait des pours qui prônaient comme mon beau-père que seuls les délinquants pouvaient y voir un fléau et que c’était maintenant une nouvelle ère qui s’accomplissait, enfin. Pour les autres, c’était la fin des libertés individuelles et le début d’un pouvoir dictatorial tout puissant. En précipitant un nouveau contrôle social émergeant et dont les nouvelles technologies sont à l’origine, l’être humain avait tendance à privilégier le confort matériel ce qui amenait à penser que le contrôle social était consubstantiels à la modernité et que par cette réalité le conformisme constituait le nouveau totalitarisme de demain. Conformisme qui s’exerçait tout entier dans la remise en cause du « droit au bonheur » de chaque individualité.
Ce contrôle social tendait à son origine à prévenir la déviance. D’une part, il collaborait à l’assimilation des personnes et à la cohésion du groupe. Dans le cas contraire, il exerçait un relâchement du contrôle social qui pouvait favoriser l'écart aux normes : c'était le cœur de la théorie de la « désorganisation sociale » ce qui avait pour effet d’expliquer la délinquance urbaine, néanmoins rien n’était certain de l’empêcher et le crime était un signe « normal » de la société. Selon Howard Becker et sa théorie de la déviance résultait d'interactions sociales. Or la déviance était analysée ici comme un processus interactif et séquentiel. Mais prenons l’exemple de monsieur z avec un premier acte déviant qui était commis comme une déviance primaire, il avait fait l'objet d'une stigmatisation par les instances institutionnalisées du contrôle social. Cette stigmatisation avait pour résultat de produire deux effets. D'une part, elle amenait l'intéressé à intérioriser l'image de soi que lui renvoyait la société et ainsi à se définir lui-même comme déviant. Par ailleurs, elle limitait ses possibilités de continuer à agir dans le cadre légal. Cette stigmatisation faisait donc entrer monsieur z dans un processus de déviance secondaire qui induisait une nouvelle réaction de la société. On entrait ainsi dans une spirale dans laquelle chaque délit appelait une réaction sociale qui contribue elle-même à favoriser à commettre de nouveaux délits. Ce processus avait pour effet d'amplifier la déviance et d'enfermer un comportement déviant occasionnel dans une véritable culture délinquante. Quand monsieur z est soumis au regard de la machine et qu’il est conscient, il est potentiellement susceptible d’une stigmatisation, le contrôle social fait appel à la responsabilisation de l’individu. De cette façon l’auto contrôle était le plus efficace avec l’intériorisation de la contrainte. Dans le cours journaliers des interactions au quotidien, l'intériorisation du contrôle social est intensifiée par les rôles sociaux et des jeux de distinction dans lesquels les personnes sont entraînés : l'autocontrôle des émotions, la maîtrise de soi, le refoulement des pulsions, sont le résultat d'un contrôle social que l'individu se dicte à lui-même pour tenir son rang dans le groupe, en particulier lorsqu'il prétend à la domination, c’est donc à travers un apprentissage individuel pour son propre compte que la société avait été parcouru car l’individu ne nait pas civilisé,
A son origine, il n’y avait pas de connotation négative car le contrôle social était structurant et apportait une cohésion sociale. Elle reposait sur un facteur d’intégration mais après mille neuf cent quarante-cinq, les contrôles sociaux étaient devenus plus négatifs car les valeurs et les normes reposaient sur des groupes sociaux dominants qui se disait normaux, des « entrepreneurs de morale » selon Howard Becker. Comme un travail de production et de reproduction d’une idéologie dominante, comme disait Bourdieu et Bolanski ou comme une forme dissimulée de propagande pour Noam Chomsky. D’où une stigmatisation d’une population qui tombait du mauvais côté de la norme parce qu’elle ne voulait ou ne pouvait s’y normaliser. En résumé, en même temps qu’il intégrait, le contrôle social stigmatisait et opprimait au nom de la cohésion sociale, il produisait de la domination orienté par les groupes dominants et spécifiquement exigeants vers les groupes dominés et dans lequel ce système favorisait les hiérarchies sociales qui étaient alors produites et légitimes.
Crédit: Contenu soumis à la licence CC-BY-SA 3.0.
Source remixée : Article Contrôle social de Wikipédia en français (auteurs)
Divagation
J’avais ressenti dans mon être, depuis ces fameux quinze jours, une cruelle frustration qui m’avait envahie au fil du temps depuis le début de la maladie, dans le plus confiné des recoins de mon cerveau. Une ligne de front insurmontable avait pris le dessus contre une vie qui n’était plus rayonnante, comme mes années d’excès parisien. Durant plusieurs années, la maladie, cette hydre qui me retenait dans ses griffes et qui m’avait kidnappé me rendait taciturne et peu apte à la plaisanterie. J’avais été happé par le tourment et la routine dans une vie qui se bornait à écrire du code informatique et fréquenter l’enceinte de l’hôpital en n’ayant pas l’ombre d’un projet fut-il de vie ou comme perspective professionnelle durable.
Aliénation
Pour autant, le terme d'aliénation était considéré comme un concept trop englobant et il était envisagé comme couramment utilisé à propos des sujets divers, et par exemple pour dénoncer l'aliénation ou le caractère aliénant du système capitaliste. Il était cité pour critiquer certains phénomènes de société ou sinon venant des institutions sociales comme la religion, le travail, l’argent, la publicité ou bien la consommation. Il désignait également, un état de privation de ses facultés personnels ou une suppression de ses droits, à travers une dépossession de ses capacités ou par une obligation fixée empêchant la large étendue de son potentiel, ou encore à signaler qu'un individu n'était plus lui-même, devenait étranger à lui-même, ou ne pensait pas par lui-même et devenait tenu de s’affilier dans un groupe sans en avoir conscience.
Crédit: Contenu soumis à la licence CC-BY-SA 3.0.
Source remixée : Article Aliénation de Wikipédia en français (auteurs)
En étant malade, j’avais perdu le sens de la liberté de mon destin et cette descente aux enfers, ne pouvait-on pas la comparer à une forme de délinquance. La société était malade de ses crimes et comme un médicament aux vertus extraordinaires, la télésurveillance allait tout guérir, on avait déjà établit un diagnostic à travers la vidéosurveillance classique et donc fait ses recommandations, les tests en laboratoire avait été effectués, les chercheurs avaient mis au point le procédé, les patients était prêt à supporter le traitement, on les avaient préparés à la surveillance généralisée et aux supercalculateurs et dorénavant, on leur imposait de prendre le traitement. J’avais la sensation d’avoir déjà vécu cette scène mais à une autre échelle. J’imaginais que comme le malade que j’étais et avec ce que l’hôpital m’imposait comme acte de coercition, je me disais que l’espace d’un instant, j’avais été dépossédé de mon destin et que du statut de génial informaticien, j’en étais réduit à celui de piteux malade. Tout le débat sur lequel reposait la télésurveillance pouvait se confondre avec ça. Est-ce que l’homme allait continuer à rester cet être génial et exceller dans des disciplines qu’il s’inventait ou qu’il perpétuait, ou sinon, allait-il devenir un individu soumit à des machines qui seront contrôlés par des systèmes mis en place par d’autres humains plus dominants encore. L’humanité pouvait-elle être dépossédée de ce destin de liberté à travers les nouvelles technologies ?
De retour chez le psychiatre
La semaine d’après, j’avais rendez-vous à onze heures trente, avec le docteur Ziberski, il connaissait à peu près mes pérégrinations effectuées dix jours auparavant car je me doutais que les différents services de l’Etat avaient bien communiqué. Ah ! Psychiatre, c’est un métier et cette fois-ci ce qu’il me disait me faisait du bien. Car, j’ai voulu maintenir la scène avec ma voix parce que ce n’était pas révolutionnaire l’hôpital psychiatrique. Je lui racontais mon histoire, en n’écartant aucun détail, une fois mon récit terminé, il reprit la parole.
- L’héroïne de votre histoire est juste moins nymphomane que dans les séquences que l’on trouve sur Internet. Mais c’est de la folie à l’état pur avec ce qui rendait votre vie foutraque et savoir que ça allait forcément se dérouler comme ça, était une erreur. Mais je n’ai pas envie de régenter votre vie et il y a des choses qui mûrissent alors que derrière ce que vous racontez, il y a une idée.
Je l’interrompis et dis :
- Alors ce que j’aimerai que vous me disiez ce sont des choses simples car j’ai le désir de m’en sortir et de m’élever, ce qui n’était pas envisageable, il n’y a encore pas si longtemps, là, où il y a une logique avec ce que m’a dit Raubier.
Puis il me dit :
- Moi je pense que la solution que je vous propose, c’est ce nouveau contrat avec une part non négligeable d’analyse humaine.
Et je répondais :
- Je serais dans votre fauteuil quand vous le voudrez car je n’aime pas l’incohérence.
Après une profonde inspiration, il dit :
- Chez vous ce que j’aime beaucoup c’est que vous vous battez encore sur le sujet et je trouve que ça évolue dans le bon sens. Est-ce que vous ne trichez jamais car la sincérité est une chose qui est passagère mais la vérité est plus consistante
Et je rétorquais :
- Sans obligation, car j’avais envie de vivre autre chose, je tournais en rond dans cet univers ou je m’encroûtais à l’hôpital et dans ma vie. Il y avait tant de raison pour ne plus y croire. L’avenir avait l’air sombre mais ce n’est pas par la moralité que l’on s’en sort, c’est par la conscience et ce sont des vérités qui se révèlent.
Un quart d’heure plus tard, je sortais de son bureau le sourire aux lèvres, il venait de m’affirmer qu’il allait lever l’hospitalisation d’office, cette mesure de restreinte pour les patients difficiles. Selon les évènements qui avaient jalonné ce mois de mai, il avait jugé, qu’elle n’était plus nécessaire et j’avais abondé dans son sens, trop content d’être pris au sérieux à l’heure actuelle. La décision avait été aussi prise que j’avais la possibilité désormais de ne venir à l’hôpital que pour mon injection mensuel, du fait que j’allais participer à une formation et qu’il me fallait me réinsérer dans le tissus sociale de la vie en entreprise. L’emploi qui mettait réservé, était dans un environnement dit protégé, ce qui m’évitait les situations de tension cérébrale et les risques d’abandon de poste. D’ailleurs, un malade quand il se bat est un exemple de vie, mais le malade, il est malade, ça lui suffit déjà et s’il sait qu’il est seul, c’est catastrophique.
La fin de la violence
Dans un premier temps, le vibreur de mon téléphone situé dans ma poche m’indiquait que l’on cherchait à me joindre, puis ce fut la sonnerie si plaisante à l’oreille de mon Dphone qui retentit. Un numéro qui m’était inconnu apparu sur l’écran. En procédant au traditionnel « allo » quelque peu interrogateur sur ce correspondant dont j’ignorais tout, je perçu dans l’appareil une voix féminine qui goguenarde m’appela dès ses premières paroles, « mon petit choléra » la reconnaissant, je ne pouvais que lui répondre « ma chère peste ». Peste et Choléra, un couple improbable qui en leur temps avait ému beaucoup de monde. Ce terme de petit choléra qui devait tout d’abord me surprendre et me combler dans une euphorie que j’avais du mal à contenir tellement la surprise et la joie réunies étaient de taille. Toujours sur le ton de la plaisanterie, nous avons abordé nos situations respectives à la troisième personne du singulier au féminin la concernant et au masculin pour moi. C’était l’histoire d’elle et de lui qui comme s’ils s’étaient connu la veille, refaisaient le monde et l’histoire de leur vie dans ses moindres précisions. Je suis resté là, sur le parking de l’hôpital, le téléphone sur l’oreille, ayant peur de perdre la communication, ne serait-ce qu’une seule syllabe. Avec une gaîté incommensurable dans l’expression, l’œil humide, tellement j’étais heureux par cet appel qui venait dont on ne sait où. Nous primes rendez-vous à Paris pour le lendemain et je lui lançais les derniers mots, je t’embrasse Jane.
La pyramide
Il était 12 heures 30, lorsque Jane et moi nous, nous sommes retrouvés. Nous avions rendez-vous à l’entrée de la pyramide du Louvre et nous n’étions pas en retard, ni l’un, ni l’autre, ce qui était plutôt rassurant pour tout le monde. Quoiqu’il en soit, à cet instant nous ne connaissions pas nos intimes motivations à l’un comme à l’autre. Elle était habillée d’un fuseau noir et d’une pèlerine bleue ciel et un petit sac à main en polyuréthane jaune bouton d’or. Bien des sujets nous interrogeaient et nous avons discutés de longues minutes en marchant. Alors que nous dirigions vers les quais de Seine, elle était placée à ma gauche et nous allions traverser.