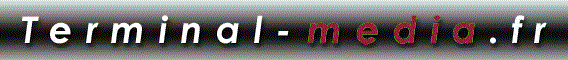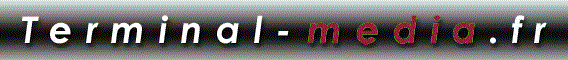L’Inquisition (du latin inquisitio, « enquête », « recherche ») est une juridiction spécialisée (autrement dit un tribunal) créée au XIIe siècle par l'Église catholique et relevant du droit canonique. Afin de combattre ce qu'elle qualifiait d'hérésie, elle faisait appliquer des peines variant de simples peines spirituelles (prières, pénitences) à des amendes lorsque l'hérésie n'était pas établie, et de la confiscation de tous les biens à la peine de mort pour les apostats relaps. L'Inquisition se prononçait sur la peine qu'elle jugeait souhaitable mais se déchargeait de son exécution sur le bras séculier. En principe, l'Inquisition ne pouvait condamner que des catholiques non respectueux des dogmes. Anne Brenon, spécialiste du catharisme, estime à 3 000 le nombre de peines de mort prononcées par ces juridictions ecclésiastiques durant cinq siècles à travers l'Europe.
L'Inquisition médiévale est une juridiction religieuse créée au début du XIIIe siècle en France pour lutter contre les rébellions cathare et vaudoise qui avaient pris une dimension politique dans le Midi toulousain. En raison de ses excès, elle a été supprimée par le roi saint Louis, qui l'a remplacée par la juridiction de l'Official : celui-ci ne pouvait plus prononcer de peine sans décision d'une juridiction civile. L'histoire de l'Inquisition en France a été déformée depuis le XIXe siècle par des archives fabriquées par un faussaire, Étienne de La Mothe-Langon, publiées en 1829 dans son Histoire de l'Inquisition en France et reprises par tous les historiens, notamment Jules Michelet. Les procès faits aux Templiers et à Jeanne d'Arc ont été l'œuvre de juridictions exceptionnelles, créées pour l'occasion et supprimées ensuite.
À la fin du Moyen Âge, la portée de l'Inquisition s'est étendue, en Espagne et au Portugal ainsi qu'à leurs colonies, en particulier sous l'influence des Franciscains et de Dominicains, pour traquer les Juifs marranes et les musulmans morisques convertis de force au catholicisme mais encore attachés à leur foi première. À la fin du XVe siècle, en particulier, l'Inquisition espagnole condamna environ 2 000 hérétiques au bûcher, organisant des autodafés de grande ampleur qui ont instauré une terreur durable ; ensuite, la proportion des peines les plus lourdes diminua rapidement au cours du XVIe siècle après l'expulsion des Juifs et des Musulmans.
Alors qu'elle était sur le déclin, les opposants à l'Inquisition ont insisté sur sa violence. L'opéra Don Carlos et le passage du Grand Inquisiteur dans Les Frères Karamazov ont contribué à asseoir la légende noire de l'Inquisition.
À l'exception des États pontificaux, l'institution a été abolie en Europe au XIXe siècle. Le pape Pie X l'a remplacée en 1908 par la Sacrée congrégation du Saint-Office. Le pape Paul VI a remplacé en 1965 le Saint-Office par la Congrégation pour la doctrine de la foi, qui a fait prévaloir sur l'aspect punitif de la condamnation l'aspect positif de la correction de l'erreur, et de la préservation de la foi.
Racines de l'Inquisition
Saint Dominique présidant un auto da fé, par Pedro Berruguete, 1475, musée du Prado. Image anachronique car Dominique de Guzman est mort deux siècles avant la création de l'Inquisition espagnole, et les exécutions avaient rarement lieu pendant les cérémonies d'auto da fé.
L'Inquisition est due à la conjonction de plusieurs idées : la notion d'hérésie (ou erreur religieuse), d'une part, et la notion de devoir religieux de l’État, d'autre part. Cette conjonction est déjà visible dans l'édit de Thessalonique en 380.
Avant la publication d'Excommunicamus, l’acte fondateur de l'Inquisition médiévale confiée principalement aux Dominicains par le pape Grégoire IX en 1231, la lutte contre l’hérésie s'est développée en plusieurs étapes. On peut en particulier citer l’ébauche d'une législation contre l'hérésie dès le deuxième concile du Latran présidé par Innocent II en 1139, puis, à la suite de la promulgation de la bulle Ad abolendam par Lucius III en 1184, la création d'une « Inquisition épiscopale », menée de manière décentralisée par les évêques, suivie par une « Inquisition légatine », confiée aux Cisterciens par Innocent III en 1198, et enfin le choix de la procédure inquisitoire lors du quatrième concile du Latran en 1215. Le concile de Toulouse (1229) organise la première mise en place de l'Inquisition en Languedoc dans la répression des hérétiques cathares à la suite de la croisade des Albigeois.
Innocent III et Grégoire IX, tous deux à l'origine de l'Inquisition, étaient férus de droit romain, de sorte que ces tribunaux ecclésiastiques se caractérisent par leur dureté : le code de Justinien ordonnait en effet de mettre à mort l'hérétique.
Évolution de la notion d'hérésie
Si l'Église avait connu une période de calme relatif après le IXe siècle, les courants jugés hérétiques se multiplient aux XIe et XIIe siècles, souvent en suivant les routes de pèlerinage : les voyageurs discutent entre eux et avec les villageois lors des étapes, alimentant des questions et des réponses hors du pouvoir régulateur de la paroisse.
Au haut Moyen Âge, l'hérétique est considéré comme un lépreux qu'il faut éloigner du corps sain des fidèles par l'excommunication, puis par l'exil ou la confiscation des biens. Au bas Moyen Âge, l'hérésie constitue une rupture du lien social. Régine Pernoud écrit :
« Tout accident spirituel semble dans ce contexte plus grave qu'un accident physique. (…) Sous bien des rapports, l'Inquisition fut la réaction de défense d'une société pour laquelle, à tort ou à raison, la préservation de la foi semblait aussi importante que de nos jours celle de la santé physique. »
Dans la bulle pontificale Vergentis in senium (25 mars 1199), Innocent III assimile même l’« aberration dans la foi » à un crime de lèse-majesté, concept romain redécouvert à cette époque par les autorités laïques.
Après la création de l'Inquisition, la définition de l'hérésie (pour laquelle elle devient progressivement le seul tribunal compétent) s'élargit constamment, au point d'inclure des éléments de plus en plus divers : l'apostasie de Juifs et Musulmans convertis, ou encore la sorcellerie, laquelle leur est assignée formellement en 1326 par Jean XXII dans la bulle Super illius specula. On appelle aussi hérétiques les schismatiques à l'occasion de la lutte contre Frédéric II ou, au XIVe siècle, du grand schisme d'Occident — ou encore ceux qui refusent de payer les dîmes, voire les homosexuels (alors appelés bougres ou sodomites). La frontière se brouille aussi entre indiscipline et hérésie : Jean XXII appelle l'Inquisition à lutter contre les dissidents de l'ordre Franciscain, puis contre les béguins.
Les prérogatives grandissantes de l'Inquisition explique sa toute-puissance au XIIIe siècle : les inquisiteurs prennent l'habitude de travailler seuls, sans rendre de comptes, ce qui accroît leur autonomie vis-à-vis de l'Église.
Contestation de l'ordre social
L'hérésie n'est pas seulement affaire de doctrine : elle est vue comme un crime global contre Dieu, les princes, la société — ce qui alors revient au même. Étant une rupture du lien social, la lutte contre l'hérésie est une question d'ordre public. Les princes sont donc intéressés par sa répression à plusieurs titres, et l'autorité civile, pour préserver l'ordre public, se met à lutter contre des hérésies et sanctionner des hérétiques de manière potentiellement autonome : la décrétale Ad abolendam (1184) de Lucius III fait de la répression de l'hérésie un élément constitutif du pouvoir de l'Empereur, en l'espèce Frédéric Barberousse.
Cette confusion entre domaines spirituel et temporel est assez générale, en Europe, au XIIIe siècle. En revanche, dans le Midi de la France et tout au nord du royaume d'Aragon, la liberté de culte est très répandue (par exemple : des Juifs sont élus consuls à Toulouse, cité dans L'Histoire générale du Languedoc par Dom Vaissete). L'établissement du premier tribunal de l'Inquisition à Carcassonne, après les « croisades albigeoises », est donc, sans doute, une façon de s'assurer la coopération des nouveaux seigneurs locaux après s'être débarrassé des anciens.
Cette implication des autorités laïques entre en conflit avec l'autorité de l'Église : des tribunaux royaux ou impériaux se prononcent sur des problèmes de doctrine. Ce conflit de juridiction est tranché par l’arrangement de Vérone (1184) : « les hérétiques doivent être jugés par l'Église avant d'être remis au bras séculier ». Inversement, l'Église oblige les autorités « laïques » (dont la légitimité se fonde sur un modèle de société chrétienne) à rechercher les hérétiques, sous peine d'excommunication ou de déposition.
Dès le début, l'Inquisition est donc fondée sur le principe de la collaboration et du partage des tâches entre l'Église et les autorités laïques, chacun intervenant dans son domaine et suivant sa responsabilité propre.
Lutte contre l'hérésie avant l'Inquisition
La lutte contre les hérésies n'est pas née avec l'Inquisition. Avant l'institution de cette dernière, la recherche des hérétiques est confiée à l’ordinaire (le plus souvent, l'évêque) et la punition au juge séculier.
La lutte anti-hérésies n'est pas du seul domaine de la papauté : au contraire, en raison de ses dimensions sociales, les États s'en chargent eux-mêmes. Ils collaborent avec la papauté. Les premières formes de répression étaient apparues au début du XIe siècle : à Noël 1022 (hérésie d'Orléans), Robert le Pieux avait fait brûler dix clercs de la cathédrale d'Orléans. C'était le premier bûcher de l'histoire de la lutte contre l'hérésie en Occident. Faisant suite à l'accord de Vérone entre Lucius III et Frédéric Barberousse, la décrétale Ad abolendam (1184) fait ainsi de la répression de l'hérésie un élément constitutif du pouvoir de l'Empereur.
Ces dispositions bientôt ne suffisent plus : le pouvoir des évêques reste limité à leur territoire alors que l'aire d'influence des hérésies est mouvante, et couvre souvent plusieurs diocèses. Dans ce cas, l'évêque ne peut réprimer que la partie qui est dans sa juridiction, ce qui est peu efficace. En outre, les évêques sont confrontés aux pressions locales : l'hérésie se développe également dans la noblesse ou chez les bourgeois des villes, et un évêque peut avoir un proche parent hérétique.
La doctrine cathare étant bien plus répandue et grandissante que les petites hérésies habituelles, le système des évêchés ne suffit plus. Certains prêtres catholiques changent même de camp pour rejoindre les « bons hommes ». Le pape envoie alors deux légats, en 1198, « répandre la Parole de Dieu », et leur donne tous les pouvoirs et une méthode de jugement. Quarante ans avant l'heure, ces deux légats sont les premiers inquisiteurs de l'Histoire, avec les mêmes droits et méthodes.
L'Église et les États recherchent donc de nouveaux moyens plus efficaces de lutte. D'abord, le IVe concile du Latran en 1215 évoque la possibilité d'un personnel spécialisé, mais restant dans le cadre diocésain. Divers dispositifs sont ensuite essayés, suivant les nécessités locales, dans un effort pour dépasser les limitations de la juridiction ordinaire. Ainsi, dans une ville lombarde, l'évêque collabore à la fois avec le prince local et un légat pontifical pour faire appliquer des constitutions impériales, diffusées par la papauté. En France, le catharisme est combattu par la croisade des albigeois et les évêques appuyés par des légats. Dominique de Guzman meurt en 1221. En 1227, des dominicains appuyés par un commissaire pontifical, Conrad de Marbourg, parcourent la Rhénanie pour soutenir les commissions épiscopales : ils se chargent de dénoncer l'hérésie au cours de la procédure.
Évolution de la procédure judiciaire
À l'origine, le terme « inquisition » (du latin inquisitio, « enquête ») désigne une technique judiciaire. Elle est rendue possible par le renouveau juridique du XIIe siècle, qui réintroduit dans les législations des techniques de droit romain — même si la procédure elle-même est inconnue du droit romain.
Avant le XIIIe siècle, le droit canonique n'admet en effet que la procédure accusatoire : le juge instruit les plaintes ; la charge de la preuve lui revient. Apparaît ensuite la procédure dénonciatoire, fondée sur une simple dénonciation et non plus une plainte en bonne et due forme.
La procédure inquisitoire confère au juge l'initiative de la poursuite. Dans cette nouvelle forme de procédure, le juge peut lancer d'office une procédure sur la base de la fama publica (la « notoriété »). Soit il trouve des accusateurs précis par le biais d'une enquête, générale ou individuelle, soit il se charge lui-même d'administrer la preuve. L'ensemble de la procédure fait une large place à l'acte écrit, au témoignage et à l'aveu.
La procédure inquisitoire est utilisée d'abord à des fins de discipline ecclésiastique : répression de la simonie, contestations d'élections abbatiales, etc. Cependant, elle se déploie très vite dans le champ de la lutte contre les hérésies. La législation en la matière est ébauchée avec les décrets du IIe concile du Latran (1139). Le concile de Tours de 1163, présidé par Alexandre II, autorise les princes toulousains et gascons, dans le cadre de la lutte contre les hérétiques, à recourir à la procédure inquisitoire. Elle est codifiée par une série de décrétales d'Innocent III (1198-1216), en particulier Licet Heli (1213), complétée par Per tuas litteras.
La lutte contre les hérétiques puise dans de nombreuses traditions pour se définir : parallèlement à la résurgence du droit romain, les traditions germaniques sont également utilisées. Ainsi, se fondant sur les punitions très dures de la loi carolingienne contre le sacrilège, Frédéric II choisit en 1234, dans le statut accordé à la ville de Catane, d'appliquer la peine du feu aux hérétiques de Lombardie. C'est la première décision systématique de ce genre.
S'agissant des peines, la papauté se borne à un travail de synthèse des législations civiles, c'est ce qu'on appelle souvent les « statuts du Saint-Siège » : Honorius III étend la décision de Frédéric II à toute l'Italie et en 1231, Grégoire IX la transforme en norme canonique.
Au début du XIIIe siècle, les évêques disposent donc d'une importante législation pour lutter contre l'hérésie, mais pas d'une institution spécialisée.
Fonctionnement institutionnel
Le fonctionnement de l'Inquisition relève à la fois du domaine du droit et de celui de la religion.
Pour le fonctionnement du droit canonique, les procès et jugements dans l'Église relèvent d'un tribunal ecclésiastique, administré sous l'autorité de l'ordinaire du lieu, le plus souvent l'évêque. Rome n'intervient qu'en deuxième ligne, à la fois comme autorité d'appel, et comme garant du bon fonctionnement de l'ensemble.
Quand cette organisation locale se révèle insuffisante ou inadaptée pour défendre les besoins de la foi, le pape peut décider de créer une fonction d’inquisiteur. C'est un représentant à qui le pape délègue son autorité, pour juger toutes les questions relatives à la foi dans une région donnée. C'est une juridiction « d'exception », ce qui signifie que lorsque cette juridiction existe, elle est seule compétente pour juger de l'orthodoxie d'une cause qui lui est soumise. L'inquisiteur est donc essentiellement le représentant du pape, et hérite de son autorité.
Ils étaient choisis généralement parmi les franciscains ou les dominicains. Les inquisiteurs réguliers vivaient en marge de la vie conventuelle, et pour accomplir leur mission ils étaient relevés de leurs vœux d'obéissance envers leurs supérieurs.
L'organisation que met en place l'inquisiteur pour réaliser sa mission de jugement — donc un tribunal — est l'Inquisition, au sens administratif du terme. Le tribunal inquisitoire possède le plus souvent un siège fixe, où sont conservées les archives, mais plusieurs inquisiteurs sont itinérants. Tous sont assistés d'un personnel nombreux : clercs, notaires, greffiers, geôliers, etc.
Au début, les inquisiteurs travaillent par deux, avec des compétences égales. Dans les tribunaux de district espagnols, ces deux inquisiteurs travaillent systématiquement avec un procureur, deux greffiers, un trésorier, un préposé aux litiges financiers, des qualificateurs (experts en théologie) et du personnel subalterne. Par la suite, la charge d'une région fut confiée à un inquisiteur unique.
Procédure inquisitoire
Une juridiction d'Inquisition tire son nom de sa capacité à avoir recours à la procédure inquisitoire, procédure extraordinaire (et inconnue du droit romain). Un tribunal classique ne peut pas évoquer spontanément une cause, il doit préalablement être saisi par un demandeur (qui, en matière pénale, peut être une institution publique établie à cet effet). Au contraire, un tribunal d'Inquisition peut examiner d'office (au sens littéral : du fait de sa mission, son office) toute question dans son domaine de compétence, sans avoir besoin d'être saisi. Ce pouvoir a été attribué pour permettre d'examiner vite et efficacement tout ce qui pouvait être soupçonné d'hérésie.
Le pouvoir inquisitoire est un pouvoir exorbitant du droit commun, susceptible d'être employé abusivement et — de ce fait — habituellement refusé aux juridictions classiques. Il faut comprendre à quel point ce pouvoir est extraordinaire : Napoléon Ier ou Honoré de Balzac disaient du juge d'instruction qu'il était « l'homme le plus puissant de France », par sa liberté d'action, mais il ne pouvait intervenir que sur commission. L'inquisiteur cumulait les pouvoirs d'un juge d'instruction, d'un procureur, et avait la faculté de se saisir d'une affaire.
Procédure pénale
Parler de la « procédure pénale de l'Inquisition » introduit une catégorie peu légitime : la procédure pénale employée par les juridictions d'Inquisition était essentiellement celle de l'époque, avec peu de spécificité réelle. Les procédures qui apparaissent aujourd'hui scandaleuses étaient globalement normales pour l'époque : en regard de ce que connaît le droit moderne, les garanties de procédure et les dispositions qui assurent aujourd'hui la protection de l'inculpé étaient alors extrêmement rudimentaires, quelle que soit la juridiction. Cependant, on peut souligner que les juridictions d'Inquisition ont globalement été progressistes, par rapport à ce qui se pratiquait à l'époque dans les procédures équivalentes de l'autorité civile.
Cette procédure est issue de la redécouverte du droit romain. La procédure était codifiée par des documents généraux (voir les décrétales citées dans les sources latines), et par des instructions d'application promulguées par les inquisiteurs pour les procédures de leur ressort. La procédure était entièrement écrite, un notaire transcrivait tous les débats. L'ensemble de la procédure se déroulait sous le contrôle de l'évêque du lieu, qui recevait copie de tous les documents. Les actes de la procédure étaient normalement rédigés en latin, langue officielle de l'Église, mais les interrogatoires étaient naturellement faits en langue vernaculaire.
L'accusé pouvait récuser un juge, ou faire appel à Rome. En cas d'appel à Rome, l'ensemble des documents était envoyé sous scellés, et la cause était examinée et jugée à Rome sur les pièces recueillies.
La procédure de l'Inquisition a varié dans le temps, et selon les régions, mais ses grandes lignes sont données ci-après.
Procédure type de l'Inquisition
Selon Valérie Toureille, « la procédure utilisée par l'Inquisition reposait sur trois principes nouveaux : l'ignorance par l'accusé du nom des témoins à charge, la suppression de certaines incapacités à témoigner et l'emploi de la question ». Pour Raphaël Carrasco et Anita Gonzalez, « le Saint-Office outrepasse ses droits en permanence ».
Décret de grâce
L'enquête générale était proclamée dans une région entière. Quand l'Inquisition procédait par secteur géographique, l'ouverture d'une enquête de l'Inquisition dans un secteur hérétique donné prenait en général la forme d'une prédication générale, où l'inquisiteur exposait la doctrine de l'Église et réfutait les thèses de l'hérésie. Il publiait ensuite un décret de grâce et un édit de foi, convoquant tous les habitants devant l'inquisiteur.
Pendant une durée fixée par le décret de grâce (typiquement de 15 à 30 jours), ceux qui se présentaient en temps et en heure et confessaient spontanément leurs fautes se voyaient imposer une pénitence religieuse (typiquement un pèlerinage), mais échappaient aux sanctions du pouvoir civil. Inversement, l'édit de foi donnait obligation de dénoncer les pratiques hérétiques.
Ces premiers aveux spontanés, qui devaient être complets, permettaient aussi par leur témoignage (dénonciation) d'identifier des hérétiques qui ne s'étaient pas présentés. Le délai accordé par le décret de grâce permettait aussi de mener des enquêtes locales et, le cas échéant, de récolter des délations.
Les fidèles suspectés d'hérésie qui ne s'étaient pas présentés pendant le délai de grâce faisaient l'objet d'une citation individuelle.
Citation individuelle
La citation individuelle se faisait le plus souvent par le biais du curé. Ceux qui refusaient de comparaître se trouvaient excommuniés.
Un suspect devait jurer (sur les quatre évangiles) de révéler tout ce qu'il savait sur l'hérésie. Si le suspect reconnaissait ses erreurs tout de suite et librement, il se voyait infliger des pénitences comme précédemment, et les peines éventuelles étaient légères.
Le serment était une arme redoutable entre les mains de l'inquisiteur. De nombreuses sectes proscrivaient le serment, et la violation ou le refus du serment était donc un indice sérieux d'hérésie. D'autre part, la sanction contre les parjures était la prison à vie, très dissuasive.
Les peines sérieuses ne concernaient que ceux qui refusaient de reconnaître leur erreur, même après avoir juré de dire la vérité, et malgré des témoignages permettant de douter sérieusement de leur sincérité. Pour ceux-là, la procédure inquisitoire s'engageait réellement.
Le décès de l'accusé ne suspendait pas la procédure : si le mort était coupable d'hérésie, cette erreur devait être reconnue par un jugement.
Même en l'absence d'aveux, le suspect n'était pas nécessairement emprisonné. Il pouvait rester en liberté sur parole, sur caution, ou présenter des personnes se portant garantes de sa comparution devant l'inquisiteur. L'incarcération pouvait être utilisée, mais le plus souvent ne s'étendait pas à toute la durée de la procédure.
Témoignages et défense
Des protections étaient accordées aux accusés, comme aux témoins. Ainsi l'identité des témoins à charge était tenue secrète, pratique courante de l'époque. Dans cette même logique, les notions de confrontation de témoin et de contre-interrogatoire étaient inconnues. En revanche, dans les tribunaux de l'Inquisition, les accusés étaient autorisés à fournir une liste des personnes susceptibles de leur en vouloir, lesquelles étaient alors récusées comme témoins.
Les tribunaux civils n'acceptaient pas de témoignages d'origine douteuse : voleurs, prostituées, personnes de mauvaise vie, mais aussi hérétiques et excommuniés. Très vite, les tribunaux d'Inquisition se démarquent de cette règle, en ce qui concerne le témoignage d'hérétiques, pour des raisons pratiques évidentes : les activités hérétiques étaient en général cachées, les témoignages correspondants ne pouvaient guère provenir que des hérétiques eux-mêmes. Cette pratique est officialisée en 1261 par le pape Alexandre IV.
L'accusé bénéficiait d'une protection générale certaine dans la manière dont on punissait le faux témoignage : les témoignages étaient obtenus sous serment, et le crime de parjure était sévèrement sanctionné par la réclusion à vie.
L'accusé a généralement droit à un défenseur, mais ce droit était le plus souvent théorique dans le cas de l'Inquisition, faute de volontaire : les avocats d'hérétiques risquaient d'être eux-mêmes accusés de complaisance avec l'hérésie poursuivie. En général, et pour la même raison, les accusés traduits devant un tribunal d'Inquisition ne bénéficiaient pas de la présence de témoins à décharge.
Question et torture
La procédure inquisitoriale accorde une grande importance à l'aveu de l'accusé. En tant que juridiction religieuse, l'inquisition se préoccupe du rachat des âmes et souhaite obtenir le repentir des accusés. Toute une procédure est alors mise en place pour obtenir leur témoignage, puis leurs aveux. Pour aider les clercs à procéder aux interrogatoires, des manuels de l'inquisiteur sont rédigés dont les plus célèbres sont le Manuel de l'inquisiteur de Bernard Gui, le manuel d'Eymerich, et le manuel de Torquemada. On y indique la procédure, les questions à poser, les pressions morales et les pressions physiques que l'on peut y faire subir. L'inquisiteur doit extraire la vérité éventuellement « par la ruse et la sagacité ». Parmi les pressions physiques, on peut citer la réclusion qui, selon Bernard Gui, « ouvre l'esprit », ainsi que la privation de nourriture et la torture. Mais une des particularités de l'instruction inquisitoriale est le secret : l'accusé et ses proches ne connaissent aucun des chefs d'inculpation et la défense se fait donc à l'aveugle.
Fréquence de l'usage de la torture
La pratique de la torture (ou « question », du latin quæstio) était à l'époque utilisée aussi dans les tribunaux séculiers, sauf par exemple en Aragon, et n'était pas l'apanage de l'Inquisition.
Bennassar évalue entre 7 et 10 % le nombre de prisonniers de l'Inquisition espagnole ayant subi ces supplices19 et précise que « l'usage de la torture n'a jamais été la règle pour l'Inquisition et peut même apparaître, à certaines époques, comme l'exception ».
Trait singulier de la torture sous l'Inquisition, la noblesse ne bénéficiait pas de privilège particulier comme cela était le cas auprès des autres tribunaux.
Cependant, l'usage de la torture en particulier, et le nombre de victimes de l'inquisition en général, reste difficile à quantifier car la plupart des données statistiques sur la période avant 1560 ont disparu. Les aveux obtenus sous la torture n'étant pas recevables, cette partie de la procédure ne faisait généralement pas l'objet d'un enregistrement écrit[réf. nécessaire], et les archives des procès sont le plus souvent muettes ou au mieux allusives sur ce sujet. On trouve ainsi dans les minutes des interrogatoires de courtes phrases du type, confessionem esse veram, non factam vi tormentorum, qui à la fois évoque l'hypothèse d'une torture, et nie que l'aveu noté en ait été l'effet (« l'aveu est spontané, non fait sous la force de la douleur »). Les notations explicites postquam depositus fuit de tormento (« après son retour de la torture ») sont rarissimes.
Limites de la torture
Bartolomé Bennassar rappelle que la pratique de la torture est très codifiée dans l'Inquisition espagnole. Trois tortures sont préconisées : l'eau, la poutre et le feu.
Bennassar considère pour preuve que la torture fut appliquée avec modération le fait que nombreux sont ceux qui y résistèrent. De même, Laurent Albaret considère qu'au XIIe siècle, « la pratique de la torture (…) est modérée et le personnel inquisitorial sincèrement peu convaincu de ses résultats ».
L'usage de la torture posait un problème moral pour les inquisiteurs, qui, en tant que clercs, n'avaient pas le droit de verser le sang. Après un flou juridique initial, cette pratique est officiellement autorisée pour l'Inquisition en 1252 par la bulle Ad extirpenda, sous réserve de ne conduire ni à la mutilation ni à la mort, et en excluant les enfants, les femmes enceintes et les vieillards de son champ d'application. De plus, il a souvent été exigé par le pape qu'elle ne puisse être donnée qu'avec le consentement de l'évêque du lieu, dont on se passait souvent aussi dans la pratique. Dans cette bulle, l'accusé bénéficie de deux protections : la question ne peut être donnée qu'une fois (mais en plusieurs jours), et les aveux doivent être répétés « librement » pour être recevables.
Une autre source disponible permettant de se faire une idée sur l'usage de la torture dans les procès de l'Inquisition sont les manuels et instructions des inquisiteurs, pour autant qu'on les respecte. Dans les manuels, l'interdiction de soumettre plusieurs fois à la question semble ne pas avoir été prise au sérieux : des arguments formels permettaient de justifier que cette interdiction est formellement respectée, tout en la laissant sans effet. La question était par exemple considérée comme formée de plusieurs étapes, la fin d'une étape n'impliquant pas la suspension de toute la procédure. Un autre argument a été que la découverte de nouvelles charges justifiait à nouveau l'usage de la question spécifiquement contre cette charge. Enfin, l'interdiction ne concernait que l'accusé par rapport à son chef d'accusation, pas le cas des témoignages obtenus de la part d'autres témoins.
Selon Nicolas Eymerich, inquisiteur général d'Aragon, la torture n'était toutefois pas un moyen fiable et efficace d'obtenir la vérité (quæstiones sunt fallaces et inefficaces) car il estimait que, non seulement la capacité de résistance variait considérablement d'un individu à l'autre, mais aussi que certains accusés usaient de sorcellerie pour devenir insensibles à la douleur, voire préféraient mourir que de confesser. En 1561, l'inquisiteur général Fernando de Valdés fit preuve du même scepticisme30. Néanmoins, il a été relevé de nombreux cas d'abus ; l'un des pires exemples, loin d'être un cas isolé, fut sans doute celui de Diego Rodriguez Lucero, inquisiteur de Cordoue de 1499 à 1507, date à laquelle il a finalement été relevé de ses fonctions.
Avis d'un jury
« Berceau de Judas », ancien instrument de torture. Exposition Inquisition au Palacio de los Olvidados de Grenade.
Dans les cas difficiles, le tribunal devait entendre l'avis d'un collège de boni viri, conseil (en latin consilium) formé de trente à une centaine d'hommes de mœurs, de foi et de jugement confirmés. Ce conseil est imposé et confirmé par les instructions du pape à partir de 1254. Son rôle ira croissant dans l'Inquisition, et sera étendu à d'autres juridictions pour finalement être à l'origine du jury moderne.
Après qu'ils ont prêté serment de s'exprimer en conscience, l'ensemble des actes du procès leur était transmis, mais de manière anonyme, censuré du nom de la personne accusée. Ils transmettaient deux avis à l'inquisiteur : sur la nature de la faute constatée, et sur la nature de la sanction opportune.
L'inquisiteur reste souverain et responsable de sa sentence, mais l'avis de ce conseil était le plus souvent suivi, et quand il ne l'était pas, c'était pour amoindrir les sanctions proposées.
Prononcé du jugement
Les sentences de l'Inquisition étaient prononcées dans une cérémonie officielle, en présence des autorités civiles et religieuses. Cette cérémonie — une liturgie dans le sens antique du terme — avait pour fonction de marquer symboliquement la restauration de l'équilibre social et religieux qui avait été rompu par l'hérésie. C'était donc un acte de foi public, ce qui est la signification exacte du terme portugais « auto da fé ».
Un jour ou deux avant le prononcé, les inculpés se voyaient lire à nouveau les charges retenues contre eux (traduites en langue vernaculaire), et étaient convoqués pour entendre le verdict de l'inquisiteur, avec les autorités du lieu et le reste de la population.
La cérémonie s'ouvrait tôt le matin, par un sermon de l'inquisiteur, d'où son autre nom de « sermon général ». Les autorités civiles prêtaient ensuite serment de fidélité à l'Église, et s'engageaient à prêter leur assistance dans sa lutte contre l'hérésie.
La lecture des verdicts venait ensuite, en commençant par les « actes de clémence » : remises de peines ou commutations. Les pénitences de toutes natures (dons, pèlerinages, mortifications, etc.) suivaient ensuite. Venaient enfin les sanctions proprement dites, jusqu'aux plus sévères qu'étaient l'emprisonnement à vie ou la peine de mort. Les condamnés étaient alors remis au bras séculier par une formule solennelle : Cum ecclesia ultra non habeat quod faciat pro suis demeritis contra ipsum, idcirco, eundum reliquimus brachio et judicio sæculari (« Puisque l’Église n’a plus à présent à accomplir son rôle contre ceux-ci, pour cette raison, nous les laissons au bras séculier et à sa justice »). Sur ce, la cérémonie s'achevait. L'inquisiteur avait achevé son rôle, l'Église s'était prononcée sur l'hérésie.
Chacun pouvait alors rentrer chez soi avec sa bonne conscience retrouvée — sauf bien sûr les coupables de crimes contre la société, à qui le « bras séculier » allait faire subir leurs peines. Contrairement aux pénitences religieuses, ces peines étaient en effet définies par le pouvoir temporel. Elles sanctionnaient les crimes commis contre la foi et l'Église, toutes deux officiellement protégées par l'État.
Peines et pénitences
Le tribunal inquisitoire n'infligeait pas de peines à proprement parler, mais des « pénitences ». Les moins graves étaient appelées « pénitences arbitraires ». C'était la flagellation publique au cours de la messe, les visites aux églises, les pèlerinages, l'entretien d'un pauvre, le port de la croix sur les vêtements, etc.
La pénitence était souvent réduite par la suite. Les archives de l'Inquisition montrent de nombreux exemples de pénitences atténuées ou levées pour des motifs variés, parfois sur simple demande. On cite ainsi le cas d'un fils obtenant la libération de son père en faisant simplement appel à la clémence de l'inquisiteur, d'autres sont libérés pour assister leurs parents malades « jusqu'à leur guérison ou leur mort ».
Mais l'Inquisition condamne aussi à des peines économiques et sociales. Par la confiscation et la vente des biens saisis, elle amasse des butins lui permettant de fonctionner, et si même l'accusé est libéré, il est ruiné. L'Inquisition espagnole condamne aussi à l'ostracisme par le biais du port du sambenito ou par l'exposition de celui-ci avec le nom du condamné dans les églises. La peine de l'inhabileté conduisait aussi à la ruine et la misère celui qui en était frappé.
En revanche, les hérétiques qui ne s'étaient pas présentés dans les délais de grâce, ou ceux qui étaient retombés dans l'hérésie, encouraient la prison à vie. La prison connaissait deux modes possibles : le « mur large », comparable à une résidence surveillée, et le « mur étroit », réclusion solitaire. Le mur étroit pouvait être aggravé en carcer strictissimus, le condamné mis au cachot (communément appelé un in pace) enchaîné et privé de tout contact.
Le relaps, ou l'obstiné qui refusait d'avouer son crime (qui devait par ailleurs avoir été démontré), était abandonné à l'autorité séculière, et la peine de son crime était souvent l'incarcération ou le bûcher. En toute rigueur, la peine la plus sévère que prononçait l'Église était l'excommunication. Les condamnations à mort étaient prononcées en fonction de la loi civile et exécutées par les autorités séculières. Il faut dire, cependant, qu'il n'y avait pas de séparation nette entre les domaines civils et religieux : les autorités civiles étaient elles-mêmes tenues d'apporter leur concours sous peine d'excommunication.
Appel
Dans certaines circonstances, en particulier en cas de faute lors du déroulement de la procédure, l'accusé peut faire appel au pape. En pratique, cette possibilité est rarement offerte. Bernard Gui précise que l'inquisiteur passe outre à tout privilège d'exemption et à l'appel. À Valence en 1494, ce droit à l'appel est dénié à ceux condamnés pour hérésie. Selon Étienne-Léon de La Mothe-Langon célèbre faussaire historien de l'Inquisition, au XVIe siècle, l'appel au pape et au parlement se généralise et permet de bloquer la procédure tant que la plainte n'a pas été analysée.
L'évangélisation par l'épée
Victimes
L'inquisition concerne les chrétiens devenus « hérétiques » et non les non-chrétiens en terre chrétienne. Par exemple, en 1199, le pape Innocent III, associé à la création du tribunal d'Inquisition, rappelle l'importance de protéger les Juifs dans les droits qui sont les leurs et l'impossibilité de convertir par la force un non-chrétien mais il est peu écouté. Elle concernera en outre toute personne considérée comme déviante : les mystiques (notamment illuministes alumbrados), les « sorcières » et « sorciers », les blasphémateurs (délit de paroles), les bigames, les fornicateurs (pour les relations hors mariage), les zoophiles (délit dit de « bestialité »), les sodomites (dont homosexuels), les pédérastes, les personnes dénoncées pour motifs divers.
Bilan humain
Le nombre de personnes abandonnées à la justice civile et livrées au bûcher est difficile à évaluer. La mémoire collective est marquée par les exécutions massives de Montségur, Vérone ou du mont Aimé45 et par la répétition des bûchers à certaines périodes de l'Inquisition espagnole.
Les registres des procès ont partiellement disparu et les historiens sont amenés à évaluer le bilan humain seulement à partir de documents partiels. Ce principe d'évaluation conduit à des résultats extrêmement variables, de 400 victimes pour les dix premières années à plusieurs millions sur plusieurs siècles et dans de nombreux pays selon l'estimation de l'historien Jules Michelet en 1862 en tenant compte de l'évangélisation par l'épée des nouvelles terres. Juan Antonio Llorente dans son étude Histoire critique de l'Inquisition d'Espagne depuis l'époque de son établissement par Ferdinand V, jusqu'au règne de Ferdinand VII, en 1818, estime à environ 30 000 condamnations à mort physique et 15 000 par effigie durant les trois siècles de l'Inquisition espagnole de 1481 à 1781 (date de la dernière exécution) dont 8 800 pour la période de Torquemada. Cependant, des historiens contemporains trouvent cette évaluation grandement exagérée et la désignent comme un instrument de la légende noire au XIXe siècle.
« Agostino Borromeo, un des meilleurs spécialistes, estime que, pour l'Inquisition espagnole, sur 44 674 inculpés, quelque 800 furent condamnés à mort. » ; « s'il y avait quelque 125 000 procès d'hérétiques présumés en Espagne, les chercheurs ont constaté que près de 1 pour cent des accusés ont été exécutés. Au Portugal, 5,7 pour cent des plus de 13 000 personnes jugées devant des tribunaux de l'église du XVIe et début du XVIIe siècles, ont été condamnées à mort », précise-t-il.
Les quelques études menées pour le XIIIe siècle donnent une proportion de condamnations au bûcher inférieure à 10 % des peines. D'après Patrick Henriet, « Il ne fait aucun doute qu'au XIIIe siècle, comme encore par la suite, la justice inquisitoriale s'est montrée beaucoup moins expéditive que celle des cours civiles. » Bartolomé Bennassar pointe la grande variabilité en nombre de ces condamnations selon les périodes (rigoureuses ou plus calmes). Il évalue ainsi à 40 % des personnes jugées celles montant sur le bûcher lors de la période la plus terrible de l'inquisition espagnole (fin du XVe siècle), pour tomber à 1 % dans la seconde moitié du XVIIe siècle. D'après Jean Dumont, Bernard Gui a prononcé, entre 1308 et 1323, 42 condamnations au bûcher sur 930 sentences, soit 4,5 %.
Pour autant, tous ces calculs ne peuvent tenir compte des victimes consignées dans les nombreuses archives de procès qui ont été détruites ou perdues.
Au temps de l'inquisition triomphante, on posa en 1524 à Séville une plaque commémorative donnant un bilan des quarante premières années de l'inquisition espagnole, supposées les plus terribles :
« L'an du Seigneur 1481 […] a commencé en ce lieu le Saint Office de l'Inquisition contre les hérétiques judaïsants, pour l'exaltation de la foi. Par lui, depuis l'expulsion des Juifs et des Sarrasins jusqu'en l'année 1524 […] plus de vingt mille hérétiques ont abjuré leurs criminelles erreurs, et plus de mille obstinés dans l'hérésie ont été livrés aux flammes, après avoir été jugés conformément au droit […] »
Liberté de conscience
Les cathares de Carcassonne expulsés nus de la cité en 1209.
La conversion à Dieu ne peut se faire que librement. C'est ce que dit Ézéchiel : « Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse » (Ez. 33:11, 2P 3:9, prologue de la règle de saint Benoît). C'est ce que répètent les pères sans cesse, depuis Tertullien au IIe siècle. À l'époque même où la première Inquisition est fondée, Bernard de Clairvaux formule que « la foi doit être persuadée, non imposée ».
Dominique de Guzmán, de son côté, fonde l'ordre des Prêcheurs pour réduire l'hérésie albigeoise par la prédication et l'exemple d'une vie mendiante, se démarquant de la croisade guerrière menée à la même époque sous Innocent III. La solide formation dogmatique des Dominicains leur vaudra ultérieurement de fournir bon nombre d'inquisiteurs. Dans sa lignée, Thomas d'Aquin, futur docteur de l'Église, affirme dans la Somme théologique que la conscience, même erronée, oblige. C'est-à-dire qu'il est rationnel et donc juste que l'homme suive sa conscience (ST., Ia IIæ., Qu.19, art.559).
Toutefois, même si la conscience est libre, cette liberté ne se comprend que par rapport à deux devoirs dans la pensée catholique :
le devoir moral de chaque individu de chercher la vérité et de vivre en conséquence ;
le devoir institutionnel de l'Église d'annoncer et de défendre ce qu'elle perçoit de la Vérité, c'est-à-dire le dogme.
Un tribunal d'Inquisition, par lui-même, ne fait que se prononcer sur l'orthodoxie du cas qui lui est soumis. Un tel jugement est un devoir institutionnel et ne pose aucun problème moral. L'Église accepte que son jugement entraîne une sanction pénale du pouvoir temporel.
Atteinte à l'ordre social
Pour la société médiévale, le christianisme fait partie de l'ordre social, et l'ordre social se fonde sur la religion.
Dans cette organisation, sur le plan religieux, une hérésie constitue nécessairement une rupture de l'ordre social. Inversement, sur le plan politique, la seule manière de contester l'ordre établi est d'entrer en rupture (schisme) avec la religion institutionnelle.
Il est normal que le pouvoir temporel défende d'une manière ou d'une autre l'ordre social, en sanctionnant au besoin ce qui le met en danger (même si la défense est délicate, et doit s'exercer avec prudence, pour ne pas tomber dans un immobilisme réactionnaire).
Dans la mesure où l'hérésie met en danger la société, elle doit être combattue par le pouvoir temporel. Mais dans la mesure où l'hérésie s'exprime dans le domaine de la foi, elle doit être jugée par une autorité religieuse.
Par conséquent, les tribunaux religieux se mettent à juger des fauteurs de troubles sociaux. Ce partage des rôles est acté dans l’accord de Vérone (1148) entre le Pape et l'Empereur : les hérétiques doivent être jugés par l'Église avant d'être remis au bras séculier, pour y subir « la peine due » (debita animadversione puniendus).
Inquisition et pouvoir
L'Église et l’État
« L'histoire de l'Inquisition est l'illustration du drame qui menace les hommes chaque fois qu'une liaison organique s'établit entre l'État et l’Église », écrit Bartolomé Bennassar.
Le fonctionnement même de l'Inquisition (promulgation d'édits obligeant à la dénonciation, tenue et conservation de registres sur toutes les dénonciations, procédure soumise au secret) en fait une formidable outil de répression dont le pouvoir religieux et royal usera.
Selon les époques, l'Inquisition sert ou combat le pouvoir politique. En France, l'inquisition médiévale, dans ses débuts, est principalement au service du pape, qui tente de rasseoir son autorité et de lutter contre les hérésies, et le roi s'opposera parfois à la rigueur de la répression. Mais, dès la fin du XIIIe et jusqu'au XVe siècle, les souverains sollicitèrent le pouvoir inquisitorial pour se débarrasser des individus devenus gênants pour les puissants. Au XIVe siècle, le pape réagit à certaines dérives sur l'autonomie laissée à l'inquisition en exigeant la collaboration entre inquisiteurs et évêques. Le droit absolu de l'inquisiteur est remis en question. Mais les juridictions civiles fragilisent aussi peu à peu la puissance d'un tel tribunal. À Toulouse, en 1331, un commissaire du roi assimile l'inquisition à une juridiction royale, en 1412, l'inquisiteur de Toulouse est arrêté sur l'ordre du roi. En Dauphiné, le tribunal est progressivement subordonné au Parlement de Grenoble.
En Espagne, l'inquisition est sous l'autorité du roi, qui désigne les inquisiteurs. Le pape n'a que très peu d'influence sur l'inquisition espagnole et face à l'intransigeance d'un Torquemada, il ne peut qu'élever une protestation, s'il l'élève. Instrument du pouvoir, elle est d'abord une force d'unification dans l'Espagne après la Reconquista. Elle se met ensuite au service du pouvoir devenant une arme contre les fueros. Elle sert à lutter contre les ennemis du pouvoir (parti navarrais, Antonio Pérez, répression des émeutes de 1591, répression de la révolution de 1640 en Catalogne, prise de parti dans la guerre de Succession d'Espagne).
Elle fournit, par ses condamnations, de la main d'œuvre gratuite pour les galères et enrichit les caisses de la couronne par les amendes qu'elle inflige et la saisie des biens, tout en finançant la poursuite de ses propres œuvres. Elle se plie aux aléas de la politique (indulgence envers les hérétiques anglais en 1604 lors de la construction de la paix). Elle sert aussi de police politique en contrôlant les étrangers. Elle devient peu à peu une force réactionnaire contre les changements au sein de l'Espagne dont la puissance perdurera jusqu'en 1808.
Répression de la Réforme protestante
L'Inquisition s'attaque à la Réforme protestante, en particulier sur les territoires espagnols, sous les règnes de Charles Quint puis de son fils Philippe II.
En 1522, Charles Quint crée le poste d'Inquisiteur général des Pays-Bas espagnols, en y nommant François Vander Hulst, pour étendre son pouvoir à travers cette institution. Celle-ci réprime de manière particulièrement violente ce qui est considéré par l'Église catholique comme une hérésie. Les victimes deviennent des martyrs, et cette répression alimente dans la population néerlandaise le rejet du régime espagnol, qu'elle obtient à la suite de près d'un siècle de troubles (la guerre de Quatre-Vingts Ans, 1566-1648). L'indépendance de la Hollande se construit sur un fond de lutte pour la liberté religieuse, contre l'Espagne catholique et son Inquisition.
À la fin du XVIe siècle, le thème de l'Inquisition passe dans la culture des Églises réformées, porté par un culte des héros à la fois nationaliste et religieux. De nombreux pamphlets commencent à diffuser une image critique de l'Inquisition et de ses pratiques. C'est ainsi qu'en 1567 le protestant espagnol Antonio del Corro (es) (sous le pseudonyme de Reginaldus Gonzalvus Montanus) dénonce l'Inquisition espagnole dans son ouvrage Sanctæ Inquisitionis Hispanicæ Artes aliquot detectæ ac palam traductæ, en présentant « chaque victime de l'inquisition comme innocente, chaque inquisiteur comme vénal et trompeur, et chaque étape de la procédure inquisitoriale comme une violation des lois de la nature et de la raison » (Peters 1988, p. 134). Ce livre, réimprimé et traduit à de nombreuses reprises, remporte un énorme succès. Un autre ouvrage notable est l'Apologie de Guillaume de Nassau, publiée en 1581 par le huguenot Pierre Loyseleur de Villiers. La majorité des charges contre l'Inquisition s'appuieront ensuite sur ces sources.
L'Angleterre du XVIe siècle est à la fois protestante, en contact culturel et économique étroit avec la Hollande, et en lutte d'influence contre l'Espagne catholique. De plus, depuis 1533, elle baigne dans un anti-papisme officiel et la réconciliation avec Rome durant le bref règne de Marie Tudor (de 1553 à 1558), assortie de persécutions contre les protestants, ne fait que radicaliser le rejet du catholicisme sous le règne d’Élisabeth Ire. Dans ce contexte, le thème des crimes de l'Inquisition trouve un nouveau relais dans les milieux protestants et nationalistes anglais (Peters 1988, p. 139-144).
L'image de l'Inquisition
Au XVIIIe siècle, celui des Lumières, l'Inquisition devient un thème récurrent du discours anticlérical. Voltaire la prend pour cible constante. Diderot et D'Alembert la prennent également pour cible dans leur Encyclopédie : dans le Discours préliminaire de l'Encyclopédie, D'Alembert la critique sévèrement, sans la nommer, pour la condamnation de Galilée. Le thème de cette nouvelle image n'est plus seulement la violence, mais la raison. L'Inquisition devient le symbole de l'obscurantisme, l'instrument par lequel l'Église catholique impose un dogme par la violence.
Au XIXe siècle, le thème des Lumières continue à vivre dans le discours anticlérical, et est de plus relayé par la vision que le romantisme a donnée du Moyen Âge. Ainsi, Jules Michelet publie en 1841 le Procès des Templiers, en 1862 La Sorcière ; Victor Hugo publie en 1882 un drame en quatre actes intitulé « Torquemada », et relate, dans Notre-Dame de Paris, le sort d'Esméralda. Quelques années plus tôt, en 1867, le Don Carlos de Verdi, d'après Friedrich von Schiller, avait diffusé dans le public une image à la fois négative et emblématique avec le personnage du « Grande Inquisitore, cieco e nonagenario » (le « Grand Inquisiteur, aveugle et nonagénaire »). Ce thème, comme dans l'Histoire de l'Inquisition en France, développe l'image d'une Inquisition menée par des ecclésiastiques pervers ayant opprimé les populations à toutes les époques. Cette vision est reprise par l'école laïque.
Dans l'épopée des Pardaillan, un des succès de la littérature d'aventure du début du XXe siècle, l'Inquisition espagnole apparaît non seulement comme une juridiction spéciale, mais encore comme une organisation occulte autonome, plus puissante que le pape et disposant de son propre service de renseignement.
Au XXe siècle, l'Inquisition passe dans le vocabulaire courant, devenant un mot commun pour désigner un certain genre de persécution, hystérique, souvent collective et toujours spectaculaire. Le genre littéraire toujours actif se prolonge dans la bande dessinée, les jeux vidéo, faisant plus souvent référence aux stéréotypes de la légende noire de l'Inquisition que prétendant refléter une réalité plus nuancée sur la base des recherches historiques contemporaines.
À la fin du XXe siècle, deux œuvres occupent une place à part. Dans son roman Le Nom de la rose (1980), Umberto Eco choisit pour personnage principal un ancien inquisiteur, Guillaume de Baskerville, qui fait office de détective élucidant une série de meurtres. Un an plus tard, dans son film La Folle Histoire du monde (1981), Mel Brooks se met lui-même en scène dans un sketch parodique qui représente l'inquisition sous la forme d'une comédie musicale.